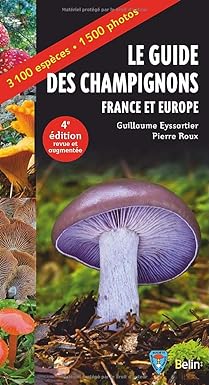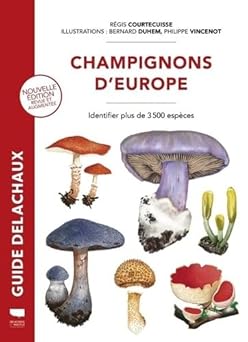Synonymes : Agaricus fascicularis Hudson (1778), Flora Anglica, Edn 2, p. 615 (basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Agaricus jenensis Batsch (1783), Elenchus fungorum, p. 83, tab. 7, fig. 29
Agaricus fascicularis var. ß jenensis (Batsch) Willdenow (1787), Florae berolinensis prodromus, p. 380
Agaricus fasciculatus J.F. Gmelin (1792), Systema naturae, Edn 13, 2, p. 1425
Hypophyllum sulphuratum Paulet (1808) [1793], Traite des champignons, 2, p. 228, tab. 107, fig. 1-5
Digitellus chiromorpha Paulet (1808) [1793], Traite des champignons, 2, p. 420, tab. 192, fig. 1-3
Agaricus lucidus J. Otto (1816), Versuch einer auf … Anordnung und Beschreibung der Agaricorum, p. 35 (nom. illegit.)
Pratella fascicularis (Hudson) Gray (1821), A natural arrangement of British plants, 1, p. 627
Agaricus fascicularis terrestris Secretan (1833), Mycographie Suisse, 1, p. 354 (nom. rejic.)
Hypholoma fasciculare (Hudson) P. Kummer (1871), Der furher in die pilzkunde, p. 72 (nom actuel)
Naematoloma fasciculare (Hudson) P. Karsten (1879), Bidrag till kannedom af Finlands natur och folk, 32, p. 496
Geophila fascicularis (Hudson) Quelet (1886), Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium, p. 113
Dryophila fascicularis (Hudson) Quelet (1888), Flore mycologique de la France et des pays limitrophes, p. 154
Psilocybe fasciculare (Hudson) Kuhner (1980), Bulletin mensuel de la Societe linneenne de Lyon, 49, n° sp., p. 899
Hypholoma sulphureum G.M. Taylor & P.K. Buchanan (1988), New Zealand Bot. Soc. Newsletter, 13, p. 11
References : Bon p. 253 ; CD 1288 ; BK 4 411 ; IH1 349 ; Yoshimi p. 36 ; IOH 224-225 ; Eyssartier et Roux p. 828 ;
Groupe : Hypholomes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Strophariaceae
Chapeau/Fructification : Chapeau mesurant 1,5 a 8 cm, brun orange a jaune citrin, marge enroulee, parfois cortinee. Reaction orange a la potasse.
Lames/Pores : Serrees, jaunes puis verdatre a gris olivace. Fluorescence verte a la lumiere UV.
Chair : Jaune, inodore a saveur tres amere.
Stipe : Stipe mesurant 4-12 x 0,5-1 cm, jaune soufre a roussatre a la base, cylindrique, souvent courbe a cortine verdatre parfois abondante. Reaction orange a la potasse.
Habitat : En touffe, sur bois de feuillus comme de coniferes. Tres frequent.
Spores : Spores mesurant 7 x 4 μm, a pore germinatif net.
Comestibilite : Mortel
Commentaires : L'amertume extreme de ce champignon aura epargne de nombreuses vies. Mortel. LD 50 = 50 mg/kg (fasciculol E), + le principe amer, la Naematoline qui est cytotoxique et antibiotique cf etude de cas et bibliographie ci-dessous : En 1983 a Aomori (Japon), une famille de 6 personnes se partage un plat de ces champignons, cuits en tsukudani (mijotes longuement dans un melange de sauce de soja et de sucre). Trois des enfants, ages de 5,7 et 10 ans decedent deux jours apres. L'ainee, 13 ans decede quatre jours apres ingestion. Tous les quatre enfants ont presentes 6-8 heures apres le repas les symptomes suivants : - picotements de la langue, - vomissements violents, - convulsions, - coma avec reprise de conscience momentanee, - apparition de taches violettes sur l'abdomen, le torse et le cou, - mort subite. La mere, 38 ans, souffre de vomissements, diarrhee, convulsions, perte de conscience, avant la remission spontanee au 5eme jour. Le pere, 46 ans, seulement de vomissements, diarrhee, douleurs abdominales, et guerit au bout de 24 heures. - DIAK J. (1975). The study of some compounds biosynthesized by Naematoloma fasciculare (Huds ex Fr.) P. Karst. Part. I. Analysis in vitro. Polish Journal of Pharmacology & Pharmacy 27 (2), 235-241. - DIAK J. (1977). Investigation on some compounds biosynthesized by fruitbodies of Naematoloma fasciculare. Planta Medica 32 (2), 181-187. - HERBICH J., LOHWAG K., and ROTTER R. (1966). Fatal poisoning with the green-leaf sulfur cap (Nematoloma fascicularis). Arch. Toxikol. 21 (5), - ITO Y., KURITA H., YAMAGUCHI T., and SATO M. (1967). Naematolin, a new biologically active substance produced by Naematoloma fasciculare (Fr.) Karst. Chemical & Pharmaceutical Bulletin 15 (12), 2009-2010. - KUBO I., MATSUMOTO A., KOZUKA M., and W.F., W. (1985). Calmodulin inhibitors from the bitter muschroom Naematolola fasciculare (Fr.) Karst. (Strophariaceae) and Absolute configuration of fasciculols. Chem. Pharm. Bull. 33 (9), 3821-3825. - SUZUKI K., FUJIMOTO H., and M., Y. (1983). The toxic principles of Naematoloma fasciculare. Chem. Pharm. Bull. 31 (6), 2176-2178. - TAKAHASHI A., KUSANO G., OHTA T., and Y., O. (1989). Fasciculic Acids A, B and C as calmodulin antagonists from the mushroom Naematololoma fasciculare. Chem. Pharm. Bull. 37 (12), 3247-3250.

Synonymes : Agaricus jacobinus Scopoli (1772), Flora carniolica, Edn 2, 2, p. 438 ('iacobinus ')
Agaricus atrotomentosus Batsch (1783), Elenchus fungorum, p. 89, tab. 8, fig. 32 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Scutiger hypophyllum Paulet (1808) [1793], Traite des champignons, 2, p. 124, tab. 33, fig. 2-3
Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fries (1838) [1836-38], Epicrisis systematis mycologici, p. 317
Rhymovis atrotomentosa (Batsch) Rabenhorst (1844), Deutschlands kryptogamen-flora, 1, p. 453
Paxillus jacobinus (Scopoli) Wettstein (1886) [1885], Verhandlungen der kaiserich-koniglichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 35, p. 569 ('iacobinus')
Tapinia atrotomentosa (Batsch) Patouillard (1887), Les hymenomycetes d'Europe, anatomie generale et classification des champignons superieurs, p. 130
Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara (1993) [1992], Ceska mykologie, 46(1-2), p. 50 (nom actuel)
Sarcopaxillus atrotomentosus (Batsch) Zmitrovich, V. Malysheva & E. Malysheva (2004), Folia cryptogamica Petropolitana, 1, p. 53
References : CD 1612-458, 99, 66 ; Bon p. 51 ; Marchand 236 ; IOH p. 288 ; Eyssartier et Roux p. 980, 1012 4eme edition
Groupe : Paxilles
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Tapinellaceae
Chapeau/Fructification : 5-30 cm de diametre, non circulaire mais dissymetrique, souvent excentrique en forme de rein ou presque lateral, tres epais mais tendre, tres tot surbaisse-aplani, brusquement enroule a la marge, brun d'ombre a brun ocre, a la fin creuse en entonnoir, revetement pelucheux, devenant ecaille ou ecorche et gerce. Reaction violette a l'ammoniaque.
Lames/Pores : tres serrees et tres inegales, arquees en fer de faux, tres etroites (4 mm) et fragiles (pouvant se separer en bloc du chapeau), decurrentes et sinueuses, reunies a la base, interveinees, creme incarnat, puis creme ocrace ou jaunatres, se tachant souvent de lilas violace au toucher.Ce genre faisant parti des boletales, ses lames se separent donc du chapeau.
Chair : epaisse, spongieuse, blanchatre, citrin pale sous la cuticule, devenant gris violace par endroits; saveur en general amere, rarement douce. Odeur faible, plutot agreable. Comme tous les Tapinella, ils font parties des boletales, ce qui ramene a la particularite ( les lames sont separables du chapeau ), remonter du pied vers le sommet avec l'ongle.
Stipe : 3-6 x 2,5-5 cm, d'abord plus large que long, obese et difforme, souvent appointi a l'exteme base, entierement couvert d'un feutrage veloute noiratre contrastant fortement avec le chapeau.
Habitat : Juin a novembre, frequent sur les vieilles souches et sous les coniferes, rarement sous feuillus. Une variete a pigment violet sombre dans toutes les parties vient sous les bambous.
Spores : sporee cacao clair (ou cacao sombre si les lames touchent le papier). 5-7 x 3-4 µm, courtement ovales, lisses, jaunatre tres pale sub microscopio. Cystides absentes, lacticiferes etroits guttules de jaune pale. Trame bilaterale; Cuticule filamenteuse, a hyphes remplies d'un suc brun.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Saveur presque toujours amere. La var. bambusinum (Baker et Dale), decrite de Cuba sous bambous acclimates, frequente au Japon sous Phyllostachis bambusoides, se distingue par son tomentum plus clairseme, et surtout par son pigment violet sombre dans toutes les parties, la chair violette fuligineuse a la coupe, et le noircissement de l'entier carpophore. Marcel Bon, apres etude du pigment, lui attribuait un rang specifique.

Synonymes : Agaricus spectabilisFries (1828), Elenchus fungorum, sistens commentarium in systema mycologicum, 1, p. 28 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1832)(index)
Agaricus quercicola Lasch (1829), Linnaea, Ein journal fur die botanik, 4, p. 544
Agaricus aureus ss. Berkeley (1836), The english flora of sir J.E. Smith, fungi, 5(2), p. 90
Agaricus aureus var. truncicola Rabenhorst (1845), Klotzschii herbarum vivum mycologicum, Edn 1, n° 702
Pholiota spectabilis (Fries) Gillet (1876), Les hymenomycetes, ou description de tous les champignons (fungi) qui croissent en France, p. 443
Dryophila aurea ss. Quelet (1888), Flore mycologique de la France et des pays limitrophes, p. 161
Pholiota lutea Peck (1898), Annual report of the New York state Museum of natural history, 51, p. 288
Pholiota grandis Rea (1903) [1902], Transactions of the British mycological Society, 2(1), p. 37
Pholiota aurantiaca Thesleff (1920), Bidrag till kannedom af Finlands natur och folk, 79(1), p. 34
Rozites spectabilis (Fries) Singer (1922), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 20(5-6), p. 299
Pholiota gigantea Naveau (1923), Natuurwetenschappelijk tijdschrift, 5, p. 77
Fulvidula spectabilis (Fries) Romagnesi (1937), Revue de mycologie, Paris, 2, p. 191
Gymnopilus spectabilis (Fries) A.H. Smith (1949), Mushrooms in their natural habitats, p. 471 (nom actuel)
Gymnopilus luteus (Peck) Hesler (1969), Mycologia memoirs, St. Paul, 3, p. 26
Souvent cite comme synonyme de Gymnopilus junonius
References : Romagn. NA (I)59 ; Becker p. 247 ; Bon p. 245 ; CD 1207 ; IH1 448 ; IOH p. 268 ; Eyssartier et Roux p. 676
Groupe : Pholiotes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Hymenogastraceae
Chapeau/Fructification : epais et charnu, de 5 a 15 cm de diametre, hemispherique ou obtusement conique, puis convexe, parfois bossu au centre, a marge fortement enroulee dans la jeunesse, tres sec, glabre, soyeux, non hygrophane, tout vergete de petites ecailles rougeatres (apprimees et non dressees comme chez les pholiotes), puis finement gerce, d'une belle couleur jonquille ou doree (qui lui a valu son nom) et enfin fauve, roux orange a roux.
Lames/Pores : pas tres serrees, inegales, en fer de faux, adnees a echancrees, un peu uncinees (decurrentes en filet), sulphurines puis fauve dore, avec l'arete plus jaune, enfin safrane rouille par les spores, de consistance tenace (impossible a fendre transversalement).
Chair : epaisse, ferme et tres amere, du meme jaune safrane vif que le chapeau, se tachant de brun rouge au toucher. Odeur faible. Saveur amere.
Stipe : 8-15 x 1-3 cm, ventru (un peu attenue en haut et en bas, renfle dans la partie moyenne), courbe, plein, ferme et presque dur, farineux et striole au sommet, glabrescent, d'un superbe jaune d'or clair, muni pres des lames d'un anneau membraneux bien developpe, assez mince, strie, jaune puis rouille.
Habitat : Assez commun dans les bois clairs, les pres ou le long des routes, souvent en touffes, plus ou moins fournies, surtout sur les vieilles souches de feuillus, isolees et ensoleillees. Thermophile.
Spores : de couleur fauve rouille en masse, 8-11,5 x 5-7 µm, subamygdaliformes a pruniformes, granulees de fortes verrues, sans pore germinatif, jaune fauve vif sous le microscope. Petites cystides lageniformes a suc jaune, difficiles a voir entre les basides. Cuticule filamenteuse.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : Jaune vif et amers, les Gymnopiles different des vraies pholiotes par la couleur de la sporee et du carpophore, les spores fortement verruqueuses. En Asie, ou l'amertume n'est pas un obstacle a la consommation, cette espece est traditionnellement consideree comme psychodysleptique, comme en atteste par exemple le noms japonais "Oo-warai-take" = Grand champignon hilarant.

Synonymes : Agaricus dactyloides Battarra (1755), Fungorum agri ariminensis historia, p. 70, tab. 36, fig. C
Boletus flabelliformis Leysser (1761), Florae halensis, Edn 1, p. 219
Boletus rugosus Jacquin (1774), Florae austriacae sive plantarum selectarum in Austriae archiducatu sponte crescentium, 2, p. 44, tab. 169
Boletus variegatus Schaeffer (1774), Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam, 4, p. 90, tab. 263 (nom. illegit.)
Agaricus pseudoboletus Jacquin (1778), Miscellanea austriaca, 1, p. 26, tab. 41 (non ?)
Boletus obliquatus Bulliard (1780), Herbier de la France, 1, tab. 7 & tab. 459
Boletus lucidus Curtis (1782), Flora londinensis, 2(4), p. 72, tab. 224/216 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Boletus resupinus O.F. Muller (1782), Flora danica, 15, p. 6, tab. 894
Boletus vernicosus Bergeret (1783), Phytonomatotechnie universelle, 1, p. 99 ('vernigosus')
Boletus nitens Batsch (1783), Elenchus fungorum, p. 109
Agaricus lignosus Lamarck (1783), Encyclopedie methodique, Botanique, 1, p. 51
Boletus dimidiatus Thunberg (1784), Flora japonica, p. 348, tab. 39
Boletus castaneus Weber (1787), Praemisso Supplemento Florae Holsaticae, p. 13 (nom. illegit.)
Boletus crustatus J.J. Planer (1788), Index plantarum quas in agro erfurtensi sponte provenientes, p. 280
Boletus laccatus Timm (1788), Florae megapolitanae prodomus, p. 269
Boletus supinus J.F. Gmelin (1792), Systema naturae, Edn 13, 2, p. 1433
Boletus verniceus Brotero (1804), Flora lusitanica, 2, p. 468
Pyrenium vernicosum (Bergeret) Paulet (1808) [1793], Traite des champignons, 2, p. 92, tab. 8, fig. 1-2
Polyporus lucidus (Curtis) Fries (1821), Systema mycologicum, 1, p. 353
Grifola lucida (Curtis) Gray (1821), A natural arrangement of British plants, 1, p. 644
Polyporus laccatus (Timm) Persoon (1825), Mycologia europaea, seu complet omnium fungorum in variis europaeae regionibus detectorum enumeratio, 2, p. 54
Polyporus laccatus subsp.* semipatera Persoon (1825), Mycologia europaea, seu complet omnium fungorum in variis europaeae regionibus detectorum enumeratio, 2, p. 55
Polyporus vernicosus (Bergeret) Chevallier (1826), Flore generale des environs de Paris, 1, p. 252
Polyporus lucidus subsp.* japonicus Fries (1838) [1836-38], Epicrisis systematis mycologici, p. 442
Fomes lucidus (Leysser) J. Kickx f. (1867), in J.J. Kickx, Flore cryptogamique des Flandres, 2, p. 238
Polyporus semipatera (Persoon) Fries (1874), Hymenomycetes europaei sive epicriseos systematis mycologici, p. 537
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karsten (1881), Revue mycologique (Toulouse), 3(9), p. 17 (nom actuel)
Fomes amboinensis var. japonicus (Fries) Cooke (1885), Grevillea, 13(68), p. 118
Placodes lucidus (Leysser) Quelet (1886), Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium, p. 170
Fomes japonicus (Fries) Saccardo (1888), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 6, p. 156
Phaeoporus lucidus (Curtis) J. Schroter (1888) [1889], in Cohn, Kryptogamen-flora von Schlesien, 3(1), p. 491
Ganoderma fici Patouillard (1892), Enumeration des champignons observes en Tunisie, Exploration scientifique de la Tunisie, p. 4, tab. 2, fig. 1
Polyporus fici (Patouillard) Laplanche (1894), Dictionnaire iconographique des champignons superieurs (Hymenomycetes) qui croissent en Europe, Algerie & Tunisie, p. 274
Ganoderma laccatum (Timm) Patouillard (1897), Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, supplement 1, p. 114
Scindalma variegatus (Schaeffer) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 517
Scindalma japonicum (Fries) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 518
Ganoderma pseudoboletus (Jacquin) Murrill (1902), Bulletin of the Torrey botanical Club, 29(10), p. 602
Ganoderma curranii Murrill (1908), Bulletin of the Torrey botanical Club, 35(8), p. 411
Ganoderma lucidum var. japonicum(Fries) Bresadola (1912), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 10(5), p. 500
Ganoderma leucocreas Patouillard & Hariot (1912), Bulletin de la Societe mycologique de France, 28(3), p. 281
Polyporus japonicus (Fries) Lloyd (1912), Mycological writings, 3, synopsis of the stipitate polyporoids, p. 102
Ganoderma nitens (Batsch) Lazaro Ibiza (1916), Revista de la real Academia de ciencias exactas, fiscicas y naturales de Madrid, 14, p. 104 (nom. illegit.)
Ganoderma ostreatum Lazaro Ibiza (1916), Revista de la real Academia de ciencias exactas, fiscicas y naturales de Madrid, 14, p. 110
Ganoderma japonicum (Fries) Sawada (1931), Descriptive catalogue of Formosan fungi, 5, 51, p. 76
Ganoderma mongolicum Pilat (1940), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 38(1), p. 78
References : Bon p. 321 ; CD 81 ; Marchand 323 ; Eyssartier et Roux p. 1032
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Polyporaceae
Chapeau/Fructification : 4-20 cm, verni, blanc ou creme au bord dans sa jeunesse puis jaunissant et finissant par devenir brun-rouge, zone, epais.
Lames/Pores : Brunissant au toucher.
Chair : Brune, coriace. Odeur de polypore ou de bois.
Stipe : Souvent excentre voire lateral.
Habitat : Sur bois mort de feuillus, plus rarement sur coniferes. Dans les forets. Annuel. Toute l'annee. Assez frequent.
Spores : 8-11 x 6-8,5 μm, elliptiques.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Agaricus amethystinus Scopoli (1772), Flora carniolica, Edn 2, 2, p. 437 (nom. rej.)
Agaricus bulbosus Hudson (1778), Flora Anglica, Edn 2, p. 611 (nom. illegit.)
Agaricus violaceus Scholler (1787), Supplementum flora barbiensis, p. 344 (nom. illegit.)
Agaricus cyanopes Sibthorp (1794), Flora oxoniensis, p. 346
Agaricus bicolor Persoon (1801), Synopsis methodica fungorum, p. 281 (nom. illegit.)
Agaricus personatus var. ß bicolor Fries (1818), Observationes mycologicae praecipue ad illustrandam floram suecicam, 2, p. 90
Agaricus personatus Fries (1818), Observationes mycologicae praecipue ad illustrandam floram suecicam, 2, p. 89
Cortinarius bicolor (Fries) Gray (1821), A natural arrangement of British plants, 1, p. 628
Agaricus hepaticus Weinmann (1832), Flora oder allgemeine botanische Zeitung, 15, p. 449 (nom. illegit.)
Omphalia bicolor (Fries) Zawadzki (1835), Enumeratio plantarum Galiciae & Bucowinae, p. 167, n° 2663
Agaricus personatus subsp.* saevus Fries (1838) [1836-38], Epicrisis systematis mycologici, p. 48 (Basionyme)
Paxillus personatus (Fries) Kalchbrenner (1867), Mathematikai es termeszettudomanyi kozlemenyek, vonatkozolag a hazai vizsonyokra, 5, p. 246
Lepista personata (Fries) Cooke (1871), Handbook of british fungi, Edn 1(1), p. 193
Tricholoma amethystinum (Scopoli) P. Kummer (1871), Der furher in die pilzkunde, p. 132
Tricholoma personatum (Fries) P. Kummer (1871), Der furher in die pilzkunde, p. 132
Tricholoma saevum (Fries) Gillet (1874), Les hymenomycetes, ou description de tous les champignons (fungi) qui croissent en France, p. 123
Gyrophila amethystina (Scopoli) Quelet (1886), Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium, p. 17
Gyrophila palumbina (Paulet) Quelet (1888), Flore mycologique de la France et des pays limitrophes, p. 272
Entoloma personatum (Fries) Peck (1902) [1901], Annual report of the New York state Museum of natural history, 54, p. 166
Rhodopaxillus personatus (Fries) Maire (1913), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 11(4), p. 338 (au sens de certains auteurs)
Rhodopaxillus saevus (Fries) Maire (1913), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 11(4), p. 338
Lepista saeva (Fries) P.D. Orton (1960), Transactions of the British mycological Society, 43(2), p. 177 (nom actuel)
Clitocybe saeva (Fries) H.E. Bigelow & A.H. Smith (1969), Brittonia, 21, p. 169
References : Romagn.PA 152 ; BK 3 248 ; CD 429-240, 114 ; Marchand 47 ; Bon p. 145 ; Eyssartier et Roux p. 610, 628 4eme edition
Groupe : Tricholomes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Incertae sedis
Chapeau/Fructification : 6-10(-15) cm, epais et convexe, souvent bombe au centre, a marge d'abord enroulee (et alors pruineuse et blanchatre), un peu onduleuse a la fin, gris pale, gris bistre, brunatre clair, cafe-au-lait, rarement un peu teinte de lilacin, palissant avec l'age. Surface lisse, humide, brillante.
Lames/Pores : assez serrees a serrees, sinuees, arrondies ou echancrees sur le pied, parfois legerement decurrentes a la fin, separables du chapeau (comme les tubes d'un bolet), blanc brunatre pale ou blanc rosatre, mais sans aucune nuance violette ou lilacine. Sporee beige rosee.
Chair : epaisse, tendre a ferme et alors cassante, blanchatre, a peine penetree de violet sous le revetement du pied. Saveur douce (d'amande amere? Mais parfois desagreable en fonction du terrain!), odeur agreable, faiblement fruitee ou de farine.
Stipe : epais, renfle a la base, 4-7(-10) x 1,5-2 cm, entierement revetu de fibrilles d'un violet assez intense, sur fond blanc, contrastant de facon frappante avec le chapeau.
Habitat : dans les pelouses, chaumes, prairies (surtout alluviales), lisieres (ou il pousse en ronds de sorcieres, parfois tres serres, ou en lignes sinueuses, en zigzag). Assez commun dans toute l'Europe, mais pas partout; signale en Amerique du Nord et au Japon.
Spores : 7-8 x 4-5 µm, pruniformes, rosatre clair et finement piquetees d'ornements en relief.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Toujours hors de la foret, dans l'herbe des pres et des paturages humides, les vieilles prairies et sur les berges des rivieres, plutot en terrain calcaire. Poussee tardive, a partir d'octobre et jusqu'aux premieres gelees, de novembre a fevrier dans le Midi de la France.

Synonymes : Lycoperdon tuberosum P. Micheli (1729), Nova plantarum genera, p. 219, tab. 98, fig. 2 (nom. inval.)
Lycoperdon conglomeratum P. Micheli (1729), Nova plantarum genera, p. 219, tab. 98, fig. 3 (nom. inval.)
Lycoperdon capitatum Batsch (1783), Elenchus fungorum, p. 147
Lycoperdon arrhizon Scopoli (1786), Deliciae florae et faunae insubricae, 1, p. 40, tab. 18 ('arrizon') (Basionyme) Sanctionnement : Persoon (1801)
Scleroderma arrhizum (Scopoli) Persoon (1801), Synopsis methodica fungorum, p. 152
Scleroderma tinctorium Persoon (1801), Synopsis methodica fungorum, p. 152
Pisolithus arenarius Albertini & Schweinitz (1805), Conspectus fungorum in Lusatiae superioris, p. 82, tab. 1, fig. 3
Polysaccum acaule de Candolle & F. Desportes (1807), Memoires de la Societe d'agriculture du departement de la Seine, 11, p. 8
Polysaccum crassipes de Candolle & F. Desportes (1807), Memoires de la Societe d'agriculture du departement de la Seine, 11, p. 8
Pisomyces arenarius (Albertini & Schweinitz) Fries & Nordholm (1817), Symbolae Gasteromycetum, 1, p. 4
Pisocarpium arenarium (Albertini & Schweinitz) Nees (1817), Das system der pilze und Schwamme, p. 139
Pisocarpium clavatum Nees (1817), Das system der pilze und Schwamme, p. 138, tab. 13, fig. 131
Polypera arenaria (Albertini & Schweinitz) Persoon (1818), Traite sur les champignons comestibles, p. 116
Polypera clavata (Nees) Persoon (1818), Traite sur les champignons comestibles, p. 116
Polypera crassipes Ficinus (1823), Flora der Gegend um Dresden, Edn 2, 2, p. 306
Polysaccum arenarium (Albertini & Schweinitz) Fries (1827) [1825-26], Stirpes agri femsionensis, 5, p. 81
Polysaccum turgidum Fries (1829), Systema mycologicum, 3(1), p. 53
Polysaccum subarhizum Fries (1829), Systema mycologicum, 3(1), p. 54
Polysaccum pisocarpium Fries (1829), Systema mycologicum, 3(1), p. 54
Polysaccum tuberosum Fries (1829), Systema mycologicum, 3(1), p. 55
Polysaccum conglomeratum Fries (1829), Systema mycologicum, 3(1), p. 55
Polysaccum capsuliferum (Sowerby) Secretan (1833), Mycographie Suisse, 3, p. 373 (nom. inval.)
Polysaccum tinctorium (Persoon) Montagne (1840), n P. Barker-Webb & S. Berthelot, Histoire naturelle des Iles Canaries, 3(2), Phytographia canariensis, p. 87, tab. 5, fig. 1
Polysaccum crassipes var. b clavatum (Nees) Rabenhorst (1844), Deutschlands kryptogamen-flora, 1, p. 294
Polysaccum arrhizum (Scopoli) Rabenhorst (1844), Deutschlands kryptogamen-flora, 1, p. 294
Polysaccum australe Leveille (1848), Annales des sciences naturelles, botanique, serie 3, 9, p. 136, tab. 9, fig. 3
Polysaccum boreale P. Karsten (1866), Fungi Fenniae exsiccati, 6, n° 570
Polysaccum leptothecum Reichardt (1866), Verhandlungen der kaiserich-koniglichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 16, p. 373
Polysaccum marmoratum Berkeley (1872) [1873], The journal of the linnean Society, botany, 13, p. 171
Pisocarpium crassipes (de Candolle & F. Desportes) Hazslinszky (1877) [1875-76], Mathematikai es termeszettudomanyi kozlemenyek, vonatkozolag a hazai vizsonyokra, 13, p. 8
Polysaccum arenarium var. crassipes (de Candolle & F. Desportes) Quelet (1886), Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium, p. 243
Polysaccum pisocarpium var. rafinesquii De Toni (1888), in Saccardo, Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 7, p. 148
Pisolithus crassipes (de Candolle & F. Desportes) J. Schroter (1889), in Cohn, Kryptogamen-flora von Schlesien, 3(1), p. 706
Scleroderma umbrinum Cooke & Massee (1890), Grevillea, 19(90), p. 45 ('umbrina')
Lycoperdodes crassipes (de Candolle & F. Desportes) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Lycoperdodes conglomeratum (Fries) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Lycoperdodes australe (Leveille) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Lycoperdodes arhizus (Scopoli) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Lycoperdodes boreale (P. Karsten) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Lycoperdodes tuberosum (Fries) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Lycoperdodes leptothecum (Reichardt) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Lycoperdodes marmatorum (Berkeley) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Lycoperdodes turgidum (Fries) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 859
Pisolithus australis (Leveille) E. Fischer (1900), in Engler & Prantl, Die naturlichen pflanzenfamilien, 1(1**), p. 338
Pisolithus marmoratus (Berkeley) E. Fischer (1900), in Engler & Prantl, Die naturlichen pflanzenfamilien, 1(1**), p. 338
Polysaccum pusillum Hariot & Patouillard (1903), Journal de botanique, Paris, 17(1), p. 13
Polysaccum umbrinum (Cooke & Massee) Lloyd (1905), Mycological writings, 1, the Lycopodaceae of Australia, New Zealand and neighboring islands, p. 13
Pisolithus kisslingii E. Fischer (1907) [1906], Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern, 1906, p. 118
Pisolithus turgidus (Fries) Migula (1912), Kryptogamen-flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz, Band III. Pilze, 2(2), p. 765
Pisolithus tuberosus (Fries) Migula (1912), Kryptogamen-flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz, Band III. Pilze, 2(2), p. 765
Polysaccum kisslingii (E. Fischer) Saccardo & Trotter (1912), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 21, p. 492
Polysaccum arenarium var. acaule (de Candolle & F. Desportes) Bigeard & H. Guillemin (1913), Flore des champignons superieurs de France, 2, p. 537
Polysaccum pygmaeum Lloyd (1924), Mycological writings, 7, mycological notes n° 73, p. 1306
Pisolithus tinctorius (Persoon) Coker & Couch (1928), The Gasteromycetes of the Eastern United States and Canada, p. 170, tab. 96-97
Melanogaster tuberosum (Fries) Zeller & C.W. Dodge (1936), Annals of the Missouri botanical Garden, 23(4), p. 654
Pisolithus tinctorius f. turgidus (Fries) Pilat (1958), Flora CSR : Gasteromycetes, p. 581
Pisolithus tinctorius f. clavatus (Nees) Pilat (1958), Flora CSR : Gasteromycetes, p. 581
Pisolithus tinctorius f. pisocarpium (Fries) Pilat (1958), Flora CSR : Gasteromycetes, p. 581
Pisolithus tinctorius f. conglomeratus (Fries) Pilat (1958), Flora CSR : Gasteromycetes, p. 582
Pisolithus tinctorius f. tuberosa (Fries) Pilat (1958), Flora CSR : Gasteromycetes, p. 582
Pisolithus tinctorius f. olivaceus (Fries) Pilat (1958), Flora CSR : Gasteromycetes, p. 582
Pisolithus arhizus (Scopoli) Rauschert (1959), Zeitschrift fur pilzkunde, 25(2), p. 51 (nom actuel)
References : CD 1724-482, 68 ; Cetto 357 ; Marchand 183 ; Bon p. 303 ; Phillips p. 251 ; IH2 865 ; Yoshimi 89 ; IOH p. 501 ; Mycotaxon 112 p. 306
Groupe : Vesses de loup
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Pisolithaceae
Chapeau/Fructification : 3-10 x 2-3 cm, subglobuleux a piriforme, souvent turbine a la base. Peridium simple, mince (1 mm), sec, bossele et plus ou moins rugueux, jaune ocrace souvent macule de fauve roussatre ou de brun verdatre sale, noircissant au froissement, dur mais devenant tres friable, bientot rompu a partir du sommet en plaquettes polygonales.
Chair : Pateuse puis pulverulente, constituee d'une multitude de logettes en alveoles brun rougeatre a cloisons steriles, minces, molles, garnis de peridioles ellipsoides, revetues d'un duvet jaune. Une coupe verticale du carpophore montre trois zones concentriques differentes etagees: - petits peridioles jaunes immatures a la base, - plus grands (2 x 5 mm), brun noiratre et succulents dans la partie mediane, - secs, pulverulents, brun jaunatre au sommet. Saveur douce. Odeur fongique agreable.
Stipe : Subsessile ou muni d'un pied court (1,5-3 cm) enfoui dans le sable, plein et dur, epais de 1-2,5 cm, plus ou moins ramifie pour contourner les obstacles, garni d'un mycelium basal en chevelu brunatre.
Habitat : Cosmopolite (Europe, Afrique, Asie, Mexique, Japon...) quoi qu'assez rare, du printemps a l'automne dans les sols pauvres, secs et chauds, souvent sablonneux, les terrils, clairieres des pinedes ou chenaies, a tendance calcifuge.
Spores : globuleuses, 7(9)-12-(13) µm, aculeolees, ornees d'epines de 1-1,5 µm de long, 0-1 grosse guttule, jaunatre sombre. Basides piriformes a 2-6 spores.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Peut-etre introduit en Europe depuis l'Australasie avec l'eucalyptus, son aire de repartition s'etend regulierement vers le nord (il a atteint l'Irlande en 1985). Consomme a l'etat jeune selon Marchand, notamment pele et seche en lanieres, pour colorer (l'epithete "tinctorius" = du teinturier" se refere a l'usage en ebenisterie du pigment brun olivace extrait du gelin de la paroi des pseudoperidioles) en brun, mais aussi pour aromatiser les sauces et potages. Pisolithus arhizus est le chef de file d'un complexe de plusieurs taxons tres semblables morphologiquement.

Synonymes : Agaricus plicatus Lamarck (1778), Flore francaise ou description succincte de toutes les plantes qui croissent naturellement en France, Edn 1, 1, p. 111 (nom. illegit.)
Agaricus farinaceus Hudson (1778), Flora Anglica, Edn 2, p. 616
Agaricus violaceolaccatus Hoffmann (1789), Nomenclator fungorum, 1, p. 189
Omphalia farinacea (Hudson) Gray (1821), A natural arrangement of British plants, 1, p. 612
Agaricus laccatus var. farinaceus (Hudson) Britzelmayr (1879), Bericht des naturhistorischen vereins in Augsburg, 25, p. 29, fig. 3
Laccaria laccata var. bicolor Maire (1937), Publicaciones del Instituto botanico, Barcelona, 3(4), p. 84 (Basionyme)
Laccaria proxima var. bicolor (Maire) Kuhner & Romagnesi (1953), Flore analytique des champignons superieurs, p. 131 (nom. inval.)
Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton (1960), Transactions of the British mycological Society, 43(2), p. 177 (nom actuel)
Laccaria farinacea (Hudson) Singer (1973), Beihefte zur Sydowia, 7, p. 8
References : CD 353 ; Bon p. 147 ; IH1 75 ; IOH p. 60 ; HN Aomori p. 33 ; Eyssartier et Roux p. 534
Groupe : Clitocybes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Hydnangiaceae
Chapeau/Fructification : 2,5-6 cm, hemispherique, bientot convexe, puis etale, avec presque toujours un ombilic au centre. Revetement hygrophane (de saturation tres variable) brun-rose, carne brique a ocre, palissant, glabre a finement duveteux, la marge souvent striee et incurvee, tres ondulee en vieillissant.
Lames/Pores : Adnees a sub-echancrees, espacees, intercalees de nombreuses lamelles et lamellules, de couleur lilas clair ou rose lilacin, parfois plus foncees jusqu'au rouge violete.
Chair : Mince, ocre rosatre. Odeur faible, parfois legerement fruitee, saveur douce.
Stipe : 7,5-11-(15) x 0,5-0,8 cm, souvent flexueux ou tordu, fibreux, concolore ou un peu plus fonce que le chapeau, la base teintee de lilas a violet pale et mycelium basal violet.
Habitat : Dans les lisieres et clairieres des bois de feuillus et de coniferes, souvent sous Fagus et Pinus. Dans toute la zone boreale temperee d’Europe, Amerique et Japon, par petits groupes dissemines, du debut de l'ete a la fin de l'automne.
Spores : Subspheriques, 6,8-8,8 x 6,5-7,5 µm, orne d'epines de 0,8-1,2 µm de hauteur.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : C'est un champignon ecto-mycorhizien caracterise par sa souplesse d'adaptation, vivant en symbiose avec la plupart des arbres, notamment le sapin de Douglas, premiere espece de reboisement en France.

Synonymes : Agaricus abietinus Schrader (1794), Spicilegium florae germanicae, 1, p. 132 (nom. illegit.)
Agaricus porrigens Persoon (1796), Observationes mycologicae seu descriptiones tam novorum quam notabilium fungorum, 1, p. 54 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Agaricus palmatus Schumacher (1803), Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis et orientalis, 2, p. 362 (nom. illegit.)
Pleuropus porrigens (Persoon) Zawadzki (1835), Enumeratio plantarum Galiciae & Bucowinae, p. 171, n° 2756
Pleurotus porrigens (Persoon) P. Kummer (1871), Der furher in die pilzkunde, p. 104
Phyllotus porrigens (Persoon) P. Karsten (1879), Bidrag till kannedom af Finlands natur och folk, 32, p. 92
Agaricus niphetus Ellis (1882), Bulletin of the Torrey botanical Club, 9(2), p. 18
Calathinus porrigens (Persoon) Quelet (1886), Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium, p. 46
Pleurotus niphetus (Ellis) Saccardo (1887), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 5, p. 373
Dendrosarcus porrigens (Persoon) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 464
Dendrosarcus niphetus (Ellis) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 464
Geopetalum porrigens (Persoon) Murrill (1912), Mycologia, 4(4), p. 215
Geopetalum abietinum Murrill (1916), North American flora, 9(5), p. 300
Pleurotus albolanatus Peck (1918), in Kauffman, Michigan geological and biological survey, biological series 5, 26, p. 672, tab. 145
Pleurocybella porrigens (Persoon) Singer (1947), Mycologia, 39(1), p. 81 (nom actuel)
Pleurotellus porrigens (Persoon) Kuhner & Romagnesi (1953), Flore analytique des champignons superieurs, p. 74 (nom. inval.)
Nothopanus porrigens (Persoon) Singer (1973), Beihefte zur Sydowia, 7, p. 19
References : CD 154 ; Bon p. 121 ; Eyssartier et Roux p. 42, 958
Groupe : Collybies
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Incertae sedis
Stipe : Stipe nul.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : Au Japon, Sugi hira take (杉平茸) signifie "Pleurote du Sugi" (arbre majestueux voisin du cedre du Liban, Cryptomeria japonica). Comme le pleurote en huitre, il colonise les troncs de coniferes et Cryptomerias en jolies troupes de chapeaux blancs de 6 a 10 cm, spatules petaloides. tres elegants. Les lames sont assez larges, blanches a creme. Le pied est nul.. En 2001, c'etait la consternation en France apres les 4 deces (sur 13 hospitalisations) dans les Landes apres consommation du Tricholome equeste (Tricholoma auratum), frais ou meme en boite. Un champignon toujours tres prise dans ses regions de predilection, notamement les pinedes de la cote atlantique. C'est au tour du Japon de connaitre en automne 2004, une serie d'accidents similaires. La liste des champignons toxiques ne cesse d'augmenter dans le monde, parfois en raison des progres de l'analyse, mais souvent comme ici, par la necrologie brutale et incomprehensible de mycophages pourtant bon connaisseurs, comme ici a Niigata. Source: Nihon kingakkai (Societe Mycologique du Japon) et Mainichi shinbun du 22 10 2004. 5 deces sur les 11 intoxiques hospitalises dans le departement de Niigata tandis que les deux autres personnes hospitalisees dans le departement de Yamagata sont decedees dans les memes conditions. Pour 10 sur ces 11 personnes, la consommation de Sugi-hira take (Pleurocybella porrigens, "Pleurote en oreille " en francais) a ete confirmee par l'enquete des mycologues. L'autre personne etant decedee sans laisser aucune information sur une consommation fongique eventuelle. Double surprise: d'abord ce champignon etait considere comme comestible dans tout le pays, comme ailleurs dans le monde, notamment en France ou il est donne comestible dans tous les guides. De plus, aucun symptome "classique" gastro-intestinal (ni diarrhee, ni vomissements etc.) n'a ete observe Les intoxiques ont presente une chute brutale du tonus musculaire dans les jambes, interdisant la marche, puis l'apparition de mouvements incontroles et parasites des membres, enfin des convulsions, coma avec deces brutal pour 5 d'entre-eux. Une seule personne sur les onze hospitalisee de Niigata a quitte l’hopital indemne a ce jour, cinq sont mortes, et les cinq autres sont en soins intensifs. Les deux intoxiques de Yamagata sont decedes. La plupart des intoxiques etaient des insuffisants renaux, certains avec rein artificiel (!). La poussee de Pleurocybella porrigens en 2004 a ete estimee a pres du double des moyennes annuelles. Beaucoup de specimens de taille "geante" auraient egalement ete recoltes. le nombre total des intoxiques a atteint 46 personnes, dont 14 decedes par encephalopathie aigue.

Synonymes : Russula lilacea Quelet (1876), Bulletin de la Societe botanique de France, 23, p. 330, tab. 2, fig. 8 (Basionyme) (nom actuel)
Russula vesca var. lilacea (Quelet) Massee (1893), British fungus flora, 3, p. 62
References : BK 6 155 ; CD 1489-434, 91 ; Galli p. 273 ; Sarnari 1326 ; Bon p. 61 ; Marchand 459 ; IH2 602 ; Eyssartier et Roux p. 178, 4eme edition 182, 184
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 3-6 cm, convexe puis plan et brusquement deprime au centre, a marge mince ondulee, souvent cannelee-tuberculeuse; lilas, vineux, violet clair, brun-vineux, olivatre ou nuancee de jaune vert, parfois de plusieurs couleurs. Cuticule mate et seche, rarement visqueuse par la pluie mais vite ressuyee et veloutee-ponctuee, tres separable.
Lames/Pores : blanches puis creme pale et souvent jaunissantes a la marge, larges, obtuses a la marge, assez serrees au debut, fourchues, interveinees, friables, a arete aigue et fimbriee.
Chair : fragile, blanche, parfois tachee de jaune brunatre, assez epaisse au disque, bleuatre a la sulfo-vanilline, rougeatre pale au sulfate de fer, lente au Gaiac. Odeur faible, saveur douce ou parfois un peu apre.
Stipe : (2)3-5(6) x 0,7-1(1,5) cm, egal ou claviforme, mou et compressible, blanc mais presque toujours avec au moins des traces de rose d'un cote.
Habitat : Sous feuillus humides, charmes surtout. Assez rare en Europe, eparses ou en troupe en ete-automne, Europe, Chine, Japon.
Spores : Sporee d'un blanc pas toujours pur. Spore 8-10 x 6-8 µm a verrues isolees, de hauteur tres variable. Cystides 41-60 x 9,5-13,5 µm. Cuticule a hyphes primordiales incrustees.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Belle espece lilacine plutot petite, a pied fragile lave de rose, aimant les chenaies et charmaies humides. La var. carnicolor est plus polychrome, rose, carmin, olivace ou ochrace.

Synonymes : Lactarius glaucescens Crossland (1900), The naturalist, 1900, p. 5, tab. 10, fig. 1-3 (Basionyme)
Lactarius piperatus var. glaucescens(Crossland) Hesler & A.H. Smith (1979), North American species of Lactarius, p. 186
Lactarius eburneus Z. Schaefer (1979), Ceska mykologie, 33(1), p. 4 (nom. illegit.)
Lactifluus glaucescens (Crossland) Verbeken (2012), Mycotaxon, 120, p. 449 (nom actuel)
References : Bon p. 95 ; CD 1511-438 ; Cetto 1931 ; BK 6 25 ; Galli p. 283 ; Marchand 503 ; FE 7 723 ; Eyssartier et Roux p. 114, 120 4eme edition ; IH1 617 ; Phillips (NA) p. 91
Groupe : Lactaires
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 3,5-8 cm de diametre, uniformement blanc creme a roux, avec des plages glacees et comme micacees-brillantes. Cuticule lisse, non veloutee; consistance ferme. Chapeaux jeunes non deprimes, finement ponctues d'ocre jaunatre, avec souvent des micro-gouttelettes de latex (a la loupe) sechant en vert olive. Vieux chapeaux deprimes a cuticule teintee d'ocre de plus en plus fonce.
Lames/Pores : Extremement serrees (20/cm), comme Lactifluu piperatus, de couleur creme chair, decurrentes au moins par un filet. Latex verdissant assez lentement (15'-30') et faiblement sur les lames a la blessure, grisatre sale puis olivace ; KOH jaune orange pale rapide sur lame de verre, mais nulle au formol.
Chair : Chair ferme, jaunatre sale au grattage et dans les morsures, verdissant lentement; Reaction lente au formol (cerne violet en 20-30 minutes), bleu clair apres 3 heures, bleu fonce en 24 h.
Stipe : 4-8(-15), appointi a la base (quasi conique), blanchatre, brunissant a la manipulation.
Habitat : Assez rare en ete-automne sous feuillus dans tout l'hemisphere nord. Parfois aussi sous Pinus et Abies au Japon.
Spores : subglobuleuses a subovales, de 6,5-8 x 5,5-,7 µm, subtilement verruqueuses, avec de fines cretes relies en filet. Basides tetrasporiques de 35-40 x 9-11 µm. Cheilocystides de 55-60 x 5,5-7 µm. Epicutis compose d'un tapis peu serre de touffes d'hyphes minces et enchevetrees.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Oxydation : vert olive (lait) Potasse (KOH) : orange (lait) Formol (CH2O) : gris puis bleu ciel (lait) Sulfoformol : bleu ciel (lait)

Synonymes : Boletus obsonium ss. J. Blum (1969) [1968], Bulletin de la Societe mycologique de France, 84(4), p. 594
Boletus depilatus Redeuilh (1986) [1985], Bulletin de la Societe mycologique de France, 101(4), p. 389, Atlas 241 (Basionyme)
Leccinum depilatum (Redeuilh) Šutara (1989), Ceska mykologie, 43(1), p. 4
Xerocomus depilatus (Redeuilh) Manfred Binder & Besl (2001), Sequence data and Chemotaxonomical analyses on the genetic concept of Leccinum, p. 85
Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara (2008), Czech mycology, 60(1), p. 55 (nom actuel)
References : BSMF 101 (4) p. 389 (1986) ; BK 3 6 ; CD 1679-472, 67 ; Galli Boleti p. 199 ; Bon p. 36 ; Eyssartier et Roux p. 86, 92 4eme edition ; Euro Boletes p. 612-619
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 6-12(15) cm, hemispherique a convexe-pulvine (en forme de coussin), vite etale, a la fin souvent entierement plan. Marge aigue, avec une fine marginelle peu ou non rabattue sur les tubes, ou obtuse et alors a marginelle subnulle. Surface parsemee de multiples depressions ou fossettes, donnant un aspect bossele-martele caracteristique, rarement unie reguliere chez les jeunes. A maturite, les depressions s'estompent, sauf vers la marge. La zone bosselee peut parfois etre circonscrite a mi-rayon, formant une "couronne" encore visible chez l'adulte. Cuticule molle-humide et legerement translucide, mais non separable, d'abord brun fauve a brun ocrace, chamois, s'eclaircissant vite creme-alutace, cafe-au-lait, plus ou moins pale, mastic, rarement grisonnant, les fossettes gardant parfois leur couleur plus sombre d'origine, d'ou un aspect marbre. Revetement tres doux, comme satine au toucher, subpruineux a subveloute chez les jeunes, et mat, mais en realite glabre, meme sous la loupe, sans la moindre mechule ou feutrage. La cuticule vire rapidement au lilas-violace persistant au contact des vapeurs de NH3.
Lames/Pores : Tubes moyennement longs, depassant a peine l'epaisseur de la chair a mi-rayon de l'hymenium, jaune vif ou citrin, puis jaune-verdatre, sublibres puis subadnes apres croissance complete du pied, non bleuissants a la coupe, sinon exceptionnellement. Pores ouverts des le debut, fins (0,5-1 mm), rarement composes, circulaires, puis anguleux, mais non disposes radialement, concolores aux tubes, jaune a jaune olivace, rarement roussissant (par temps brumeux ?)
Chair : ferme, legerement cortiquee et fibreuse dans le pied (adultes), d'abord citrin pale puis presque blanche a maturite, sauf sous les tubes et en haut du pied ou elle reste d'un jaune plus soutenu, ainsi qu'a la base du pied ou elle est parfois jaune-ocre. Non bleuissante mais se tache assez frequemment de rougeatre ou de rosatre vineux avec l'age et selon les intemperies, d'abord a la base du pied, puis en haut du pied, puis partout et dans les morsures. Elle peut aussi rester intacte ou bien prendre dans la moitie inferieure du pied une teinte gris-bleute ou verdatre-olivatre caracteristique. Saveur douce, a peine acidule. Odeur nettement iodee, presque toujours perceptible dans le pied.
Stipe : D'abord long et robuste par rapport au chapeau, puis plus elance, vaguement fusele, tortueux et attenue-subradicant sur pres de la moitie inferieure qui est enterree profondement et plus ou moins termine en pointe. D'abord blanchatre, surtout dans la partie enterree, puis progressivement jaune pale dans la partie aerienne, ou seulement au sommet, et enfin se tachant progressivement (mais de facon inconstante, et surtout dans les recoltes meridionales) de rougeatre vineux, sous la forme typique d'un anneau pres du sommet, et de macules ou de plages variables en dessous. Revetement presque lisse, sauf quelques fines granulations concolores, floconneuses dans la partie aerienne.
Habitat : Espece peu commune (et confondue avec impolitus) venant en petites troupes tres dispersees, fidele a ses stations, meme seches, sous feuillus, surtout Carpinus, en terrain calcaire, en ete (juillet-septembre), France, Corse, Italie, Tchequie, Slovaquie...
Spores : Sporee olivatre. Spores 11-15(16) x 5-6 µm, jaune verdatre. Pleurocystides peu nombreuses 30-60, peu larges (7-10 µm), longuement fusoides, a col souvent peu marque.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Proche de Hemileccinum impolitum dont il differe par la structure de la cuticule, macroscopiquement glabre et nettement subcelluleuse au microscope. Chapeau cabosse, bossele, martele. Stipe attenue plus ou moins profondement enterre. Sous feuillus surtout charmes de preference en terrain calcaire. Odeur d'iode, ou de phenol comme H. impolitum et Agaricus xanthoderma, disparaissant a la cuisson. Tres semblable a Leccinum hortonii ou L. subglabripes (Amerique du Nord, Japon) aux teintes plus rougeatres, moins radicant et spores legerement plus grandes.

Synonymes : Agaricus tessulatus Bulliard (1791), Herbier de la France, 11, tab. 513, fig. 1 ('tessellatus') (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Agaricus tessulatus var. ßß guttatus Albertini & Schweinitz (1805), Conspectus fungorum in Lusatiae superioris, p. 226 ('tessellatus')
Agaricus ursipes Lasch (1829), Linnaea, Ein journal fur die botanik, 4, p. 523
Agaricus ulmarius var. b ursipes (Lasch) Rabenhorst (1844), Deutschlands kryptogamen-flora, 1, p. 517
Agaricus pardalis Schulzer (1873), in Kalchbrenner, Icones selectae hymenomycetum hungariae, 1, p. 18, tab. 8, fig. 2
Pleurotus tessulatus (Bulliard) Gillet (1875), Les hymenomycetes, ou description de tous les champignons (fungi) qui croissent en France, p. 342 ('tessellatus')
Tricholoma tessulatum (Bulliard) P. Karsten (1879), Bidrag till kannedom af Finlands natur och folk, 32, p. 46
Pleurotus pardalis (Schulzer) Saccardo (1887), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 5, p. 342
Gyrophila tessulata (Bulliard) Quelet (1888), Flore mycologique de la France et des pays limitrophes, p. 273
Pleurotus ulmarius var. tessulatus (Bulliard) Costantin & L.M. Dufour (1891), Nouvelle flore des champignons, Edn 1, p. 45
Dendrosarcus tessulatus (Bulliard) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 464
Dendrosarcus pardalis (Schulzer) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 464
Pleurotus ulmarius f. tessulatus (Bulliard) Pilat (1935), Atlas des champignons de l'Europe, 2, Pleurotus, p. 142
Hypsizygus tessulatus (Bulliard) Singer (1947), Mycologia, 39(1), p. 78 (nom actuel)
Pleurocybella tessulata (Bulliard) M.M. Moser (1955), Kleinen kryptogamenflora von mitteleuropa, band 2b/2, Edn 2, p. 62
References : KR p. 168 N 8 ; BMBDS 142 p. 6-10 ; DM Hors-serie N°5 p. 102 ; CD 474-250, 110 ; IOH 58-59 ; Eyssartier et Roux p. 356, 370 4eme edition
Groupe : Tricholomes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Lyophyllaceae
Chapeau/Fructification : 4-12 cm, convexe puis etale, humide, glabre, lisse, distinctement tesselle et guttule par l'humidite au centre ou vers la marge, hygrophane, blanchatre a chamois, creme rosatre a brunatre
Lames/Pores : adnees a sinuees, avec des filets sur le haut du pied, larges, interveinees, serrees a subespacees, intercalees de lamellules, subconcolores au chapeau. Sporee blanchatre.
Chair : ferme et epaisse mais tendre, blanche sordescente a chamois rosatre, odeur agreable, legerement anisee ou fruitee, saveur douce et fongique.
Stipe : 4-15 X 0,4-2 cm, parfois excentre, subegal, parfois radicant, souvent courbe, tres ferme, plein, pruine blanche a l'apex, lisse vers la base, blanchatre.
Habitat : Assez rare en Europe, vient en touffes denses sur bois vivant ou pourri de feuillus, en ete-automne. Au Canada, surtout sur peupliers et erables a sucre, ou parfois sur bouleaux.
Spores : globuleuses a subglobuleuses, lisses, hyalines, non amyloides, 4-5(6) X 3,5-4,5 µm.
Comestibilite : Bon comestible
Commentaires : Excellent comestible, cultive a grande echelle au Japon depuis une trentaine d'annees sous le nom de "Bouna-shimedji".

Synonymes : Hydnum striatum Schaeffer (1774), Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam, 4, p. 98, tab. 271
Hydnum suberosum Batsch (1783), Elenchus fungorum, p. 113, tab. 10, fig. 45
Hydnum hybridum Bulliard (1790), Herbier de la France, 10, tab. 453, fig. 2
Hydnum ferrugineum Fries (1815), Observationes mycologicae praecipue ad illustrandam floram suecicam, 1, p. 133 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Xylodon ferruginosum (Fries) Chevallier (1826), Flore generale des environs de Paris, 1, p. 272
Hydnum carbunculus Secretan (1833), Mycographie Suisse, 2, p. 515 (nom. inval.)
Hydnellum ferrugineum (Fries) P. Karsten (1879), Meddelanden af societas pro fauna et flora fennica, 5, p. 41 (nom actuel)
Calodon ferrugineus (Fries) P. Karsten (1881), Revue mycologique (Toulouse), 3(9), p. 20
Phaeodon ferrugineus (Fries) J. Schroter (1888) [1889], in Cohn, Kryptogamen-flora von Schlesien, 3(1), p. 459
Hydnum floriforme var. ferrugineum(Fries) Costantin & L.M. Dufour (1891), Nouvelle flore des champignons, Edn 1, p. 161
Hydnellum sanguinarium Banker (1906), Memoirs of the Torrey botanical Club, 12(2), p. 152
Calodon hybridus (Bulliard) Lindau (1911), Kryptogamenflora fur Anfanger (Berlin), 1, p. 44
Hydnellum hybridum (Bulliard) Banker (1913), Mycologia, 5(4), p. 198
Hydnellum pineticola K.A. Harrison (1964), Canadian journal of botany, 42, p. 1226
References : CD 71 ; BK 2 262 ; Marchand 344 ; IH2 255 ; Eyssartier et Roux p. 998
Groupe : Hydnes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Thelephorales / Bankeraceae
Chapeau/Fructification : 3-10 cm, pulvine puis vite etale a infundibuliforme, souvent inegal, bossele, irregulierement arrondi, cyathiforme a la fin, parfois soudes ou surmonte de chapeaux secondaires a demi avortes (pileoles), veloute puis fortement tomenteux-feutre, plus ou moins ride-radie, scrobicule, avec ou sans zones concentriques, blanchatre a rose, dans la jeunesse et par temps humide exsudant des gouttes de suc rouge sang (vermillon), puis brun-jaune a rouge-brun; la marge restant longtemps blanc de craie, mince et sinueuse crenelee, tomenteuse, incurvee puis droite ou dressee et concolore, englobant souvent des debris vegetaux.
Lames/Pores : 3,5-5 mm de long, fins (0,2 mm) inegaux, decurrents, serres, fragiles, blancs bientot rose carne brunatre a pointe pale, enfin brun rouille. Sporee brun clair.
Chair : a double trame, vaguement zonee concentriquement, spongieuse puis subereuse, brun rose carne a rouge-brun pale dans le chapeau, brun pourpre dans le pied, grisonnant a la dessication, marquee d'une foule de petites taches plus pales. Odeur faible de farine; saveur presque douce.
Stipe : 2-4(5) x 1-3 cm, plein, irregulier, comprime, tomenteux, glabrescent, englobant des particules du substrat, epaissi en une base spongieuse, concolore au chapeau.
Habitat : Pas si commun (a moins de confusion avec les especes voisines !) de juillet a novembre, en Europe et au Japon, dans la litiere d'aiguilles de coniferes, surtout Pinus et Picea.
Spores : 4-6 x 3,5-4,5 µm, subglobuleuses a largement ellipsoides, parfois guttulees, brunatres, a apicule oblique. Basides 20-30 x 5-7 µm, a 4-sterigmates de 3,75 µm. Structure monomitique. Boucles nulles.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Souvent confondu avec d'autres Hydnes, surtout Hydnellum peckii dont les jeunes chapeaux blancs exsudent egalement des gouttes rouges, mais notre champignon prend a partir du centre sa couleur brun ferrugineux, sauf la marge. Idem pour les aiguillons. La chair qui jute son suc rouge si on la comprime, finit par grisonner en laissant des taches allongees.

Synonymes : Corynites elegans Montagne (1856), Sylloge generum specierumque plantarum cryptogamarum, p. 281 (Basionyme)
Caryomyxa elegans Montagne (1856), Sylloge generum specierumque plantarum cryptogamarum, p. 281 (= ' Caromyxa')
Corynites curtisii Berkeley (1873), Grevillea, 2(15), p. 34
Mutinus elegans (Montagne) E. Fischer (1888), in Saccardo, Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 7, p. 13 (nom actuel)
Mutinus curtisii (Berkeley) E. Fischer (1888), in Saccardo, Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 7, p. 13
Mutinus bovinus Morgan (1889), Journal of the Cincinnati Society of natural history, 12(4), p. 147, tab. 3
Aedycia curtisii (Berkeley) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 441
Aedycia bovina (Morgan) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 441
Jansia elegans (Montagne) Penzig (1899), Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, 16(2), p. 140, tab. 20, fig. A, tab. 22, fig. 5-13
Mutinus inopinatus Ulbrich (1936), Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft, 54, p. 499
References : DM 53 p. 44 Jean Mornand (1984), Gasteromycetes de France ; DM 25 p. 453-458 Szczepka (1995), Cle des Mutinus ; CD 1748-486, 68 ; Marchand 378 ; TMSJ 41 p. 75-78 Guez D. et Nagasawa E. (2000), Espece nouvelle pour le Japon ; Eyssartier et Roux p. 1052, 1084 4eme edition
Groupe : Phalles
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Phallales / Phallaceae
Chapeau/Fructification : D'abord en forme d'œuf semi-hypoge puis epige de la taille d'un œuf de pigeon, subglobuleux puis ovoide a piriforme, 1,5-4-(5) cm de haut x 1-2,7 cm de diametre, non bossele mais bientot allonge par l'erection interne avant l'eclosion; surface lisse, blanche ou partiellement tachee de brunatre, munis a la base de nombreux rhizomorphes. Peridium constitue de trois couches, la couche externe et interne membraneuses et blanches, la couche mediane mucilagineuse et hyaline. L'enveloppe externe finit par se rompre pour former une volve a 2-4 lobes, tandis que la couche interne laisse souvent de fines veine blanches, formant des stries ou bracelets sur le receptacle.
Chair : Zone fertile non capitee et sans delimitation nette (pas de renflement ni amincissement notable, pas d'alveoles). Comme chez toutes les Phallales, le receptacle porte a son sommet (1/4 a 1/3 superieur) une gleba de couleur vert wagon a brun olivatre sombre, ointe sur 4-5 cm de la partie fertile, mucilagineuse et d'odeur forte et fetide, parfois a relent douceatre-nauseeux, mais non cadaverique.
Stipe : Receptacle stipitiforme, 9-19-(22) cm de haut sur 1-2,5-(3) cm de diametre, de forme tres variable, courtement acumine a la sortie de l'oeuf, puis cylindrique, souvent attenue a partir de la mi-hauteur en col de bouteille, toujours appointie et tronquee au sommet, perforee chez l'adulte, le meat du manchon apical variant en diametre de 0,4-0,8 cm. Structure spongieuse tubulaire et creuse de 2-3 mm d'epaisseur, d'abord dressee comme un i, bientot courbee, a la fin pliee en deux avant de s’effondrer. Surface entierement de couleur rouge pasteque caracteristique (rouge carmin orange, a rouge rose, Methuen 9A4-6, 9A-B7 ou 6A6, 7A7), palissant un peu a la base (9C-D8), poreuse dans la partie inferieure qui est composee de cellules polygonales ouvertes de 0,2-0,8 mm, devenant de plus en plus petites et fermees, verruqueuse, vers le haut.
Habitat : Comme d'autres Phallacees, le satyre elegant est a la fois tardif (novembre-decembre), heliophile (recherche la lumiere) et thermophile. Il semble affectionner les debris vegetaux, surtout les composts d'ecorces, et les sols acides, le bord des ruisseaux, les terrains incultes sablonneux ou siliceux. Au Japon, il est apparu dans la litiere des feuilles de bambous, de Quercus, et hors des bois dans les allees herbeuses sous Zelkova et Cinnamomum.
Spores : Basides sub-utriformes a sub-cylindracees, non bouclees a la base, 15-25 x 4-6 µm, portant un bouquet de 7-8 spores. Sterigmates de 1,5 µm de long. Cystides absentes. Spores 4-5 x 1,8-2 µm, oblongues-ellipsoides, lisses, cloison 0,4 µm, hyalines, vert grisatre pale, non guttulees. Coupe d'un œuf de 2,5 x 2,5 cm, blanc sordescent, vite sali de gris brunatre. Se perce naturellement au sommet apres deux jours et laisse echapper un, puis deux ballons remplis de mucus translucide. Coupe en deux au cutter, le cuir mince de l'enveloppe externe offre quelque resistance tandis qu'en dessous, une matiere visqueuse comme une huitre fuit sous la lame, avant de rencontrer une matiere plus solide, grenue comme un radis. Un liquide incolore et insipide comme de l'eau s'en echappe. La coupe (photo) montre un cortex rouge rose au centre, plus ou moins cordiforme, presque en V, a parois epaisses de 2-3 mm, enveloppe dans une gelatine translucide, plus coloree opaque qu'un blanc d’œuf, beige a jaune brunatre pale ( couleur de la gomme arabique, de resine de pin), de 3-6 mm d'epaisseur de part et d'autre de la tige centrale, presque nulle au sommet et a la base. Le receptacle est creuse en cavite de 2-4 mm sur chaque moitie. La volve est deja formee par une couche basale blanc pur, isolant le canal de gelee amniotique, comme un nombril de 1,5 mm d'epaisseur, reliee a l'exterieur a deux cordons myceliens. Le receptacle de l'adulte presente presque toujours un orifice sommital, foramen de 1-3 mm de diametre. Le tube est un tissus forme d'alveoles de 0,5-1 mm (mesurees a la face interne du tube) sur la partie fertile, de plus en plus larges vers la base. Basidiospores verdatre pale dans l'eau, lisses, ellipsoides, 4-4,5(5) x 1,8-2 µm, a parois epaisse vers 0,5 µm. Sterigmates de 1,5 µm de long. Basides en massue ou fusiformes, 8-spores, non bouclees, 3-5,5(5) x 20-25(30) µm, se retrecissant avec l'age, de sorte que leur largeur est inversement proportionnelle a la taille du primordium etudie, se liquefiant completement a maturite. Cloisons frequentes, parfois enormes. Hyphes greles, vers 3 µm, brusquement renflees en raccord, de type manchon de 8 µm. Spherocystes 20-30 x 25-32 µm.
Comestibilite : Sans interet

Lamproderma subaeneum Massee (1892), A monograph of the Myxogastres, p. 95
Comatricha shimekiana T. Macbride (1893), Bulletin from the Laboratories of natural history of the state university of Iowa, 2(4), p. 380, tab. 10, fig. 3
Lamproderma inconspicuum J. Schroter (1896), in Hennings, Hedwigia, 35(4), p. 208
Lamproderma arcyrionema var. japonicumMeylan (1935), Bulletin de la Societe Vaudoise des sciences naturelles, 58(236), p. 323
Paradiacheopsis arcyrionema (Rostafinski) Hertel (1956), Dusenia, 7(6), p. 348
Collaria arcyrionema (Rostafinski) Nannenga-Bremekamp ex Lado (1991), Ruizia, 9, p. 26
References : Ing p. 158 ; Poulain Meyer p. 242 fig. 441 1 442
Groupe : Myxos
Classification : Amoebozoa / Myxogastrea / Stemonitida / Stemonitidaceae
Chapeau/Fructification : Stipite, 0,9-2,5 mm de haut. Sporocystes globuleux, 0,3-0,6 mm de diametre, argente, bleu argente, bronzes ou dores, iridescents. Peridium se rompant irregulierement en larges fragments, subsistant souvent en collerette en haut du stipe.
Chair : Capillitium brun fonce, dense, a filaments ramifies et anastomoses ondules en boucles, emmeles.
Stipe : 1/2-2/3-4/5 de la hauteur totale, grele, subule, noir, brillant.
Spores : Rondes,en masse brun fonce ou noires, verruqueuses avec des petits groupes de verrues plus foncees, 6,5-7-8 µm.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Gregaire. Assez rare. Ete.

Synonymes : Phallus indusiatus Ventenat (1799), Memoires de l'Institut national des sciences et arts, 1, p. 520, tab. 7, fig. 3 (Basionyme) Sanctionnement : Persoon (1801) (nom actuel)
Dictyophora phalloidea Desvaux (1809), Journal de botanique, redige par une Societe de botanistes, 2(2), p. 92
Dictyophora indusiata (Ventenat) Desvaux (1809), Journal de botanique, redige par une Societe de botanistes, 2(2), p. 92 (non) (?)
Hymenophallus indusiatus (Ventenat) Nees (1817), Das system der pilze und Schwamme, p. 251
Phallus daemonum Rumphius ex Fries (1823), in Fries, Systema mycologicum, 2(2), p. 283
Dictyophora campanulata Nees (1827), in Leveille, Memoires de la Societe linneenne de Paris, 5, p. 507
Hymenophallus daemonum (Rumphius ex Fries) Sprengel (1827), Systema vegetabilium, Edn 16, 4(1), p. 498
Sophronia brasiliensis Persoon (1827), in Gaudichaud, Voyage autour du Monde … par Freycinet, Botanique, 5, p. 178, tab. 1, fig. 2
Dictyophora speciosa Meyen (1843), Novorum actorum Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosum, 19, p. 239
Dictyophora bicampanulata Montagne (1848), Annales des sciences naturelles, botanique, serie 3, 10, p. 120
Phallus speciosus (Meyen) Fries (1851), Nova acta regiae Societatis scientiarum Upsaliensis, series 3, 1, p. 133
Phallus radicatus Montagne (1855), Annales des sciences naturelles, botanique, serie 4, 3, p. 137
Dictyophora radicata (Montagne) Montagne (1856), Sylloge generum specierumque plantarum cryptogamarum, p. 280
Phallus tunicatus Schlechtendal (1861), Linnaea, Ein journal fur die botanik, 31, p. 123
Phallus tahitensis Schlechtendal (1861), Linnaea, Ein journal fur die botanik, 31, p. 126
Phallus brasiliensis Schlechtendal (1861), Linnaea, Ein journal fur die botanik, 31, p. 124
Dictyophora daemonum (Rumphius ex Fries) Leveille (1873), in Berkeley, Grevillea, 2(15), p. 34
Dictyophora nana Berkeley (1882), Grevillea, 11(57), p. 39
Phallus collaris Cragin (1885), Bulletin of the Washburn College Laboratory of natural history, 1(2), p. 33, tab. 1, fig. 6-7
Dictyophora brasiliensis (Schlechtendal) E. Fischer (1886), Jahrbuch des koniglichen botanischen gartens und des botanischen Museums zu Berlin, 4, p. 37
Dictyophora collaris (Cragin) De Toni (1888), in Saccardo, Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 7, p. 469
Dictyophora tahitensis (Schlechtendal) E. Fischer (1888), in Saccardo, Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 7, p. 4
Phallus diplopora Montagne (1890), in E. Fischer, Neue denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft fur die gesammten naturwissenschaften, 32(2), p. 81
Dictyophora farlowii E. Fischer (1890), Neue denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft fur die gesammten naturwissenschaften, 32(2), p. 83
Dictyophora braunii Hennings (1890), Jahrbuch des koniglichen botanischen gartens und des botanischen Museums zu Berlin, 1890
Dictyophora phalloidea var. farlowii (E. Fischer) E. Fischer (1893), Neue denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft fur die gesammten naturwissenschaften, 33(3), p. 33
Dictyophora callichroa Moller (1895), Botanische mittheilungen aus den tropen, 7, p. 129, 148
Dictyophora lilloi Spegazzini (1906), Anales del Museo nacional de Buenos Aires, serie 3, 9, p. 30
Phallus callichrous (Moller) Lloyd (1907), Mycological writings, 2, the phalloids of australasia, p. 6
Phallus farlowii (E. Fischer) Lloyd (1909), Mycological writings, 3, synopsis of the known phalloids, p. 24
Phallus moelleri Lloyd (1909), Mycological writings, 3, synopsis of the known phalloids, p. 20, fig. 13
Phallus rochesterensis Lloyd (1909), Mycological writings, 3, synopsis of the known phalloids, p. 20, fig. 18
Dictyophora phalloidea var. callichroa (Moller) Saccardo (1912), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 21, p. 459
Dictyophora phalloidea var. rochesterensis (Lloyd) Saccardo (1912), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 21, p. 460
Dictyophora baileyi Ulbrich (1932), Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft, 50, p. 295
Dictyophora indusiata f. callichroa (Moller) Kobayasi (1965), Transactions of the mycological Society of Japan, 6, p. 6
References : CD 1747-486, 68 ; IH1 909 ; IOH p. 522-523
Groupe : Phalles
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Phallales / Phallaceae
Chapeau/Fructification : Oeuf plus ou moins spherique, 3-4-(6) cm de diametre, blanc ou rarement se teintant de brun rougeatre ou de mauve au frottement, munit d'un cordon mycelien et d'une touffe de rhizoides a la base. L'eclosion commence generalement dans les premieres heures de la journee par la rupture du peridium sous la poussee du carpophore en expansion rapide (2-4 heures selon la temperature ambiante en zone subtropicale). Chapeau conique, 1,5-4 cm, nettement distinct du stipe, fortement reticule en relief, formant des crateres qui retiendront la gleba, rappelant a la fois les alveoles des morilles et les mailles de son indusie qui en sera bientot le prolongement. Sommet perce d'un meat circulaire, parfois saillant.
Chair : brun verdatre a vert glauque, olive fonce, tres visqueuse, epousant etroitement le relief du chapeau reticule-alveole, a odeur nauseabonde et incommodante.
Stipe : cylindrique, 15-20-(25) cm x 1,5-3 cm, blanc, poreux et tubulaire, de consistance spongieuse, fait de 2 ou 3 couches de cellules aerees, aussi leger que du polystyrene. Sa vitesse de croissance est de 1-2 mm par minute selon la temperature et humidite ambiante. Le tricotage de l'indusie emerge du bord du chapeau, sous la gleba, pour descendre en cloche grillagee de dentelle blanche, jusqu'au contact du sol. Sa vitesse de croissance est de 2-4 mm/mn.
Habitat : Thermophile et tropical, Afrique, Asie, Amerique du Sud, Australie, en juin et en automne au Japon, peu commun a rare, isole ou en troupe, sous bambous ou ruderal. Les recoltes rapportees des regions europeennes sont a prendre avec des pincettes, elle appartiennent generalement a d'autres especes, mais il n'est pas impossible de la retrouver dans des serres chauffees.
Spores : 2-3 x 1-1,5 µm, ovales a elliptiques, etroites, lisses, hyalines.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Consomme en Chine.

Synonymes : Agaricus rubrotinctus Peck (1884) [1882], Annual report of the New York state Museum of natural history, 35, p. 155 (basionyme)
Lepiota rubrotincta (Peck) Peck (1891) [1890], Annual report of the New York state Museum of natural history, 44, p. 67
Lepiota tonkinensis Patouillard (1892), Bulletin de la Societe mycologique de France, 8(2), p. 46
Mastocephalus carneoannulatus Clements (1896), Botanical survey of Nebraska, 4, p. 17
Lepiota carneoannulata (Clements) Saccardo (1899), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 14, p. 67
Leucoagaricus rubrotinctus (Peck) Singer (1948), Sydowia : Annales mycologici, editi in notitiam scientiae mycologicae universalis, series II, 2(1-6), p. 36 (nom actuel)
References : DM Hors Serie N° 3 p. 100 ; FAMM 21 p.1, 19-23 ; IH1 251 ; IOH p. 184
Groupe : Lepiotes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Agaricaceae
Chapeau/Fructification : Chapeau mesurant (1,5) 2-2,5 (3) cm de diametre, campanule-convexe, mamelonne, lubrifie au disque, squameux, surtout vers la peripherie, de couleur brun rouge a cuivre orange, toujours plus intense au niveau du mamelon central, mais avec l'age, s'eclaircissant en beige clair, ou blanchatre vers la marge qui est rimeuse, fissuree.
Lames/Pores : Lames libres, epaisses, blanches, ventrues avec partie la plus large centrale ou plus proche du stipe, plus ou moins serrees, a aretes floconneuses parfois rosees,
Chair : blanche, de saveur douce, d'odeur banale ou nulle.
Stipe : Stipe mesurant 3-4,5 x 0,2-0,4 cm, cylindro-clave a base epaissie, legerement bulbeuse, blanc, soyeux. Anneau ascendant, situe sur la moitie superieure du stipe, blanchatre, plus ou moins borde de brun-rouge.
Habitat : Espece thermophile, poussant dans les lieux riches en humus dans les bois, jardins, bambouseraie, bord des routes, serres. Amerique du Nord, Japon, littoral mediterraneen. Saprophyte. En France, dans les jardins publics de la digue d'Orry en bordure de la riviere Tet, altitude 2530 m, Perpignan (Pyrenees orientales, France). Quatre recoltes sur terre nue, et une sur une pelouse le 23.09.2001, 4 exemplaires sous chenes pubescents (Quercus pubescens) ; ii) le 25.09.2001, 1 exemplaire sous noisetier (Corylus avellana) ; iii) Le 03.10.2001, 1 exemplaire sous chenes verts (Quercus ilex) et chenes pubescents ; iv) le 13.10.2001, 1 exemplaire sous lauriers-tins (Viburnum tenus). Exsiccatum Herbier NEVILLE 02.01.04.05.
Spores : Spores mesurant (6) 7-9 (10) x 5-6 µm, a paroi epaisse, lisses, hyalines, dextrinoides, elliptiques, a sommet plus ou moins etire, subpapille a citriforme, sans pore germinatif, et avec un apicule net (fig. 1A). Basides mesurant 40-30 x 8-11 µm, tetrasporiques et clavees. Cheilocystides mesurant 20-30 (47) x 7-10 (12) µm, tres nombreuses, clavees, mais souvent egalement fusiformes ventrues, subcylindriques ou spheropedonculees, portant presque toutes a leur sommet de petits cristaux plus ou moins nombreux (fig. 1B). Pleurocystides absentes.
Comestibilite : Sans interet
Pas de photo disponible
Synonymes : Tylopilus neofelleus Hongo (1967), Journal of Japanese botany, 42, p. 154 (Basionyme)
Tylopilus felleus ss. Kawamura (1929)
Tylopilus plumbeoviolaceus ss. Hongo (1960)
References : JJB 42 p. 154-155 ; Bull. natn. Sci. Mus., Tokyo 16 no. 3 p. 553-554 (1973, 3eme exploration de la Nouvelle-Guinee) ; IH2 566
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 6-11 cm, pulvine a convexe, puis plus ou moins etale, marge incurvee dans la jeunesse, surface seche, veloutee, finement tomenteuse, couleur brun noisette olivace a bronze.
Lames/Pores : Tubes adnes puis adnexes, deprimes autour du stipe, blanchatres puis incarnat vineux a rosatres, 6-12 mm de long x 1,5 de diametre; pores couleur de faon, (Magenta grisatre, rouge Rubis grisatre ou plus pales pour les recoltes de Nouvelle-Guinee), minuscules et arrondis dans la jeunesse, puis de taille moyenne et subanguleux.
Chair : epaisse, ferme, blanche, immuable, odeur faible a subnulle, saveur amere.
Stipe : 6-11 x 1,5-2,4 cm, epais et solide, souvent epaissi a la base (attenue a la base pour les recoltes de Nouvelle-Guinee), finement tomenteux, brun rougeatre a brun grisatre, ou subconcolore au chapeau (brun fauve olivace), jaune de miel au sommet, plus pale ou blanchatre aux deux bouts, subveloute, non reticule, ou avec un subtil reseau forme de pores descendants sur le sommet (Nouvelle-Guinee), parfois ruguleux. Base a tomentum blanchatre.
Habitat : en ete-automne, dans les bois meles de Pinus densiflora-Quercus serrata au Japon et en Coree du Sud, Catastanopsis-Quercus-Araucaria, etc. en Nouvelle-Guinee.
Spores : Spores en masse rosatre sale a brun vineux, lavees de jaune de miel sous le microscope, (6,5)7,5-9,5 x 3,5-4(4,5) µm, (7-8,5 x 3-3,5 µm pour les recoltes de Nouvelle-Guinee), ellipsoides-subfusiformes; Basides tetrasporiques, 30 x 7,5 µm, cystides nombreuses, 20-50 x 5-7,5 µm, subcylindracees a subfusoides, a paroi mince, jaunatres. Trame bilaterale de type Boletorum. Boucles absentes.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : D'abord endemique de Hondo (Japon), il fut retrouve par Hongo en Nouvelle-Guinee, puis signale de Chine (Sichuan,Yunnan), Coree et Taiwan.

Synonymes : Puccinia corticioides Berkeley & Broome (1878) [1877], The journal of the linnean Society, botany, 16(89), p. 52 (Basionyme)
Puccinia schottmuelleri Hennings (1893), Hedwigia, 32(2), p. 61
Dicaeoma corticioides (Berkeley & Broome) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 468
Stereostratum corticioides (Berkeley & Broome) Magnus (1899), Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, 17, p. 181 (nom actuel)
Groupe : Rouilles
Classification : Basidiomycota / Pucciniomycetes / Pucciniales / Pucciniaceae
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : La "rouille du bambou" appartient au genre monospecifique etabli par Magnus en 1899 a partir de materiel recolte au Japon. Signale en Chine. Nos recoltes venaient sur Nezasa ネザサ(Pleioblastus nezasa), commun au printemps dans l'ouest de Hondo, plus frequent in litt. sur P. simonii, Phyllostachys, Pseudosasa, Sasa, Arundinaria... メダケ

Poria odora Saccardo (1888), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 6, p. 294 (Basionyme)
Poria tschulymica Pilat (1932), Bulletin de la Societe mycologique de France, 48(1), p. 35
Gloeoporus tschulymicus (Pilat) Bondartsev & Singer (1941), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 39(1), p. 52
Incrustoporia tschulymica (Pilat) Domanski (1963), Acta Societatis botanicorum poloniae, 32, p. 737
Skeletocutis tschulymica (Pilat) Jean Keller (1979), Persoonia, 10(3), p. 353
Skeletocutis odora (Saccardo) Ginns (1984), Mycotaxon, 21, p. 332 (nom actuel)
Antrodia odora (Saccardo) Gilbertson & Ryvarden (1985), Mycotaxon, 22(2), p. 363
References : DM 102 p. 47 ; E.P. 2 p. 631 fig. 339
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Incrustoporiaceae
Chapeau/Fructification : Resupine a presque noduleux sur substrats inclines, mou, un peu gelatineux ou cireux et aqueux au frais, souvent retracte en partie au sec, largement etale et jusqu'a 50cm de largeur, 1 cm environ d'epaisseur, marge cotonneuse bien delimitee, sterile au-dessous, blanche a translucide, etroite, 1-3 mm de large.
Lames/Pores : Face unie ou un peu bosselee, blanc sordide, teintee de vert-olive, d'ambre, creme ou beige pale au sec, avec souvent de petites taches decolorees au froissement. Pores anguleux, reguliers au debut, 3 a 6 par mm ( parfois 9), tres minces, laceres, bordes d'une pruine poudreuse blanche, comprimes et fendus en V, plus dentes et irreguliers avec l'age ou au sec, creme olive sordide et d'aspect huileux au sec. Couche des tubes concolore a la face poroide, resineuse et distinctement coloree au sec comparativement au subiculum pale, se fendant sur le long au frais et au sec, 2-10 mm de long.
Chair : Molle, gelatineuse, odeur forte, nauseeuse, acidique, d'ail ou de punaise des plantes au frais. Subiculum blanc aqueux a creme pale, parfois avec quelques zones denses, minces, jusqu'a 1 mm d'epaisseur.
Habitat : Sur bois mort de feuillus et de coniferes, exceptionnellement et accidentellement sur vieux basidiomes morts tel que Phellinus chrysoloma. Agent de carie blanche, molle et humide sur Abies, Alnus, Picea, Populus, Quercus.
Spores : Basidiospores allantoides, lisses, a paroi mince, hyalines, negatives dans le reactif de Melzer, 4-5 x 1-1,5 µm. Basides subcylindriques-claviformes, 4 sterigmates, etranglees a la base, 10-18-(22) x 4,5-5,5µm. Cystides absentes. Cystidioles fusoides, abondantes, a parois minces, lisses, 11-14 x 4-5 µm. Dimitique : (1)- Hyphes generatrices hyalines, ramifiees, a parois minces, larges de 2,5-3,5 µm, septees, bouclees. (2)- Hyphes squelettiques sclerifiees dans le subiculum, hyalines, a parois epaisses, larges de 3-5 µm, bouclees.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Annuel. Peu frequent. Plutot Automnal. Remarque : Circumpolaire en zone boreale-temperee, largement repandu en Europe surtout en Finlande, Suede, Ukraine, extreme Est de Russie, connue en Chine et Japon.

Synonymes : Russula senecis S. Imai (1938), Journal of the Faculty of agriculture Hokkaido university, 43, p. 344 (Basionyme)
R. subfoetens ss. Matsuura 1933
? R. punctipes Singer 1935
? R. illota Romagn. ss. Singer 1975
Russula senis selon Romagn. 1989
References : IH1 587
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 5-10 cm, brun jaunatre, fauve roussatre a ocre sale, Revetement fortement ride, parfois presque cerebriforme, et plus ou moins strie radialement a la peripherie, cutis souvent rompu-fendille a lacere par temps sec et laissant alors apparaitre la chair jaune sale. Brun rougeatre au centre qui est lubrifie et souvent imbu, mais granule-chagrine sous la loupe.
Lames/Pores : sublibres, assez serrees a (6/cm a un cm de la marge), assez epaisses, larges de 0,6-1 cm, blanc jaunatre a beige sordide, tachees de brun rouge ca et la, arete erodee, brun rouille sombre. Reflet vineux-purpurin des taches selon l'incidence.
Chair : odeur faible, saveur acre a tres acre. FeSO4 brun et lent sur le stipe. Gaiac vert bleu sombre tres rapide (moins de 5 secondes). R56 (Dagron) sur lame entiere debute apres 10 secondes, diffuse 20 sec mais restant longtemps limite a la peripherie, n'est terminee qu'en 10 minutes.
Stipe : 5-10 x 1-1,5 cm, subcylindrique, souvent epaissi et courbe a la base, caverneux puis creux, jaune sale, plus ou moins roussatre par detersion.
Habitat : Gregaire et commune en ete-automne en forets a Castanopsis, Quercus etc., rarement sous coniferes. Japon, Nouvelle-Guinee (Hongo 1973), Extreme-orient russe( ? Vassilieva 1973), Coree du Sud (Hongo 1976), Chine (1979).
Spores : globuleuses, 7-5-9 µm, remarquablement ailees de fortes cretes peu connexees. Sporee blanche.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : Comme R. illota, les lames sont ponctuees de brun noir, aussi Henri Romagnesi nous avait prevenu que ce taxon de Imai serait prioritaire sur le sien en cas d'identite... Mais nous avons compare les autres caracteres differentiels, notamment le revetement pileique ride (aspect de vieillard de l'epithete) et plus tourmente, et l'ornementation sporale fortement ailee. Reste en course la punctipes de Singer 1935, recoltee en Chine par Rolf... qui serait aussi la meme espece selon l'auteur americain (1975, 1984).

Synonymes : Colus fusiformis E. Fischer (1890), Neue denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft fur die gesammten naturwissenschaften, 32(2), p. 64 (Basionyme)
Colus javanicus Penzig (1899), Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, 16(2), p. 160, tab. 21, fig. B, tab. 24, fig. 12-14, tab. 25, fig. 2-3
Colus rothae E. Fischer ex Saccardo (1901), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 19, p. 389
Anthurus trifidus Hariot & Patouillard (1902), Bulletin du Museum national d'histoire naturelle, Paris, 8(2), p. 132
Pseudocolus rothae (E. Fischer ex Saccardo) Lloyd (1907), Mycological writings, 2, the phalloids of australasia, p. 20, fig. 21
Pseudocolus javanicus (Penzig) Lloyd (1907), Mycological writings, 2, mycological notes n° 28, p. 358
Pseudocolus rugulosus Lloyd (1909), Mycological writings, 3, synopsis of the known phalloids, p. 52, fig. 67
Pseudocolus fusiformis (E. Fischer) Lloyd (1909), Mycological writings, 3, synopsis of the known phalloids, p. 53, fig. 68 (nom actuel)
Colus schellenbergiae Sumstine (1916), Mycologia, 8(3), p. 183
Pseudocolus jaczewskii Woronow (1918), Izviestiia Kavkazskago Muzeia, 11, p. 196
Pseudocolus schellenbergiae (Sumstine) Johnson (1929), Ohio Biological Survey, 22, p. 338
Anthurus rothae (E. Fischer ex Saccardo) G. Cunningham (1931), Proceedings of the linnean Society of the New South Wales, 56(3), p. 188, tab. 8, fig. 9
Anthurus javanicus (Penzig) G. Cunningham (1931), Proceedings of the linnean Society of the New South Wales, 56(3), p. 186
Pseudocolus javanicus f. schellenbergiae S. Ito & S. Imai (1937), Transactions of the Sapporo natural history Society, 15, p. 3
References : IH2 898 ; IOH p. 516
Groupe : Phalles
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Phallales / Phallaceae
Chapeau/Fructification : Jaune pale au stade d'œuf; gelatineux a l'interieur, avec des rhizomorphes blancs attaches a la base. A maturite, developpe une fructification 2,5-8 cm de hauteur, composee de 3-5 tentacules effiles divergents d'une racine commune.
Habitat : Saprophytes, solitaire ou en groupe a la lisiere des bois, ou dans les parcs et jardins; commun dans diverses localites de l'Est Amerique du Nord, Japon, Coree en ete et automne.
Spores : 4,5-5,5 x 2-2,5 μm, elliptiques a ovoides, lisses.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Le nom japonais fait reference a la ressemblance avec le Vajra, arme du dieu Indra, instrument et symbole du culte hindouiste.

Synonymes : Pleurotus salmoneostramineus Lj.N. Vassiljeva (1973), Agarikovje shlyapochnye griby, primorskogo Kraya, p. 85 (Basionyme)
References : IH1 5 ; CD 150 ; IOH p. 17 ; DM 100 p. 242-243 ; FMDS 129 p. 5-7
Groupe : Pleurotes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Pleurotaceae
Chapeau/Fructification : 4-14 cm, d'abord convexe conchoide, puis spatuliforme a reniforme en s'etalant, plus ou moins deprime et festonne vers la fin, a cuticule lisse de couleur rose saumone, plus ou moins prononcee, nuance de jaune-paille pale par endroits. Marge incurvee et souvent fortement ondulee, de couleur nettement plus pale, voire blanchatre.
Lames/Pores : etroites et serrees, decurrentes, a nombreuses lamelles et lamellules, subconcolore au chapeau, jaune paille pale a rosatre saumone (inde nomen).
Chair : assez epaisse, douce, aromatique a vaguement farineuse
Stipe : excentre, tres court ou rudimentaire et coude, subconcolore.
Habitat : ete-automne sur souches et branches mortes de feuillus divers et arbustes d'agrement, souvent parasite de blessure.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Note sur les recoltes japonaises: Vient sur saules, peupliers, charmes... ici fructifiant sur blessure d'un tronc de glycine. Facile a cultiver, cf. Japan Times 94-97 et G. Fourre et D. Guez in Bull. Feder. Mycol. Dauphine-Savoie 129 p. 5-7, cette espece n'est plus commercialisee au Japon en raison de sa couleur dissuasive et sa comestibilite douteuse.

Peziza harmoge Berkeley & Broome (1873) [1875], The journal of the linnean Society, botany, 14(74), p. 104
Peziza cordovensis Cooke (1875), Hedwigia, 14(6), p. 81
Helotium purpuratum Kalchbrenner (1880), in Thumen, Mycotheca universalis, centurie 17, n° 1614
Phillipsia kermesina Kalchbrenner & Cooke (1880), Grevillea, 9(49), p. 25
Phillipsia domingensis (Berkeley) Berkeley (1881), The journal of the linnean Society, botany, 18(111), p. 388 (nom actuel)
Phillipsia polyporoides Berkeley (1881), The journal of the linnean Society, botany, 18(111), p. 388
Phillipsia subpurpurea Berkeley & Broome (1883), The transactions of the linnean Society of London, series 2, 2(3), botany, p. 69
Geopyxis harmoge (Berkeley & Broome) Saccardo (1889), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 8, p. 65
Otidea domingensis (Berkeley) Saccardo (1889), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 8, p. 97
Calycina purpurata (Kalchbrenner) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 448
Phillipsia chardoniana Seaver (1925), Mycologia, 17(2), p. 48
Phillipsia gigantea Seaver (1926), The North American cup-fungi (operculates), p. 183
Molliardiomyces domingensis Paden (1984), Canadian journal of botany, 62(3), p. 214
References : Pezizales du Costa-Rica
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Pezizomycetes / Pezizales / Sarcoscyphaceae
Chapeau/Fructification : Fructification "pezizale" en forme de disque de 0,5 a 7,5 cm de diametre. Surface fertile lisse, rouge vif a rouge vineux ; face inferieure, lisse, blanc a blanc creme rose.
Chair : Coriace, solide, blanche ; saveur et odeur indistinctes.
Stipe : Dans certains cas, de 1,5 cm de long, et de 0,6 cm de large, blanc-creme.
Habitat : Sur bois pourri.
Spores : Asques octospores. Ascospores 24-28 x 11-14 a extremites pointues et remarquablement marquees par 3 a 5 stries longitudinales.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Pas rare. De Mai a Decembre. Espece des Iles Caraibes,de Guyane, Mexique, Afrique, Australie, Japon.

Synonymes : Clitocybe fallaciosa Malencon (1959), Comptes rendus des seances mensuelles de la Societe des sciences naturelles et physiques du Maroc, 1, p. 23 (nom. illegit.)
Clitocybe amoenolens Malencon (1975), Flore des champignons superieurs du Maroc, 2, p. 138, pl. 9, fig. 21 (basionyme)
Paralepistopsis amoenolens (Malencon) Vizzini (2012), Mycotaxon, 120, p. 257 (nom actuel)
References : BMBDS 149 p. 11-14 ; DM Memoire Hors Serie N° 4 : Clitocybes, Omphales et ressemblants ; Moreau P.-A. et coll. Analyse taxonomique d'une espece toxique: Clitocybe amoenolens Malencon, Cryptogamie, Mycologie 2001:22 p. 1-23 ; Eyssartier et Roux p. 574, 590 4eme edition, CD 35, 111
Groupe : Clitocybes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Incertae sedis
Chapeau/Fructification : 4-7 cm, d'abord hemispherique, puis convexe a plan-convexe, enfin largement deprime, mais jamais creuse en entonnoir, a marge longtemps enroulee, courtement cannelee par l'empreinte des lames, non hygrophane. Revetement legerement visqueux par temps humide, mat-givre chez les jeunes puis finement dissocie en ecailles plus ou moins redressees, roussissantes depuis l'extremite jaune-ocre clair a brun jaunatre, puis roussissant fortement a partir du centre, parfois brun rougeatre dans la vieillesse, presque toujours taches de guttules plus sombre vers le centre, la marge longtemps givree-pruineuse.
Lames/Pores : moyennement serrees, 40-55, l (3) lamellules, larges de 2-3 mm, decurrentes, nettement delimitees en haut du stipe, separables quelques heures apres la recolte mais pas sur le frais, creme blanchatre puis ochrace pale, concolores au chapeau chez les jeunes; arete entiere, concolore.
Chair : assez epaisse et un peu elastique dans le chapeau, fibreuse dans le pied, creme jaunatre pale a isabelle. Saveur fongique-subfarineuse, aprescente sur le tard. Odeur forte, aromatique, agreable, irinee, de seringat ou de jasmin, rappelant Tricholoma caligatum ou Inocybe bongardi, ecœurante a la longue.
Stipe : 2-5 x 0,4-1,2 cm, subcylindrique, parfois attenue en haut ou en bas, ou un peu renfle a la base, finement pruineux au sommet, creme ochrace, tache de roussatre a la fin; base profondement enfouie dans la litiere, a mycelium blanc, cotonneux, dense, agglomerant les aiguilles. Reaction jaunatre a KOH sur le revetement pileique (decoloration du pigment intracellulaire).
Habitat : Epicea, Meleze,
Spores : 4,3-4,97-5,6 x 3,0-3,48-4,0 µm. Q = 1,43, V =64 µm3, ovo-elliptiques a subglobuleuses, parfois un peu ovoides, a apicule tronque de 0,5-0,7 de long, lisses en microscopie optique, a paroi de 0,2 µm d'epaisseur, a couche externe tres mince, legerement cyanophile; contenu uniguttule, a cytoplasme legerement cyanophile; spores uninucleees.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : En 1996, 5 personnes ont presente une erythermalgie 24 heures apres l'ingestion de champignons pris pour Lepista inversa (Scop.) Pat. Un collectif de 7 cas a ete reuni. Les symptomes (douleurs, brulures) evoluaient par paroxysmes, etaient calmes uniquement par des bains d'eau glacee, resistaient au traitement, et ont persiste plusieurs semaines. Ils etaient accompagnes d'un erytheme au moment des crises, et parfois d'un œdeme. L'exploration immunologique, toxicologique et de l'etat inflammatoire etait negative. L'electromyogramme a montre a 3 reprises de discretes lesions axonales. Ces troubles persistent de quelques jours a quelques mois. Il n'y a pas de signe digestif, pas d'atteinte hepatique ou renale. Ce syndrome a deja ete decrit au Japon pour le Paralepistopsis acromelalga denomme localement "champignon aux brulures" et serait du a une atteinte des fibres non myelinisees du systeme nerveux autonome par l'acide acromelique A(AA-A). References : 1- Nakamura K., Shoyama F, Toyama J., Tateishi K., "Empoisonnement par le Dokou-sassa-ko" Japanese J. Toxicol. 1987 ; 0 : 35-9. 2- Konno K., Hashimoto K., Ohfune Y., Shirahama H., Matsumoto T., Acromelic acids A and B. Potent neuroexcitatory amino acids isolated from Clitocybe acromelalga. J. Am. Chem. Soc. 1988 ; 110 : 4807-15. 3- Bessard J. et coll. Mass spectrometric determination of acromelic acid A from a new poisonous mushroom: Clitocybe amoenolens. 4 - Moreau P.-A. et coll. Analyse taxinomique d'une espece toxique : Clitocybe amoenolens Malencon. Cryptogamie, Mycologie 2001:22:1-23 L'administration per os de Clitocybe amoenolens a 4 rats a montre une perte de poids, et chez les 2 rats les plus doses une prostration, des troubles locomoteurs du train posterieur et un erytheme des pattes. L'examen en microscopie electronique des nerfs sciatiques a objective des lesions axonales et myeliniques (J4¡). Conclusion : Une nouvelle etiologie toxique d'erythermalgie a ete mise en evidence. La toxicite de Clitocybe amoenolens a ete confirmee. Il est recommande de ne plus consommer Lepista inversa, Lepista gilva et Clitocybe gibba avec lesquels il peut etre confondu.

Synonymes : Mucidula venosolamellata Imazeki & Toki (1955), Bulletin of the government forest experimental station Meguro, 79, p. 1 (Basionyme)
Oudemansiella venosolamellata (Imazeki & Toki) Imazeki & Hongo (1957), Journal of Japanese botany, 32, p. 146
Mucidula mucida var. venosolamellata (Imazeki & Toki) R.H. Petersen (2010), Beihefte zur Nova Hedwigia, 137, p. 265 (nom actuel)
References : IH1 152
Groupe : Collybies
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Physalacriaceae
Chapeau/Fructification : 2-6 cm, hemispherique puis plan-convexe,tres putrescible et revetu de mucus, teinte de brun grisatre au disque dans la jeunesse, puis presque entierement blanc.
Lames/Pores : echancrees-adnees, larges, espacees, sinueuses anastomosees, parcourues de nombreuses veines longitudinales ou interveinees.
Chair : mince, blanchatre ou grisatre
Stipe : 1,5-4 x 0,3-1 cm
Habitat : sur bois de Fagus, du printemps a l'automne. Japon (endemique?)
Spores : 18,5-25,5 x 14-23 µm
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Tricholoma giganteum Massee (1912), Bulletin of miscellaneous information - Royal botanic Gardens, Kew, 1912(6), p. 254 (Basionyme)
Tricholoma lobayense R. Heim (1970) [1969], Revue de mycologie, Paris, 34(4), p. 346
Tricholoma spectabilis Peerally & Sutra (1972), Revue Agricole et Sucriere de l'ile Maurice, 51(3), p. 142
Macrocybe gigantea (Massee) Pegler & Lodge (1998), Mycologia, 90(3), p. 497 (nom actuel)
Macrocybe lobayensis (R. Heim) Pegler & Lodge (1998), Mycologia, 90(3), p. 498
Macrocybe spectabilis (Peerally & Sutra) Pegler (1998), Mycologia, 90(3), p. 499
References : TMSJ 22 p. 181-185 (1984) ; IH1 97 ; IOH p. 75
Groupe : Tricholomes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Biannulariaceae
Chapeau/Fructification : 12-32 cm, d'abord convexe, puis plan et plus ou moins deprime avec une marge dressee, parfois largement umbonne; revetement presque glabre, beige, gris-beige, ivoire ou mastic, rarement devenant brun a brun fonce dans les blessures avec l'age. Marge longtemps involutee, souvent sinueuse avec l'age.
Lames/Pores : assez serrees, adnees-emarginees a sinuees, tres etroites chez le jeune, puis jusqu'a 2 cm de large; marge erodee. Couleur mastic puis jaune paille.
Chair : blanche, ferme, epaisse au disque, douce. Odeur plus ou moins farineuse.
Stipe : 12-47 cm de hauteur, epaisseur de 1-3,5 cm au sommet, 1,5-7 (-12)cm a la base, cylindrique a subclave (surtout les jeunes), connes ou cespiteux a la base. Revetement fibrilleux-rugueux, glabre a un peu floconneux, concolore, sur fond blanchatre.
Habitat : Vient en grosses touffes tres denses. Affectionne les pentes terreuses nues, les friches et jacheres (canne a sucre) ou sous feuillus. Inde, Ile Maurice, Japon (Kyushu, Okinawa).
Spores : blanches en masse, 5-7,5 x 3,5-5 µm, ovoides a largement ellipsoides, a paroi mince, lisse, souvent avec une guttule, non-amyloides, non cyanophiles. Basides tetrasporiques, 25-37,5 x 6-7,5 µm, etroitement clavees, granulations carminophiles absentes. Acystidie.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Decrit par Massee depuis l'Inde en 1912, puis de l'ile Maurice et du Nigeria par Heim, Peerally et Sutra, enfin recoltee regulierement au sud du Japon depuis 1978, cette espece de tres grande taille et relativement elancee, a ete recombinee en 1998 dans le genre Macrocybe. Cultivee depuis peu en Inde, Chine, Japon. Aurait des proprietes anti-tumorales...

Synonymes : Phallus mokusin Cibot (1775), Novi commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae, serie 2, 19, p. 373, tab. 5 (Basionyme) Sanctionnement : Persoon (1801)
Lysurus mokusin (Cibot) Fries (1823), Systema mycologicum, 2(2), p. 6 (nom actuel)
Clathrus mokusin (Cibot) Sprengel (1827), Systema vegetabilium, Edn 16, 4(1), p. 499
References : FAMM 11 p. 10-13 ; CD 1751 ; IH2 897 ; DM 100 p. 265 ; IOH 515 ; Kinoko Field Book p. 277
Groupe : Phalles
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Phallales / Phallaceae
Chapeau/Fructification : D'abord un œuf blanc, 1-3,5 cm, de consistance gelatineuse, d'ou s'erige, a l'eclosion, une tige a base quadrangulaire ou polygonale portant 3-7 bras, le plus souvent reunis en pointe de fleche au sommet, parfois s'ecartant a maturite, evoquant une pince a glace (a griffes), ou une lanterne de jardin, selon la cohesion des bras.
Chair : Gleba sur la face interieure des bras. Nauseabonde (excrements, vase...)
Stipe : 10-15 x 1,5-2,5 cm, spongieux blanc rosatre, rose saumone a rouge orange, forme de 4 a six cotes aux aretes saillantes, plus ou moins rainures longitudinalement.
Habitat : Espece penetropicale asiatique (Chine, Japon, Coree), introduite et invasive en Australie, Ameriques, Europe... venant isolee ou eparse en juin (ou saison des pluies), ou tardif et en groupe sur chablis d'ecorce, etc. Helio-thermophile au bord des sentiers, bambouseraies, jardins etc.
Spores : 4-6 x 2-2,5 µm, cylindriques, hyalines, lisses, a parois minces, avec appendice hilifere au SEM. Basides 7-8 spores.
Comestibilite : Sans interet
Pas de photo disponible
Mycena acutoconica Clements (1893), Botanical survey of Nebraska, 2, p. 38 (Basionyme)
Hygrophorus persistens (Britzelmayr) Britzelmayr (1893), Botanisches centralblatt, 54, p. 98, fig. 64, 75-77
Prunulus acutoconicus (Clements) Murrill (1916), North American flora, 9(5), p. 330
Hygrocybe californica Murrill (1916), North American flora, 9(5), p. 382 ('Hydrocybe ')
Hygrophorus californicus (Murrill) Murrill (1917), Mycologia, 9(1), p. 40
Hygrocybe constans J.E. Lange (1923), Dansk botanisk arkiv, 4(4), p. 24 (nom. illegit.)
Hygrocybe langei Kuhner (1927), Le Botaniste, 18, p. 175
Hygrophorus rickenii Maire (1930), Bulletin de la Societe mycologique de France, 46(3-4), p. 220
Hygrophorus conicus subsp.* rickenii(Maire) Maire (1933), Treballs del Museu nacional de ciencies naturals de Barcelona, serie botanica, 15(2), p. 56
Hygrophorus subruber (Murrill) Murrill (1939), Bulletin of the Torrey botanical Club, 66, p. 160
Hydrocybe subrubra Murrill (1939), Bulletin of the Torrey botanical Club, 66, p. 159 ('subruber ')
Hygrocybe persistens (Britzelmayr) Singer (1940), Revue de mycologie, Paris, 5, p. 8
Hygrophorus acutoconicus (Clements) A.H. Smith (1947), North American species of Mycena, p. 472
Hygrocybe acutoconica (Clements) Singer (1951) [1949], Lilloa, 22, p. 153 (nom actuel)
Hygrophorus langei (Kuhner) A. Pearson (1952), Transactions of the British mycological Society, 35(2), p. 105
Hygrocybe amoena f. pratensis R. Haller Aar. & Metrod (1955), Schweizerische zeitschrift fur pilzkunde, 33(3), p. 35
Hygrocybe amoena f. sylvatica R. Haller Aar. & Metrod (1955), Schweizerische zeitschrift fur pilzkunde, 33(3), p. 35
Hygrophorus acutoconicus f. japonicus Hongo (1956), Journal of Japanese botany, 31, p. 145
Hygrocybe acutoconica f. japonica Hongo (1959), in S. Ito, Mycological Flora of Japan, 2(5), p. 75
Hygrophorus subglobisporus P.D. Orton (1960), Transactions of the British mycological Society, 43(2), p. 267
Hygrophorus acutoconicus var. microsporus Hesler & A.H. Smith (1963), North American species of Hygrophorus, p. 139
Hygrocybe subglobispora (P.D. Orton) M.M. Moser (1967), Kleinen kryptogamenflora von mitteleuropa, band 2b/2, Edn 3, p. 67
Hygrocybe aurantiolutescens P.D. Orton (1969), Notes from the royal botanic Garden, Edinburgh, 29(1), p. 103
Hygrocybe aurantiolutescens f. pseudoconica Bon (1976), Documents mycologiques, 6(24), p. 42
Hygrocybe konradii var. pseudopersistensBon (1978), Documents mycologiques, 8(30-31), p. 69
Hygrocybe konradii f. pseudopersistens(Bon) Arnolds (1985), Persoonia, 12(4), p. 476
Hygrocybe subglobispora f. aurantiorubraArnolds (1985), Persoonia, 12(4), p. 477
Hygrocybe persistens var. langei(Kuhner) Bon (1987), Documents mycologiques, 18(69), p. 35
Hygrocybe konradii f. albidifoliaBon (1988), Documents mycologiques, 18(72), p. 63
Hygrocybe aurantiolutescens var. subconica Bon (1989), Documents mycologiques, 19(75), p. 55
Hygrocybe persistens f. subglobispora (P.D. Orton) Boertmann (1995), Fungi of Northern Europe, 1, p. 156
Hygrocybe acutoconica f. subglobispora (P.D. Orton) Boertmann (1995), Fungi of Northern Europe, 1, p. 166
Hygrocybe acutoconica var. microspora (Hesler & A.H. Smith) S.A. Cantrell & Lodge (2000), Mycological research, 104(7), p. 878
Hygrocybe persistens var. subglobispora (P.D. Orton) Krieglsteiner (2000), Beitrage zur kenntnis der pilze mitteleuropas, 13, p. 30
Hygrocybe konradii f. bispora Bon & Lefebvre (2000), Documents mycologiques, 30(119), p. 23
Hygrocybe persistens var. pallidocarneaD. Antonini & M. Antonini (2002), Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti, 22, p. 11
Hygrocybe acutoconica var. pallidocarnea(D. Antonini & M. Antonini) Becerra & Robles (2012), Boletin de la Sociedad micologica de Madrid, 36, p. 136
Groupe : Hygrophores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Hygrophoraceae
Pas de photo disponible
Boletellus japonicus (Hongo) L.D. Gomez (1997) [1996], Revista de biologia tropical, International journal of tropical biology and conservation, 44 (suppl. 4), p. 71
Heimioporus japonicus (Hongo) E. Horak (2004), Sydowia : An international journal of mycology, 56(2), p. 238 (nom actuel)
Boletellus retisporus (Pat. & Baker) Sing. ss. Hongo, non Pat. & Baker;
References : IH1 515 ; IOH p. 355
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 5-8 cm de diametre, d'abord hemispherique puis convexe a plan-convexe. Marge legerement saillante aigue sans etre excedante. Surface lisse, un peu lubrifiee par temps humide, mais finement veloutee sur le sec, rouge fonce a rouge brunatre, legerement lave de violet.
Lames/Pores : Tubes adnes a libres, deprimes autour du stipe, d'abord jaune citrin, puis olivatres, immuables; pores concolores aux tubes, ronds ou presque anguleux, 0,5-1 mm de diametre, immuables.
Chair : jaune pale, legerement teintee de rouge a la base du stipe, immuable au froissement ou tres legerement bleuissante.
Stipe : Stipe 6-13 x 0,7-1,2 cm, souvent renfle a la base qui peut atteindre 3 cm, plein. Revetement concolore au chapeau, le sommet souvent teinte de jaune, couvert d'asperites granuleuses, orne presque entierement d'un reseau en filet tres net et dense, la paroi de la jonction entre les mailles etant elle)meme couvertes de granules et mechules dressees.
Habitat : Solitaire a gregaire en ete-automne, a terre dans les forets de Pinus densiflora et Quercus serrata au Japon, sous Melaleuca, Allocasuarina, Eucalyptus et Leptospermum en Australie. Signale en Chine (couvert non documente).
Spores : Sporee olivatre. Spores elliptiques 9,5-15 x 7-8 µm, fortement ornees d'un reticulum parietal.
Comestibilite : Inconnu

Synonymes : Gyroporus longicystidiatus Nagasawa & Hongo (2001), Reports of the Tottori Mycological Institute, 39, p. 18 (basionyme)
References : RTMI 39 p. 1-27 Nagasawa, E. 2001. Taxonomic studies of Japanese boletes. I. The genera Boletinellus, Gyrodon and Gyroporus.
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Gyroporaceae
Chapeau/Fructification : Mesurant jusqu'a 8 cm, largement convexe a presque plan avec l'age, revetement tomenteux a floconneux-squamuleux, brun clair a brun, devenant brun orange a brun grisatre vers la marge, souvent tache ca et la de brun jaunatre. Marge legerement revolutee chez les vieux carpophores.
Lames/Pores : Minuscules, 2-3/mm, concolores aux tubes, avec des taches de bronze ca et la dans la vieillesse. Tubes relativement courts, jusqu'a 8 mm de long, emargines-adnexes a libres, d'abord blancs, puis jaune pastel a la maturite.
Chair : Blanche, lavee d'orange grisatre sous la surface, immuable dans les blessures, la couche corticale plutot dure, jusqu'a 8 mm d'epaisseur dans le chapeau, caverneuse et vite creuse dans le stipe. Odeur et saveur indistinctes.
Stipe : Mesurant jusqu'a 7,5 × 1,3 cm, et 2,8 cm a la base clavee, spongieux-farci, puis creux, surface seche, rugueuse-raboteuse, subtomenteuse a mate subfibrilleuse, plus pale que le chapeau, ou presque concolore integralement, mais le plus souvent teinte de blanchatre a orange pale au sommet.
Habitat : De juillet a debut octobre, dans les bois de feuillus persistants, avec Castanopsis cuspidata, C. cuspidata-Abies firma, Quercus glauca-Q. acutissima, Pinus thunbergii, ou Fagus crenata-Q. crispula. Japon (Hondo).
Spores : Sporee jaune pale sur le frais. Spores 7,2-9,6 × 4,8-6 µm, elliptiques a plus ou moins oblongues, parfois subreniformes de profil, lisses, a paroi d'epaisseur variable, a grosse guttule huileuse, jaune pale in KOH, non-amyloide, parfois dextrinoides. Cheilocystides typiquement fusiformes a lageniformes, 30-126 × 8-18 µm, rarement elliptiques (16-36 × 10-16 µm), lisses, a paroi mince. Pleurocystides nulles.
Comestibilite : Inconnu

Synonymes : Agaricus iocephalus Berkeley & M.A. Curtis (1853), The annals and magazine of natural history, series 2, 12, p. 420 (basionyme)
Mycena iocephala (Berkeley & M.A. Curtis) Saccardo (1887), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 5, p. 282
Marasmius iocephalus (Berkeley & M.A. Curtis) Pennington (1915), North American flora, 9(4), p. 271
Collybia iocephala (Berkeley & M.A. Curtis) Singer (1946), Lloydia, 9, p. 116
Gymnopus iocephalus (Berkeley & M.A. Curtis) Halling (1997), Mycotaxon, 63, p. 364 (nom actuel)
References : IH1 136
Groupe : Collybies
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Omphalotaceae
Chapeau/Fructification : 2-2,5 cm, d'abord convexe avec la marge involutee, bientot plan-convexe puis etale a marge plus ou moins lobee-ondulee; surface humide au toucher, bientot seche et palissante, glabre, finement fibrilleuse sous la loupe, ruguleuse plissee a striee dans la region discale; teinte violette a rouge violace grisatre, lilas vineux ou violet vineux, puis palissant jusqu'au lilas rosatre ou grisatre.
Lames/Pores : Lames adnees, assez serrees, etroites (1 mm), violet rougeatre.
Chair : Chair tres mince, moins d'un millimetre, concolore avec le disque du chapeau. Odeur penetrante desagreable, alliacee ou de choucroute, de poudre a canon, sensible a plusieurs metres a l'entour. Saveur legerement nauseeuse, rappelant l'odeur. Reaction turquoise a la potasse.
Stipe : (2-)3-5(7) x 0,2-0,3(-0,5) cm, egal ou attenue au sommet, creux, flexible a tenace; surface violacee vineuse en haut, plus terne vers le bas, entierement couvert d'une pubescence blanchatre, la base enrobee d'un tomentum fibrilleux.
Habitat : Ete-Automne. Espece saprophyte, dispersee a subcespiteuse sur la litiere de feuilles et debris ligneux. Amerique du Nord (partie orientale), Afrique centrale (Togo), Japon.
Spores : Sporee blanche, spores ovoides-larmiformes, 5,5-9 x 2,5-4,5 µm, non amyloides.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Sect. Iocephalae Singer ex Halling, Mycologia Mem. 8: 32. 1983 = Chapeau avec pigments violets, devenant bleu aux alcali. Cette espece est unique dans le genre par ses couleurs violettes dans tout le champignon, la pubescence du stipe et l'odeur desagreable.

Synonymes : Septoria pinea P. Karsten (1884), Hedwigia, 23(4), p. 58
Brunchorstia destruens Erikss. (1891), Botan. Centralbl., 47, p. 298
Scleroderris abietina Ellis & Everh. (1897), Am. Nat., 31, p. 427
Excipulina pinea (P. Karsten) Hohn. (1903), Annls mycol., 1(6), p. 526
Crumenula abietina Lagerberg (1913), Svenska skogsvardsforeningens tidskrift, 10, p. 204 (basionyme)
Brunchorstia pinea (P. Karst.) Hohn. (1915), Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1, 124, p. 143
Crumenula pinea (P. Karsten) Ferd. & C.A. Jorg. (1939), Skovtraeernes Sygdomme, 2, p. 196
Scleroderris abietina (Lagerberg) Gremmen (1953), Acta botanica Neerlandica, 2(2), p. 234 (nom. illegit.)
Scleroderris lagerbergii Gremmen (1955), Sydowia : Annales mycologici, editi in notitiam scientiae mycologicae universalis, series II, 9(1-6), p. 232
Ascocalyx abietina (Lagerberg) Schlapfer-Bernhard (1969) [1968], Sydowia : Annales mycologici, editi in notitiam scientiae mycologicae universalis, series II, 22(1-4), p. 44
Gremmeniella abietina (Lagerberg) M. Morelet (1969), Annales de la Societe des Sciences Naturelles et d'Archeologie de Toulon et du Var, 183, p. 9 (nom actuel)
Lagerbergia abietina (Lagerberg) J. Reid ex Dennis (1971), Kew bulletin, 25(2), p. 350
Brunchorstia pinea var. cembrae M. Morelet (1980), Eur. J. For. Path., 10(5), p. 272
References : Dennis p. 156
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Leotiomycetes / Helotiales / Godroniaceae
Habitat : Phytopathogene au stade asexue. Sur brindilles au stage sexue. Sur Pinus spp. (pins), mais aussi Abies (sapins), Picea spp. (epiceas), Larix leptolepis (meleze du Japon) et Pseudotsuga menziesii (sapin de Douglas).
Spores : Triseptees.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Boletus laricis Jacquin (1778), Miscellanea austriaca, 1, p. 172, tab. 20-21
Agaricus laricis (Jacquin) Lamarck (1783), Encyclopedie methodique, Botanique, 1, p. 50
Boletus officinalis Villars (1789), Histoire des plantes de Dauphine, 3(2), p. 1041 (basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Boletus purgans J.F. Gmelin (1792), Systema naturae, Edn 13, 2, p. 1436
Agaricus purgans (J.F. Gmelin) Paulet (1808) [1793], Traite des champignons, 2, p. 101, tab. 15, fig. 1-3
Polyporus officinalis (Villars) Fries (1821), Systema mycologicum, 1, p. 365
Polyporus laricis (Jacquin) Delle Chiaje (1824), lconografia ed uso delle piante medicinali, tab. 66, fig. 3
Boletus agaricum Pollini (1824), Flora veronensis quam in prodomum florae italiae septentrionalis, 3, p. 613
Piptoporus officinalis (Villars) P. Karsten (1882), Bidrag till kannedom af Finlands natur och folk, 37, p. 45
Cladomeris officinalis (Villars) Quelet (1886), Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium, p. 168 ('cinalis')
Leptoporus officinalis (Villars) Quelet (1888), Flore mycologique de la France et des pays limitrophes, p. 387
Ungulina officinalis (Villars) Patouillard (1900), Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hymenomycetes, p. 103
Fomes laricis (Jacquin) Murrill (1903), Bulletin of the Torrey botanical Club, 30(4), p. 230
Fomes albogriseus Peck (1903), Bulletin of the Torrey botanical Club, 30(2), p. 97
Fomes officinalis (Villars) Bresadola (1914), in J. Neuman, Wisconsin geological and natural history survey, bulletin 33, scientific series n° 10, p. 85
Fomes fuscatus Lazaro Ibiza (1916), Revista de la real Academia de ciencias exactas, fiscicas y naturales de Madrid, 14, p. 666
Placodes officinalis (Villars) Ricken (1918), Vademecum fur Pilzfreunde, Edn 1, p. 226
Fomitopsis officinalis (Villars) Bondartsev & Singer (1941), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 39(1), p. 55 (nom actuel)
Laricifomes officinalis (Villars) Kotlaba & Pouzar (1957), Ceska mykologie, 11(3), p. 158
Agaricum officinale(Villars) Donk (1971), Proceedings of the koninklijke nederlandse Akademie Van Wetenschappen, section C, biological and medical sciences, 74(1), p. 26
References : CD 91 ; FE 10 ; Marchand 295 ; Cetto 1 p. 561 ; Julich 2 p. 372 ; FMDS fasc. 54 p. 13 ; BK 2 401 ; BG p. n° 920
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Fomitopsidaceae
Chapeau/Fructification : Chapeau mesurant 6-20 (30) cm de long, 4-15 cm de projection, 4-12 cm d'epaisseur, d'abord globuleux, puis ongule, difforme ou assez regulier, enfin pendant, cylindrace, s'allongeant au point d'atteindre 65 cm de hauteur, revetu d'une croute mince, crevasse en tous sens, sec, dur, rugueux, jaune ochrace uniforme dans la jeunesse, puis blanchatre crayeux a gris blanchatre, zone de gris souris et de gris brunatre en arriere. Marge tres obtuse, en retrait, decouvrant les tubes, ondulee, jaune pale a jaune vif.
Lames/Pores : Pores arrondis-anguleux, 0,2-0,3 mm de diametre, certains jusqu'a 0,5 mm, environ 3 a 4 par mm, pubescents, la plupart obstrues par un enduit pruineux, creme blanchatre ; tubes multistratifies (jusqu'a 70 couches mal distinctes dans un basidiome d'une cinquantaine d'annees), longs de 5 a 8 mm dans chaque assise, a paroi d'epaisseur moyenne, blancs, puis creme. Sporee blanche (?).
Chair : Trame epaisse de 4 a 6 cm, molle, spongieuse, puis induree, legere a sec, lache, friable, concolore aux tubes. Saveur amere. Odeur de farine sur le frais, d'huile d'amande douce en herbier.
Habitat : Sur troncs vivants ou morts, debout ou couches de Larix, mais egalement plus rarement sur d'autres coniferes, en regions alpestres. Pourriture peu active, cubique et brune. Rare. Tout au long de l'annee.
Spores : Spores elliptiques, lisses, hyalines, guttulees, mesurant 5-6,25 x (3)-3,5-3,75 µm, apicule gros et obtus, I-. Basides mesurant 12-15 x 5-6,75 µm, jaunes. Pas de cystides. Trame trimitique : (1)- Hyphes generatrices a paroi mince 1,5-3 µm de largeur, cloisonnees et a boucles ansiformes. (2)- Hyphes squelettiques a paroi epaisse, larges de 2-4 µm, sans cloisons et non ramifiees. (3)- Hyphes de la trame cassantes, paralleles, a parois minces enrobee d'une substance amorphe, cristallisee blanche, 1,75-5-(8) µm. Boucles presentes, mais rares.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Longtemps utilise dans l'apothicairerie populaire pour confectionner des medecines ameres a base d'herbes en raison de ses proprietes laxatives et son action freinant la sudation. Ce parasite de blessure peut vivre de 60 a 70 ans et atteindre le poids de 10 kg. Le polypore officinal ou polypore du meleze a egalement connu ses lettres de noblesse dans diverses contrees. D'apres DONK (1974), ce polypore doit s'appeler Agaricum officinale mais il est connu sous bien d'autres noms qui sont des synonymes tels que Polyporus officinalis, Fomes laricis, F. officinalis, Boletus purgans, Fomitopsis officinalis, Laricifomes officinalis... C'est encore l'Agaric femelle ou l'Agarikon de DIOSCORIDE, l 'Agaricum de PLINE, nom qui d'apres HARDUIN aurait persiste dans les montagnes du Dauphine (BULLER, op. cit.). A l'instigation des Arabes, les medecins considererent longtemps l'Agaric officinal uniquement comme un cholagogue et un phlegmagogue propre a chasser les humeurs peccantes et surabondantes, a combattre, suivant l'expression de Thibault LESPLEIGNEY, « pluralite de maladie congregee en l'humaine peau ». Ce n'est qu'au XVIIIe siecle que furent reconnues ses proprietes antisudorales (LECLERC, 1966, p. 93). Le bolet du meleze (Agaricum officinale) est mentionne a plusieurs reprises dans le Vienna Codex, manuscrit medical de l'an 512. DIOSCORIDE dans De medica recommandait l' Agarikon pour traiter les fractures, la dysenterie, l'epilepsie, comme antidote des poisons, pour soulager des morsures de serpents, etc. (NICOT, 1971). Selon HARTWELL (op. cit.), le polypore officinal est mentionne dans divers Antidotarium du IXe et Xe siecle comme remede contre divers cancers. GALIEN en fait mention. On le retrouve dans la Farmacopea bergamosca qui date de 1580. L'agaric officinal entrait dans la composition de diverses antiques formules telles la teinture d'aloes compose ou Elixir de longue vie qui comporte 2,5 g par litre de poudre d'agaric et qui est un purgatif efficace. Ses vertus laxatives furent evoquees par le mycologue anglais PERSOON en 1801, qui le nomma Boletus purgans. D'apres CORDIER (op. cit.), les paysans suisses s'en servaient pour purger les vaches et les habitants du Piemont prenaient un petit morceau de ce polypore, avec addition d'un peu de poivre, quand ils avaient avale quelque sangsue dont les eaux de leur pays abondent. Les habitants de Balen (Belgique) l'employaient reduit en poudre pour guerir les pustules et les furoncles de leur betail. L'agaric officinal a figure dans bon nombre de Codex pharmaceutiques jusque vers les annees 1950. L'agaric officinal etait surtout recolte dans les forets de meleze de Russie, puis exporte vers Hambourg (EMMONS, 1961) d'ou il etait distribue en Europe et aux Etats-Unis. Ses proprietes anti-sudorales ont ete mises a profit au XVIIIe siecle pour lutter contre les sueurs nocturnes des phtisiques et tout recemment dans la preparation d'un desodorisant repute naturel. Les carpophores peles et seches sont encore employes par les Ainous de Hokkaido comme antihydrotique pour soigner les douleurs d'estomac (MITSUHASHI, 1976). L'agaric officinal se developpe principalement sur les troncs de meleze, mais il connu egalement sur Pinus, Abies, Cedrus. On le rencontre dans les forets alpines, les montagnes de l'Europe meridionales et du Proche-Orient, les forets siberiennes, et vraisemblablement aussi au Japon et en Amerique du Nord. Selon RYVARDEN (1976), l'espece n'existerait pas en Fennoscandie. Du temps de DIOSCORIDE, l'agaric officinal croissait en Sarmatie, une ancienne region de Russie (BULLER, op. cit.). L'agaric officinal semble rare dans ses stations et MARCHAND (1975, p. 262) raconte qu'il y a un demi-siecle, les carpophores se montraient de si bonne vente dans les officines, que les montagnards tenaient secretes les stations et que les arbres porteurs etaient tres surveilles ! Aujourd'hui, l'usage des polypores est tombe en desuetude presque partout ; tout au plus HEIM (1969) signale encore son utilisation en Russie septentrionale et YOKOHAMA (1975) son usage medicinal par les Ainous qui le nomment Skiu-karush (champignon amer) ou Kiu-kurush, de kiu, le meleze des Kouriles (Larix dahulica var. japonica), c'est-a-dire le champignon du meleze. BRAUN (1968) le signale cependant encore dans un ouvrage destine aux medecins et pharmaciens. Tandis que VOORHOEVE (1965) fait etat de l'utilisation de Boletus laricis ( = Agaricum officinale) dans son traite pratique d'homeopathie.
Pas de photo disponible
Synonymes : Exobasidium azaleae Peck (1873), Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences, 1, p. 63
Exobasidium japonicum Shirai (1896), The botanical magazine, Tokyo, 10, p. 52 (Basionyme) (nom actuel)
Exobasidium vaccinii var. japonicum (Shirai) McNabb (1962), Transactions and proceedings of the royal Society of New Zealand, n.s., Bot., 1(20), p. 267
References : Julich p. 444
Groupe : Rouilles
Classification : Basidiomycota / Exobasidiomycetes / Exobasidiales / Exobasidiaceae
Spores : hyalines, 12-20 x 3-4,5 μm
Comestibilite : Sans interet

Diaporthe aucubae Sacc., Michelia 1(no. 4): 390 (1878) (nom actuel)
Phoma aucubae f. ramulicola Sacc., Syll. fung. (Abellini) 3: 115 (1884)
Phomopsis aucubae (Westend.) Traverso, Fl. ital. crypt. (Florence) 2(1): 243 (1906)
Phomopsis aucubae f. ramulicola (Sacc.) Traverso, Fl. ital. crypt. (Florence) 2(1): 243 (1906)
Groupe : Pyrenomycetes
Classification : Ascomycota / Sordariomycetes / Diaporthales / Diaporthaceae
Habitat : Sur Aucuba japonica
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Agaricus aspratus Berkeley (1847), in W.J. Hooker, The London journal of botany, 6, p. 481 (Basionyme)
Agaricus lacunosus Peck (1873), Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences, 1, p. 43 (nom. illegit.)
Tricholoma lacunosum Saccardo (1887), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 5, p. 113
Lepiota asprata (Berkeley) Saccardo (1887), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 5, p. 48
Marasmius aculeatus Patouillard (1900), Bulletin de la Societe mycologique de France, 16(4), p. 175
Collybia lacunosa (Saccardo) Peck (1908) [1907], Bulletin of the New York state Museum, 122, p. 132
Armillaria asprata (Berkeley) Petch (1910), Annals of the royal botanic Gardens, Peradeniya, 4(6), p. 386
Xerula asprata (Berkeley) Aberdeen (1962), Kew bulletin, 16(1), p. 129
Xerulina asprata (Berkeley) Pegler (1972), Kew bulletin, 27(1), p. 196
Cyptotrama asprata (Berkeley) Redhead & Ginns (1980), Canadian journal of botany, 58(6), p. 731 (nom actuel)
References : IH1 193 ; IOH p. 137
Groupe : Collybies
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Physalacriaceae
Chapeau/Fructification : 0, 5- 3 cm, convexe pulvine, surface seche. Les squames epineuses dressees sont caracteristiques des specimens jeunes, se brisant avec l'age, ce qui lui donne un aspect poilu ou laineux. Remarquable par sa couleur jaune plus ou moins orange, mele de vermillon au disque, herisse de squamules dressees qui lui donne une allure de Pholiota squarrosa, mais le chapeau devient vite plan. Marge enroulee, puis droite.
Lames/Pores : espacees, adnees a subdecurrentes, remarquablement plissees et interveinees au fond, toucher gras sur le sec.
Chair : blanchatre a jaune pale, tres mince, dure et cassante. Sans odeur ni saveur particuliere.
Stipe : 1-7 x 0,3- 0,5 cm, legerement epaissi a la base, concolore au chapeau et egalement revetu d'ecailles granuleuses. Anneau en forme de bandeau, tres fugace, souvent manquant.
Habitat : Espece pantropicale, decrite a l'origine de Ceylan, puis D'Amerique, Australie, Hawai, saprophyte plutot isole sur bois pourri et debris ligneux de feuillus ou de coniferes, ou litiere de feuilles et surtout racines affleurantes de bambous. Ete-automne, assez commun au Japon dans les bambouseraies et en zone tropicale a subtropicale, depuis le Canada du Sud jusqu'en Afrique du Sud, y compris montagnes tropicales jusqu'a 3000m (i.e.Nouvelle Guinee).
Spores : 7-10 x 5-7 µm
Comestibilite : Sans interet

Stemonitopsis brachypus (Meyl.) Y. Yamam., Myxomycete Biota Japon 627 (1998)[
References : Poulain/Meyer/Bozonnet p. 273
Groupe : Myxos
Classification : Amoebozoa / Myxogastrea / Stemonitida / Stemonitidaceae
Chapeau/Fructification : Sporocarpes gregaires ou epars de 1,2 a 2 (-3)mm de hauteur. Sporocystes ovoides a largement cylindriques de 1 a 1,5 mm de haut et 0,7 a 1mm de diametre. Peridium fugace. Columelle noire se retrecissant vers le haut et atteignant presque le sommet du sporocyste et devenant brun rougeatre dans sa partie superieure. Capillitium brun rouge clair, dense, a filaments emmeles, flexueux, boucles, ramifies et anastomoses, extremites libres nombreuses. Le capillitium est boucle en surface, formant comme un reseau.
Stipe : Stipe noir, mesurant 1/5 a 1/3 (-1/2) de la hauteur totale du sporocarpe.
Habitat : Bois mort.
Spores : Spores finement verruqueuses de 9 a 11µm de diametre.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Observe en parallele avec Craterium minutum.

Synonymes : Collybia neofusipes Hongo (1969), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 19, p. 75 (Basionyme) (nom actuel)
Gymnopus neofusipes (Hongo) Taxon invalide (non publie)
References : IH1 135 ; Kinoko Field Book p. 60
Groupe : Collybies
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Incertae sedis
Chapeau/Fructification : 7-9 cm, convexe puis plan avec un mamelon obtus, a marge d'abord incurvee, non striee, glabre, non visqueux, de couleur rouille a roux-cannelle, le centre plus sombre (bai a brun caroube).
Lames/Pores : adnees-secedentes, 6-9 mm de largeur, blanches puis tachees de rosatre, extremement serrees-subcomprimees (L=40).
Chair : ferme, assez epaisse mais mince a la marge, brun tres pale puis blanche. Odeur faible, saveur douce puis un peu amere.
Stipe : 6-8 cm ou tres allonge, 1-1,5 cm d'epaisseur, fusiforme-radicant a la base, ferme, farci puis creux, sillonne, parfois torsade, plus pale que le chapeau.
Habitat : solitaire ou en touffe au pied des coniferes, surtout Pinus densiflora. Japon, Coree.
Spores : 4,5-7 x 2,5-3,5 µm, hyalines, ovoides, apiculees, lisses, non amyloides.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Boletus virens W.F. Chiu (1948), Mycologia, 40(2), p. 206 (Basionyme)
Tylopilus virens (W.F. Chiu) Hongo (1964), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 14, p. 46
Chiua virens (W.F. Chiu) Y.C. Li & Zhu L. Yang (2016), Fungal diversity (Hong Kong), 81, p. 79 (nom actuel)
References : IH2 561 ; IOH p. 332
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : (2,5)4,5-6(8) cm, convexe puis plan, a revetement verdatre, de fines squamules vert olive s'areolant a jaune moutarde ou brun jaune olivace avec l'age, viscidule seulement par temps humide.
Lames/Pores : jusqu'a 2 cm de longueur, d'un rose Congo, ventrus bientot anguleux, libres ou deprimes autour du stipe; pores 1-2 mm ( x 4 mm avec l'age), concolores aux tubes, circulaires.
Chair : jaune pale, immuable; odeur et saveur neutre.
Stipe : (2)6-8 x 0,7-1,5 cm, jaune pale plus ou moins reticule de veines olivacees, parfois lave de rougeatre par endroits, et de jaune a la base
Habitat : Chine, Borneo, Japon en ete-automne, isole ou en petits groupes, a terre, sous Keteleeria en Chine, sous Pinus densiflora meles a Castanopsis cuspidata/Quercus accutissima
Spores : Spores roses en masse, 9,5-14 x 4-6 µm. Cystides 18-27 x 4,5-6,5 µm.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Ce "tylopile" non amer, a sporee rose est remarquable par l'evolution de la couleur du chapeau (vert dans la jeunesse, jaune a brun olivace en vieillissant), evoquant des especes differentes pour le neophyte. Comestibilite non documentee.

Synonymes : Strobilomyces fusisporus Kawamura (1954), Icones of Japanese Fungi, 2, p. 282 (nom. inval.)
Porphyrellus fusisporus Kawamura ex Imazeki & Hongo (1960), Acta phytotaxonomica et geobotanica, Kyoto, 18(4), p. 110 (Basionyme)
Austroboletus fusisporus (Kawamura ex Imazeki & Hongo) Wolfe (1980) [1979], Bibliotheca mycologica, 69, p. 96 (nom actuel)
References : IH2 505 ; IOH p. 348
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 2,5-5 cm, convexe a plan-convexe, souvent avec un mamelon central, viscidule, brun fauve a brun cannelle (parfois teinte d'olivace), plus sombre au disque, finement veloute a plus ou moins squamuleux. Marge appendiculee de restes de voile general en flocons membraneux ocrace pale.
Lames/Pores : Tubes de 6 mm de long en moyenne, blanc puis brun vineux, sublibres, arrondis ou anguleux, 0,3-1 mm.
Chair : Assez mince, blanche, immuable, de saveur amere exhalant une odeur forte, agreable.
Stipe : 3,4-8,5 cm x 3-6 mm, subegal, parfois epaissi a la base, flexueux, plus pale que le chapeau, blanchatre au sommet, fortement sillonne-reticule, plus ou moins visqueux par l'humidite, plein puis farci, enfin caverneux, base enrobee d'un tomentum blanc.
Habitat : Solitaire ou en petits groupes sur le sol ou sur debris bien decomposes, en foret de feuillus (Castanopsis, etc.). Japon.
Spores : Sporee brun vineux. Spore jaune pale, largement fusoides, verruqueuses, 13,5-18,5 x 8-11 µm. Basides tetrasporiques, 26-28 x 12-14,5 µm.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Remarquable par son pied fortement et grossierement reticule, devenant visqueux par temps humide, son odeur forte et agreable, et ses spores fusiformes. La sporee est brun vineux sans aucune nuance olivacee
Pas de photo disponible
Synonymes : Amanita rubrovolvata S. Imai (1939), The botanical magazine, Tokyo, 53, p. 392 (Basionyme) (nom actuel)
Amplariella rubrovolvata (S. Imai) E.-J. Gilbert (1940), Iconographia mycologica, 27, supplement 1(1), p. 79, 365
References : IH1 197 ; IOH p. 144 ; SMF 110 (1), Atlas pl. 283
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 2,5-4 cm de diametre, convexe puis plan ou faiblement creuse, rarement mamelonne, orange vif a orange-ecarlate ou rouge vermillon dans les deux-tiers de la partie discale, palissant a jaunatre orange vers la marge, recouvert de restes de volve farineux ou granuleux rouge orange a jaune; marge longuement striee-tuberculee jusqu'a mi-rayon, non appendiculee. Cuticule tres fine et membraneuse, subareolee, legerement visqueuse, couverte d'ecailles micacees separables, reduites dans la vieillesse en taches crustacees eparses?
Lames/Pores : libres, blanchatres, intercalees de lamelles tronquees.
Chair : mince, blanchatre a isabelle, fragile et orange pale sur les specimens nepalais.
Stipe : 4,5 - 11 x 0,4 - 0,7 cm, subcylindrique ou attenue au sommet, faiblement bulbeux au niveau de la volve; revetement blanc creme au dessus de l'anneau, de plus en plus jaune vers la base. Bulbe basal subspherique, 1-1,5 cm, recouvert de debris de volve pulverulents ou floconneux de couleur rouge, rouge orange a jaunatre. Anneau supere pendant, persistant ou caduc, finement membraneux, blanc sur la face superieure, jaunatre sur la face inferieure, l'arete etant soulignee de rouge (ou poudree d'orange sur les recoltes nepalaises). Volve friable, adnee au bulbe autour duquel elle est nettement marginee.
Habitat : Sous feuillus, principalement Fagus spp. (hetres), Quercus spp. (chenes) et Castanopsis spp. principalement, plus rare sous melezes. Ete-automne. Japon, Coree, Chine, Inde du nord et Nepal, Asie du Sud-Est.
Spores : en masse, blanches a legerement creme. Spores globuleuses 7-8,5 x 6-7,5 µm (7,5-10 µm pour les recoltes nepalaises), apiculees, a grosse guttule, non amyloides. Boucles absentes.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Belle amanite de petite taille aux couleurs vives. Guy Durrieu avait observe cette espece, nouvelle pour le Nepal, dans la vallee de Langtang en 1982 sous Quercus semecarpifolia. Description complete dans le bulletin trimestriel de la Societe Mycologique de France tome 110, fascicule 1, pp. 29-32 + pl. 283 (Atlas SMF). Le genre Amanita au Nepal (II)
Pas de photo disponible
Aleurodiscus subcruentatus (Berkeley & M.A. Curtis) Burt (1920), Annals of the Missouri botanical Garden, 7(2-3), p. 237
Aleurodiscus scutellatus Litschauer (1926), Osterreichische botanische zeitschrift, 75, p. 48
Aleurocystidiellum subcruentatum (Berkeley & M.A. Curtis) P.A. Lemke (1964), Canadian journal of botany, 42, p. 278, fig. 23 (nom actuel)
References : FE 12 p. 93
Groupe : Croutes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Incertae sedis
Habitat : Sur rameaux de coniferes, surtout Pinus spp. (pins). Rare. Europe, Amerique du Nord. Plus frequent en Europe centrale et en Tchecoslovaquie. Liste des arbres sur lesquels Aleurocystidiellum subcruentatum a ete repertorie : - Pinus montana (pin de montagne) - Pinus mugo (pin mugo) - Pinus mugo 'Pumilio' (pin mugo nain) - Picea abies (epicea commun) - Picea jezoensis (epicea du Japon) - Picea rubens (epinette rouge) - Pseudotsuga meziesii (sapin de Douglas)
Spores : 15-20 x 10-15 μm
Comestibilite : Sans interet

References : IOH p. 581
Groupe : Clavaires
Classification : Ascomycota / Sordariomycetes / Hypocreales / Cordycipitaceae
Chapeau/Fructification : 1 a 20 stromas jaune de miel a jaune pale emergeant de la chrysalide a 1-4 cm au dessus du sol, en forme de balai ou coralloide.
Habitat : Parasite les pupes de divers lepidopteres enfouies dans le sol. Japon, Nepal.
Spores : Conidies ellipsoides 1,5 × 2,7μm

Synonymes : Amanita vittadinii ss. Hongo (1954), Journal of Japanese botany, 29, p. 88
Amanita virgineoides Bas (1969), Persoonia, 5(4), p. 435 (Basionyme)
References : IH1 232 ; IOH p. 170-171
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 7-15 cm, hemispherique puis convexe, longtemps blanc, ochrace pale dans la vieillesse, entierement couvert de verrues blanches coniques a pyramidales.
Lames/Pores : libres, serrees, inegales, blanches, entieres.
Chair : blanche, tendre, saveur douce. Comestibilite discutee en Chine, mais aucun incident impute a ce jour au Japon.
Stipe : central, 8-20 × 2-3 cm, souvent clave, massif, blanc, couvert de verrues coniques. Anneau membraneux, blanc, fragile. Volve bulbeuse, blanche, couvertes de verrues coniques.
Habitat : Sous feuillus ou sous Pinus, Japon, Chine, Coree du Sud
Spores : largement ellipsoides, hyalines, lisses, amyloides 7,5-10 × 6-8 μm, hyphes non bouclees.

Synonymes : Agaricus ponderosus Peck (1873), Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences, 1, p. 42 (nom. illegit.)
Agaricus magnivelaris Peck (1878) [1876], Annual report of the New York state Museum of natural history, 29, p. 66 (Basionyme)
Armillaria ponderosa Saccardo (1887), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 5, p. 78
Mastoleucomyces ponderosus (Saccardo) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 861
Armillaria arenicola Murrill (1912), Mycologia, 4(4), p. 212
Armillaria magnivelaris (Peck) Murrill (1914), North American flora, 10(1), p. 37
Tricholoma murrillianum Singer (1942), Lloydia, 5, p. 113
Tricholoma ponderosum (Saccardo) Singer (1951) [1949], Lilloa, 22, p. 227
Tricholoma magnivelare (Peck) Redhead (1984), Transactions of the mycological Society of Japan, 25(1), p. 6 (nom actuel)
References : McNeil, R. 2006. Le grand livre des champignons du Quebec et de l'est du Canada. Editions Michel Quintin.
Groupe : Tricholomes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Tricholomataceae
Comestibilite : Bon comestible
Commentaires : Lien Mushroomexpert.com Malgre son surnom de "American Matsutake", cette espece n'est pas le veritable et tres jalouse "Matsou-take" (Tricholoma matsutake Singer) du Japon infeode au Pinus densiflora.

Synonymes : Dictyophora lutea Liou & L. Hwang (1936), Chinese journal of botany, 1(1), p. 89 (Basionyme)
Dictyophora indusiata f. aurantiaca Kobayasi (1938), in Nakai & Hondo, Nova Flora Japonica, 2, p. 83
Dictyophora indusiata f. lutea (Liou & L. Hwang) Kobayasi (1965), Journal of Japanese botany, 40, p. 179
Phallus indusiatus f. citrinus K. Das, S.K. Singh & Calonge (2007), Boletin de la Sociedad micologica de Madrid, 31, p. 136
Phallus luteus (Liou & L. Hwang) T. Kasuya (2009) [2008], Mycotaxon, 106, p. 8 (nom actuel)
References : IH1 910 ; IOH 524
Groupe : Phalles
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Phallales / Phallaceae
Comestibilite : Comestible
Commentaires : On a beau savoir que tous les Phallus ont une indusie, elle est pratiquement invisible, reduite a quelques millimetres, elle ne depasse guere du chapeau. Au contraire du sous-genre Dictyophora, ou elle enferme tout le champignon dans une cage grillagee. La structure fine et legere comme de la dentelle est entierement demontable, comme une lampe de chevet (ampoule, pied et abat-jour ! ) ... La croissance du champignon est rapide a partir de l'eclosion de l'oeuf. Deux heures suffisent le plus souvent a l'achevement du tricotage de l'indusie, plus d'un millimetre par minute, que l'on peut detecter a l'oeil nu.

Synonymes : Synonyme deXerocomellus ripariellus
Boletus rubellus ss. auct. jpn. plur.
References : IH2 551 ; IOH p. 327
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : De taille modeste, 4-7 cm, revetu de fibrilles rouge-sang a rouge sombre, finement fissure-craquele, laissant apparaitre la chair jaune sous-jacente.
Chair : Chair rose, lentement bleuissante a l'air. Saveur douce, odeur rappelant le "Koji", ferment de sake ou "malt" de riz (Aspergillus oryzae)
Habitat : Vient de juin a novembre a terre, affectionne la pelouse des jardins et parcs, egalement sous feuillus (Fagus). Amerique du Nord et Japon.
Spores : 12-16 x 5-6,5 μm.
Comestibilite : Comestible
Pas de photo disponible
Synonymes : Boletus pseudocalopus Hongo (1972), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 22, p. 66 (Basionyme)
Baorangia pseudocalopus (Hongo) G. Wu & Zhu L. Yang (2015), Fungal diversity, 81, p. 4 (nom actuel)
References : RTMI 12 p. 31-40 (1975) ; IH2 552 ; IOH p. 328
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 6-14 cm, convexe a plan-convexe, cuticule seche, collante par temps humide chez les sujets ages, d'abord finement tomenteuse, puis presque glabre, brun rougeatre (bai, rouille a chatain) uniforme dans la jeunesse, la marge plus pale (cannelle a sepia), a la fin palissant entierement, de brun cannelle a chamois. Marge d'abord incurvee a infractee.
Lames/Pores : pores concolores aux tubes, subanguleux a anguleux, 1-3 par mm, bleuissant au froissement comme les tubes. Tubes adnes a brievement decurrents, en continuite avec le reticulum apical du stipe, jaune d'ambre puis jaune ocrace, virant assez rapidement au bleu verdatre a la coupe, courts par rapport a la taille du chapeau, de 3 a 6 mm de long;
Chair : tres epaisse, jusqu'a 2,5 cm, jaunatre, immuable ou virant faiblement au bleu verdatre chez les jeunes. Saveur douce, odeur plaisante. Chair du stipe d'un jaune plus soutenu, immuable en general, souvent tachee de rouge a la base, rouge brunatre dans les galeries des larves.
Stipe : 7-10 cm de long, epaissi vers le bas, 0,9-1,6 cm de diametre au sommet et 1,6-4 cm a la base, parfois clave ou legerement bulbeux, plein, revetement jaune, finement ponctue de rouge brunatre sombre a brun Madere (brun violace), jaune et finement reticule seulement au sommet (au moins dans la jeunesse), noircissant avec l'age ou a la manipulation.
Habitat : Pas rare sous feuillus (Quercus serrata, Castanea crenata), ou meles de Pinus densiflora, en solitaire ou dissemines, de l'ete au debut de l'automne, endemique (Japon central)
Spores : Jaune de miel pale sous le microscope, legerement teintees d'olivatre dans KOH, subcylindracees a subfusiformes, boletoides, 10-12,5 x (3,5)-4-(5) µm, lisses, paroi inferieure a 0,5 µm. Basides tetrasporiques, 27 x 8-10 µm. Pleurocystides eparses, ventrues-fusoides, prolongees d'un col etroit, 40-58 x 11-14 µm. Cheilocystides sphero-pedonculees ou clavees, a paroi mince, 20-33 x 10-13 µm. Trame des lames bilaterale, typique du genre. Boucles absentes.
Comestibilite : Inconnu

Synonymes : Marasmius purpureostriatus Hongo (1958), Journal of Japanese botany, 33, p. 344 (Basionyme)
References : IH1 163
Groupe : Marasmes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Marasmiaceae
Chapeau/Fructification : Chapeau conique a campanule, 1,5 ~ 2,5 cm, blanchatre, remarquablement strie de brun violace sombre, surligne au dessus de chaque lame (de sorte que l'on peut les compter par transparence sans retourner le champignon). Mamelon central saillant. Marge droite et crenelee.
Lames/Pores : Lames emarginees ou libres, etroites, tres espacees, creme jaunatre a grisatre pale, tiquetees de rouille, finement pubescentes a la marge.
Chair : Tres mince, insipide, saveur nulle.
Stipe : Stipe 4-11 x 0,1-0,4 cm, concolore aux lames au sommet, violet ailleurs, recouvert d'une pruine blanchatre chez le jeune, bientot lisse et brunissant, puis noircissant avec l'age. Base guetree de longs poils, souvent coudee par un bourrelet de coton mycelien agglutinant des debris vegetaux varies, feuilles et brindilles.
Habitat : Printemps-Automne, sous feuillus dans la litiere de feuilles mortes et brindilles. Longtemps endemique au Japon, des recoltes lui ont ete rapportees de Malaisie, Thailande, Coree et Nouvelle Guinee.
Spores : Hymenium coriace d'hyphes entrelacees 4 ~ 7 µm de large, aspect gelifie rendant les coupes assez floues. Spores rares sur nos specimens, en cigare ou cystidiformes, de grande taille: 21–30 × 5-7 µm, brun sous le microscope. Cheilocystides largement clavees a fusoides ou utriformes.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Marasmius maximus Hongo (1962), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 12, p. 39 (Basionyme)
References : IH1 164
Groupe : Marasmes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Marasmiaceae
Chapeau/Fructification : Chapeau 3,5-10 cm, campanule-convexe, vite plan, mamelon plus ou moins net, longuement strie-cannele sur la moitie externe. Revetement glabre, beige ochrace, brunatre fonce au disque, subhygrophane, blanchissant en sechant.
Lames/Pores : Lames larges (2-7 mm=), falciformes, espacees, 3-4 grandes lames/cm a un cm de la marge, adnees ou sublibres a arrondies au pied, plus pales que le chapeau. Lamellules intercalees 1-2 et souvent inclinees, interveinees.
Chair : Saveur douce.
Stipe : Stipe assez court (4) 6-9 X 0,4 - 0,6 cm, souvent comprime, fibreux, se fendant longitudinalement, creux et vide. Revetement subfibrilleux, brun pale a fonce, plus ou moins tigre au sommet, brusquement attenue a la base, noircissant et devenant veloute comme un Xerula avec l'age tandis que le chapeau se retrousse.
Habitat : Gregaire a cespiteux, en ete-automne, a terre sous feuillus, coniferes, dans les bambousseraies, etc. Japon.
Spores : Spores hyalines, congophobes, non amyloides, fusiformes-ellipsoides 3-4 x 6-9 µm. Basides tetrasporiques, 22-27 x 5-6 µm. Cystides nombreuses, plus ou moins clavees, 15-30 x 6-10 µm.
Commentaires : Differe de Marasmius oreades par l'habitat et le chapeau fortement strie. Le nom japonais de "Grand Phenix" evoque sa grande taille et la reviviscence propre aux marasmes.

Synonymes : Boletus albellus Massee (1909), Bulletin of miscellaneous information - Royal botanic Gardens, Kew, 1909(5), p. 206 (nom. illegit.)
Boletus valens var. macrosporus Corner (1972), Boletus in Malaysia, p. 162 (Basionyme)
Boletus valens Corner (1972), Boletus in Malaysia, p. 161 (Basionyme)
Tylopilus valens (Corner) Hongo & Nagasawa (1976), Reports of the Tottori mycological Institute, 14, p. 87
Pseudoaustroboletus valens (Corner) Y.C. Li & Zhu L. Yang (2014), Mycological progress, 13(4), p. 1211 (nom actuel)
Pseudoaustroboletus valens var. macrosporus (Corner) Y.C. Li & Zhu L. Yang (2014), Mycological progress, 13(4), p. 1212
References : RTMI Reports of the Tottori Mycological Institute 14: 87 (1976) ; IH1 569
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : (3)5-13(15) cm, hemispherique puis convexe, enfin plan, onduleux a faiblement deprime, a cuticule un peu visqueuse par temps humide, gris-brun a brun sombre olivace, tomenteux, puis glabre, plus pale vers la marge.
Chair : Saveur non amere, acidule
Stipe : 7-15 x (1)1,5-2(3) cm, clave a la base, farci, revetement blanc a grisatre pale, reticule scabreux.
Habitat : isole ou en troupes dans les bois meles de Pinus densiflora/Quercus serrata, ou de feuillus Quercus/Castanopsis. Japon, Chine, Singapour, Malaisie, Borneo
Comestibilite : Comestible

Hydnum schweinitzii Berkeley & M.A. Curtis (1856), Journal of the Academy of natural sciences of Philadelphia, serie 2, 3, p. 216
Hydnum chrysodon Berkeley & M.A. Curtis (1873), Grevillea, 1(7), p. 98
Merulius elliotti Massee (1892), The journal of botany, british and foreign, 30, p. 162, tab. 322, fig. 18-19
Oxydontia chrysorhiza (Torrey) D.P. Rogers & G.W. Martin (1958), Mycologia, 50(2), p. 308
Mycoacia chrysorhiza (Torrey) Aoshima & H. Furukawa (1966), Transactions of the mycological Society of Japan, 7(2-3), p. 135
Hydnophlebia chrysorhiza (Torrey) Parmasto (1967), Eesti NSV teaduste akadeemia toimetised. Bioloogiline seeria, 16(4), p. 384
Phanerochaete chrysorhiza (Torrey) Budington & Gilbertson (1973), Southwest Naturalist, 17(4), p. 417 ('chrysorhizon ') (nom actuel)
Grandiniella chrysorhizon (Torrey) Burdsall (1977), Taxon, 26(2-3), p. 329
Pseudomerulius elliotti (Massee) Julich (1979), Persoonia, 10(3), p. 330
Serpula elliotti (Massee) Zmitrovich (2001), Novosti sistematiki nizshikh rastenii, 35, p. 82
References : IH1 710
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Phanerochaetaceae
Chapeau/Fructification : Basidiocarpes densement etales,fragiles, pelliculaires, facilement separables du substrat;
Lames/Pores : Surface de l'hymenium jaune orange vif, orange fonce, devenant fortement hydnacee, aiguillons cylindriques, jusqu'a 1 mm de long; rhizomorphes
Habitat : Sud-est des USA, Japon, Siberie orientale, sur bois de feuillus principalement
Spores : basidiospores largement ellipsoides, hyalines, non amyloides, lisses, 5-6 x 4-4,5 µm.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Ganoderma neojaponicum Imazeki (1939), Bulletin of the Tokyo science Museum, 1, p. 37 (Basionyme)
References : Imazeki 1939, Bull. Tokyo Sci. Mus. 1: 37 ; IH1 830 ; IOH 485
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Polyporaceae
Chapeau/Fructification : Chapeau dimidie a reniforme, plan, 3-11 x 4-11 cm. Marge mince et incurvee. Surface rouge brun tres sombre, presque noire, glabre, brillante comme laquee, rayee radialement.
Lames/Pores : Tubes brun cannelle sombre 0,2-1 cm de long; pores isabelle a cannelle, circulaires a anguleux, 3-5/mm.
Chair : mince, jusqu'a 8 mm, fibreuse a subereuse, blanc creme sous la surface pileique, brun cannelle au dessus des tubes.
Stipe : Stipe lateral, rarement central, vertical, 8-24 x 0,7-1,2 cm, surface noire et laquee.
Habitat : Sur coniferes.
Spores : ellipsoides, tronquees au sommet, jaune pale, 9-13 x 6-8 µm, a double paroi, les deux couches etant separees par des piliers interparietaux.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Se distingue aisement de G. lucidum par ses spores plus elancees, ses carpophores plus sombres, son stipe plus long et mince et son habitat limite aux coniferes. Si on tient ce champignon par la base de son long pied, avec la tete en bas, montrant sa face inferieure concave, la ressemblance avec une louche est flagrante. D'ou les nombreux noms vernaculaires integrant le mot louche. Sur le plan esoterique, Ganoderma lucidum sensu lato a une longue reputation et usage de talisman ou de symbole de porte-bonheur.

Coltricia benguetensis Murrill (1908), Bulletin of the Torrey botanical Club, 35(8), p. 391
Polystictus benguetensis (Murrill) Saccardo & Trotter (1912), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 21, p. 312
Polyporus benguetensis (Murrill) P.W. Graff (1914), Philippine journal of science, section C, botany, 9(3), p. 236
Fomes latistipitatus Lloyd (1921), Mycological writings, 6, mycological notes n° 65, p. 1062
Coltricia vallata (Berkeley) Teng (1963), Chung-kuo ti chen-chun, p. 759
Inonotus vallatus (Berkeley) Nunez & Ryvarden (2000), Synopsis fungorum (Oslo), 13, p. 89 (nom actuel)
References : IH1 845
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Hymenochaetales / Hymenochaetaceae
Chapeau/Fructification : turbine, 3-10 cm de haut, 3-13 cm de projection, 0,3-1 cm d'epaisseur, fauve a brun cannelle, rarement zonee a la marge, surface tomenteuse a presque glabre, souvent veloutee et douce au toucher.
Lames/Pores : Tubes courts, 3 mm de profondeur. Pores serres, 6-7/mm, fauve a brun ferrugineux,
Chair : dure, jaune brunatre
Stipe : Base courtement stipitee, centrale ou laterale, epaissi vers les pores, cannelle a brun madere, consistant et ferme.
Habitat : Rare espece annuelle venant sur racines enfouies de coniferes. Japon central, Chine, Philippines, Inde, Himalaya, Nepal.
Spores : subglobuleuses a largement ellipsoides, 3-5 x 2,5-5 µm, subhyalines. Basides 20-25 x 6-8 µm.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Russula alboareolata Hongo (1979), Memoirs of Shiga University, 29, p. 102 (Basionyme)
References : IH1 600
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 5-8 cm, d'abord convexe puis plan, enfin deprime en entonnoir, surface visqueuse par temps humide, finement pruineuse, peu separable, blanche, blanc d'ivoire sordide au disque, souvent rimeuse areolee. Marge devenant cannelee-tuberculeuse avec l'age.
Lames/Pores : blanches, presque libres, rarement decurrentes par la dent, subdistantes, souvent fourchues, egales, interveinees, 4-7 mm de large, assez epaisses et fragiles.
Chair : plutot mince, blanche. Saveur douce, odeur subnulle.
Stipe : 2-5,5 x 1-1,7 cm, subegal ou attenue a la base, blanc, ridule a strie, farci ou creux. FeSO4 reaction faible, saumone pale. Gaiac rapide vert glauque sombre.
Habitat : Solitaire, mais frequente en forets de Castanopsis et chenes verts.
Spores : creme pale en masse, 6,5-8,5 x 5,5-7 µm, spheriques a ovales, ornees de verrues isolees ou parfois catenulees, reliees par un reticulum plus ou moins complet.
Commentaires : Russule pallidosporee caracterisee par sa couleur entierement blanche, et son pied pruineux areole comme R. virescens, frequente sous les chenes verts. Japon, Taiwan et signalee dans la peninsule de Malaisie (selon Watling et Lee, 1998 en association avec certaines especes de Dipterocarpaceae). Tres proche de R. eburneoareolata, a chair plus ferme et stipe ivoirin.

Synonymes : Russula compacta Frost (1880) [1879], in Peck, Annual report of the New York state Museum of natural history, 32, p. 32 (Basionyme)
References : IH1 584 ; IOH 360 ; Phillips (NA) p. 109
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 7-10cm, convexe puis plan, enfin deprime ou un peu creuse en entonnoir. Revetement sec, glabre ou plus ou moins granulo-squamuleux, surtout au disque, cannelle a canelle-chamois. Marge incurvee dans la jeunesse.
Lames/Pores : Lames sublibres, serrees, souvent fourchues, plutot etroites (4mm env.), blanches a creme pale se tachant de brunatre au froissement.
Chair : Chair epaisse, compacte, cassante, blanche devenant lentement brun rougeatre a l'air. Saveur douce. Odeur desagreable de hareng, accentuee en sechant.
Stipe : Stipe 4-6 x 1,5-2cm, egal, ferme, legerement ride, farci, blanc, brunissant au froissement.
Habitat : Automne, a terre, plutot sous Fagaceae. Amerique du Nord (Est), Japon (Ouest de Hondo), Tasmanie.
Spores : Sporee blanche. Spore subglobuleuse 8-9 x 7-8 µm, fortement verruqueuse et subreticulee. Ornementation amyloide. Baside tetrasporique 40-53 x 9,5-12 µm, lanceolee-mucronee. Cheilocystides et pleurocystides abondantes: 46-48 x 6-9 µm.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Noter que R. compacta est classee dans le sous genre Compacta mais pas dans la section Compactae, ni la sous-section Xerampelinae malgre son odeur de poisson et sa chair verte au FeSO4.
Pas de photo disponible
Synonymes : Russula japonica Hongo (1954), Acta phytotaxonomica et geobotanica, Kyoto, 15(4), p. 102 (nom actuel)
Russula pseudodelica ss. Hongo (1965)
References : IH1 578 ; IOH 357
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 6-14(20)cm, convexe mais avec le centre deja deprime, puis en entonnoir (mais moins creuse que Russula delica qui est dite "en liseron"). Surface seche, lisse ou finement poudree, d'abord blanc puis jaune sordide a brun sale. Marge souvent ondulee.
Lames/Pores : libres puis, le chapeau s'ouvrant, souvent decurrentes, blanches puis creme ocrace pale (mais plus fonce que R. delica), enfin beige sordide (jamais de reflet bleuatre), vite tachees d'ocre-rouille tres serrees, etroites (1-4 mm).
Chair : epaisse dans le chapeau, dure, blanche, presque insipide, parfois amariuscule.
Stipe : trapu, 3-6 x 1,2-2 cm, cylindrique ou attenue a la base, surface ridulee ou ruguleuse, blanc, plein puis spongieux.
Habitat : Ete-automne, pas rare en forets temperees a chaude et humides, formant des rond-de-fees sous divers feuillus, surtout Quercus serrata, Quercus acutissima et Castanopsis cuspidata. Japon.
Spores : Sporee creme a ocre pale. Spore ovoides 6-7(8) x 4,7-6 µm, ornees de verrues minuscules plus ou moins coniques, parfois reliees entre elles; Cheilocystides et pleurocystides 40-60 x 9-10 µm, cylindriques a fusiformes ou en massue, attenuees en pointe au sommet, tres allongees, minces et mucronees.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : Un sosie de Russula delica, a lames extremement serrees et etroites, un pied toujours tres court et appointi a la base (comme la Russula flavispora de Blum ex Romagnesi) et chair insipide ou tres legerement amere. Hongo la decrit comme espece nouvelle en 1954, puis la synonymise a la pseudodelica de Lange en 1965. En 1982, elle retrouve son statut d'espece endemique. Donnee comme comestible en 1965 (Imazeki & Hongo, vol. 2 p. 193), puis la toxicite est dite "variable selon les individus" en 1989 (cf. Imazeki, Otani & Hongo p.579). Or, en juin 2001 a Kumamoto, il a suffi a deux ramasseurs d'en gouter et de recracher un petit morceau pour souffrir pendant 10 jours d'un œdeme de la langue et de la bouche, accompagne de paresthesies de tout le corps avec affaiblissement general. Comble de traitrise, la saveur etait agreable! Ces recoltes toxiques evoquent l'existence de "races chimiques" dans le "complexe Russula japonica"!

Synonymes : Irpex zonatus Berkeley (1854), in W.J. Hooker, Journal of botany and Kew Garden miscellany, 6, p. 168 (Basionyme)
Irpex brevis Berkeley (1855), in J.D. Hooker, The botany of the Antartic voyage II, flora of New Zealand, 2, p. 181
Irpex decurrens Berkeley (1891), in Cooke, Grevillea, 19(92), p. 109
Xylodon zonatus (Berkeley) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 541
Xylodon decurrens (Berkeley) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 541
Xylodon brevis (Berkeley) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 541
Irpiciporus japonicus Murrill (1909), Mycologia, 1(4), p. 166
Irpex japonicus (Murrill) Saccardo & Trotter (1912), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 21, p. 377
Irpex cingulatus Lloyd (1918), Mycological writings, 5, mycological notes n° 55, p. 795, fig. 1197
Polyporus japonicus (Murrill) Teng (1936), Sinensia, Shanghai, 7, p. 228
Antrodiella zonata (Berkeley) Ryvarden (1992), Boletin de la Sociedad Argentina de botanica, 28(1-4), p. 228 (nom actuel)
References : IH2 799 ; IOH p. 474 ; Nunez & Ryvarden East Asian Polypores
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Steccherinaceae
Chapeau/Fructification : Fructification etalee-reflechie, fixee au substrat et formant des revetements imbriques de plusieurs centimetres, avec des chapeaux individuels jusqu'a 1,5 cm de haut et de 1 a 3 (6) cm de long. Surface pileique coriace au frais, dense et catilagineuse une fois sec, blanche a chamois, pale ocre, puis pale souvent plus sombre a la base avec des taches ternes. Marge nette au frais, puis fortement courbee au sechage.
Lames/Pores : Surface inferieure poroide, bientot irpicoide comme les pores, pruineuse, concolore, 1 a 2 par mm, dents aplaties a rondes et pointues, 1-2 mm de long.
Chair : Dense, dure, blanchatre a pale ocre, jusqu'a 2 mm d' epaisseur.
Habitat : en troupes sur toutes sortes de feuillus morts.
Spores : Basidiospores oblongues-ellipsoides (4,5)-5-6 x (2,5 )-3-3,5µm. Basides claviformes a 4 sterigmates. Cystides, lisses, minces, tubulaires ou ventrues, hyalines, a base renflees, souvent difficile a detecter, ou absentes (Les recoltes asiatiques sont acystidiees ! ) Hyphes generatrices, hyalines a parois minces. Hyphes squelettiques abondantes, hyalines, non ramifiees, lisses, a parois epaisses.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Pas rare mais absent d'Europe. Largement distribue : Nouvelle Zelande, Australie, Argentine (sud), Inde, Chine, Japon, Taiwan, Vietnam, Russie d'Extreme-Orient.

Synonymes : Boletus gracilis Peck (1872) [1871], Annual report of the New York state Museum of natural history, 24, p. 78 (Basionyme)
Tylopilus gracilis (Peck) Hennings (1898), in Engler & Prantl, Die naturlichen pflanzenfamilien, 1(1**), p. 190
Suillus gracilis (Peck) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 535
Porphyrellus gracilis (Peck) Singer (1945), Farlowia, 2, p. 121
Austroboletus gracilis (Peck) Wolfe (1980) [1979], Bibliotheca mycologica, 69, p. 69 (nom actuel)
References : IH1 504 ; IOH p. 349
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : Hemispherique a largement convexe, 3-8(10) cm de diametre, surface densement veloutee-subtomenteuse, lubrifiee par temps humide, marron a brun rougeatre, parfois brun orange a cannelle, souvent finement craquelee ou areolee et parfois comme veinee-ridulee a maturite. Marge du chapeau unie, sans trace de voile.
Lames/Pores : Blanc a brun-rose, 1 a 2 par mm. Sporee brun legerement rougeatre. Tubes plutot longs (1 a 2 cm de hauteur), profondement deprimes autour du stipe, d’abord blanchatres puis teintes de rose brunatre a brun vineux, immuables au froissement. Pores circulaires a plus ou moins anguleux, 0,5-1,5 mm de diametre, blanchatres a rose brunatre pale.
Chair : Assez molle, blanche ou parfois legerement lavee de rosatre, immuable a l'air. Odeur peu remarquable, saveur douce a amariuscule. Chair blanche dans le stipe.
Stipe : long et mince, 5-12 x 0,7-1 cm, attenue au sommet, plein et solide, souvent courbe, revetement presque lisse a veloute, souvent parcouru de veines en relief, parfois convergentes et formant alors un reticulum partiel, concolore au chapeau ou cannelle pale, la base devenant blanche ou meme tachee de jaune a maturite.
Habitat : ete-automne, le plus souvent isole, parfois en abondance, surtout dans les bois de feuillus (Fagacees) ou meles de coniferes (Pinus, Abies...). Japon, Amerique du Nord orientale, Nouvelle-Guinee, Taiwan, Tibet, Chine(Yunnan)
Spores : Ellipsoides a fusiformes, ponctuee de minuscules verrues eparses, 11,5-15 x 5-5,5(7) µm. Cheilocystides en massue, 36-60 x 12-15,5 µm, hyalines, a paroi mince.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Cet Austrobolet immuable, se caracterise par son port elance, ses tons bruns chauds et sa face poroide rosee a maturite. Il ne pousse pas tous les ans et n'est jamais abondant, du moins en Amerique.

Synonymes : Stereum burtianum Peck (1904) [1903], Bulletin of the New York state Museum, 75, p. 21, tab. O, fig. 30-34 (Basionyme)
Podoscypha burtiana (Peck) S. Ito (1955), Mycological Flora of Japan, 2(4), p. 151
Stereopsis burtiana (Peck) D.A. Reid (1965), Beihefte zur Nova Hedwigia, 18, p. 292 (nom actuel)
Cotylidia decolorans ss. Welden
References : IH1 702
Groupe : Croutes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Stereopsidales / Stereopsidaceae
Chapeau/Fructification : mince, submembraneuse mais coriace, jusqu'a 2,5 cm de hauteur sur 0,5-2 cm de diametre, le plus souvent infundibuliforme, parfois spatuliforme si imbriques et confluents. Surface pileique legerement chatoyante, plus ou moins fibrilleuse au centre, brun ocrace pale, souvent zonee de gris brun sur le sec. Marge droite, etalee ou recurvee, inegale a legerement sinueuse, souvent incisee ou laceree. Surface de l'hymenophore lisse ou legerement striee radialement, chamois pale a plus ou moins ocrace, palissant en sechant. Stipe de 5-9 x 1-2 mm, court et tenu mais dur et coriace, finement tomenteux ou pruineux, grisatre sur le frais, devenant concolore au chapeau en sechant.
Chair : Tres mince, blanche, douce a mentholee. Odeur d'humus.
Habitat : Vient en troupe, a terre, dans les sous-bois buissonneux. Ameriques, Japon, Taiwan.
Spores : Trame monomitique d'hyphes generatives 2,5-4 µm de large,rarement ramifiees, a paroi hyaline tres mince, jamais bouclees. Cystides absentes. Basides clavees jusqu'a 50 x 5,5 µm. Spores hyalines, ellipsoides a subglobuleuses, 2,5-5 x 2-4 µm.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Peziza digitalis Schweinitz (1822), Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig, 1, p. 118 (nom. illegit.)
Cyphella pendula Schweinitz (1822), in Fries, Systema mycologicum, 2(1), p. 203 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1822)
Peziza pendula Schweinitz (1822), Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig, 1, p. 118
Sphaeria pocula Schweinitz (1825), Journal of the Academy of natural sciences of Philadelphia, serie 1, 5(1), p. 7, tab. 2, fig. 6
Favolus pusillus Fries (1830), Linnaea, Ein journal fur die botanik, 5, p. 511, tab. 11, fig. 2
Enslinia pocula (Schweinitz) Fries (1836), Corpus florarum provincialium Sueciae, 1, floram Scanicam, p. 347
Polyporus cupulaeformis Berkeley & M.A. Curtis (1849), in W.J. Hooker, Journal of botany and Kew Garden miscellany, 1, p. 103
Polyporus pocula (Schweinitz) Berkeley & M.A. Curtis (1860) [1858], Proceedings of the American Academy of arts and sciences, 4, p. 122
Enslinia pendula (Schweinitz) Cooke (1877) [1875], Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences, 3, p. 25
Chaetocypha pendula (Fries) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 847
Enslinia cupuliformis (Berkeley & M.A. Curtis) Patouillard (1900), Essai taxonomique sur les familles et les genres des hymenomycetes, p. 104
Porodiscus pendulus (Schweinitz) Murrill (1903), Bulletin of the Torrey botanical Club, 30(8), p. 433
Porodisculus pendulus (Schweinitz) Murrill (1907), North American flora, 9(1), p. 47 (nom actuel)
Petaloides pusillus (Fries) Torrend (1924), Broteria, revista de sciencias naturaes do Collegio de S. Fiel, serie botanica, 21(1), p. 27
Polyporus pusillus (Fries) G. Cunningham (1949), New Zealand Department of scientific and industrial research. Plant diseases division. Bulletin, 81, p. 16 (nom. illegit.)
Dictyopanus pendulus (Schweinitz) Teng (1963), Chung-kuo ti chen-chun, p. 760
Tyromyces pusillus (Fries) G. Cunningham (1965), New Zealand Department of scientific and industrial research. Plant diseases division. Bulletin, 164, p. 119
References : IH1 775 ; IOH p. 465
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Schizophyllaceae
Chapeau/Fructification : Cupule circulaire pendante de 2-5 mm de diametre, 5-10 mm de hauteur totale, circulaire a ellipsoide, farineux, non zone, brun jaunatre a tabac, grisonnant avec l'age, a marge arrondie, egalement farineuse.
Lames/Pores : Surface fertile poree infere,chamois rosatre ou brun pale a brun tabac. Pores minuscules, serres, 5-6 par mm. Couche de tubes distincte, semblant cartilagineuse au sec, jusqu'a 1 mm de long.
Chair : Presque blanche, 1-2 mm d'epaisseur, ferme et subereuse.
Stipe : Base dorsale ou laterale stipitiforme, dans le prolongement du chapeau et de memes caracteres et couleurs que ce dernier.
Habitat : Annuel, fructifiant en ete-automne, en troupe sur bois mort de feuillus divers. Est de l'Amerique du Nord, Quebec, Japon, Australie, Nouvelle Zelande. Les premieres recoltes japonaises ayant ete faites sur Rhus, l'espece a ete nommee Polypore du sumac.
Spores : En saucisse, 3-4 x 1 µm, hyalines. Sporee blanche. Spores et mycelium non amyloides.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Basidiome annuel, pilee, souvent pendant en forme de nez humain a partir d'une base dorsale ou laterale stipitiforme, forme d'une lenticelle ou d'une masse mycelienne rompant l'ecorce.

Synonymes : Agaricus soloniensis Dubois (1803), Methode eprouvee avec laquelle on peut parvenir facilement, et sans maitre, a connaitre les plantes ... des environs d' Orleans, p. 177 (Basionyme) Sanctionnement : Fries (1821)
Boletus soloniensis (Dubois) de Candolle (1815), Flore francaise ou description succincte de toutes les plantes qui croissent naturellement en France, Edn 3, 6, p. 41
Polyporus soloniensis (Dubois) Fries (1821), Systema mycologicum, 1, p. 365
Polyporus trichrous Berkeley & M.A. Curtis (1853), The annals and magazine of natural history, series 2, 12, p. 434
Polyporus appendiculatus Berkeley & Broome (1873) [1875], The journal of the linnean Society, botany, 14(73), p. 48
Polyporus paradoxus Fries (1873), Ofversigt af konglelige vetenskaps-akademiens forhandlingar, 30(5), p. 8
Ischnoderma soloniense (Dubois) P. Karsten (1879), Meddelanden af societas pro fauna et flora fennica, 5, p. 38
Piptoporus paradoxus (Fries) P. Karsten (1881), Meddelanden af societas pro fauna et flora fennica, 6, p. 9
Polyporus sublutescens Ellis & Everhart (1887), in Langlois, Catalogue provisoire de plantes phanerogames et cryptogames de la Basse-Louisiane, p. 33 (nom. inval.)
Polyporus sambuceus Lloyd (1915), Mycological writings, 4, letter n° 60, p. 13
Polyporus komatsuzakii Yasuda (1917), The botanical magazine, Tokyo, 31, p. 329
Polyporus pseudosulphureus Long (1917), New Mexico Chapter Phi Kappa Phi, Papers, 1, p. 1
Polyporus angolensis Lloyd (1920), Mycological writings, 6, mycological notes n° 64, p. 997
Polyporus medullae Lloyd (1924), Mycological writings, 7, mycological notes n° 73, p. 1330
Ungulina soloniensis (Dubois) Bourdot & Galzin (1925), Bulletin de la Societe mycologique de France, 41, p. 180
Piptoporus soloniensis (Dubois) Pilat (1937), Atlas des champignons de l'Europe, 3, Polyporaceae, p. 126
Fomitopsis komatsuzakii (Yasuda) Imazeki (1943), Bulletin of the Tokyo science Museum, 6, p. 92
Tyromyces sambuceus (Lloyd) Imazeki (1943), Bulletin of the Tokyo science Museum, 6, p. 84
Tyromyces trichrous (Berkeley & M.A. Curtis) J. Lowe (1975), Mycotaxon, 2(1), p. 51
Piptoporellus soloniensis (Dubois) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016), Fungal diversity (Hong Kong), 80, p. 361 (nom actuel)
References : IH1 768 (Tyromyces sambuceus) ; IOH p. 462 (T. sambuceus)
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Incertae sedis
Chapeau/Fructification : Basidiocarpe annuel, substipite au centre, lateralement ou sessile, circulaire a dimidie, solitaire ou imbriques, 10-20 et jusqu'a 30 cm de diametre, surface superieure finement tomenteuse a glabre, non zonee, ruguleuse, creme chamois a saumon ocrace pale. Marge aigue a arrondie, vallonnee et souvent incurvee, concolore.
Lames/Pores : Hymenium pore chamois pale a chamois cannelle, pores circulaires a anguleux, 5-6 par mm, a cloisons plus moins epaisses et finement fimbriees; contexte souple, fibreux-spongieux, devenant presque pulverulent chez les vieux specimens, non zone, chamois a chamois rosatre pale, jusqu'a 2 cm d'epaisseur. Couche de tubes concolore au contexte ou creme plus pale, fragile sur le sec, 3-15 mm d'epaisseur .
Chair : 3 cm d'epaisseur, tendre et charnu sur le frais, devenant fibreuse et tres legere en sechant.
Stipe : Rudimentaire, central, lateral ou absent (chapeau dimidie).
Habitat : Sur feuillus morts ou moribonds. En Europe, a ete recoltee uniquement sur Castanea et Quercus. Pourriture brune cubique.
Spores : Ellipsoides, hyalines, lisses, non amyloides, 4,5-6 x 3-4 µm.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Une espece cosmopolite rare, mais plutot commune au Japon et dans le sud des Etats-Unis. Bien que decrite de France, elle est tres rare en Europe ou elle semble limitee a la partie centrale et non signalee depuis en Europe du Nord ni en region mediterraneenne.

Synonymes : Russula subnigricans Hongo (1955), Journal of Japanese botany, 30, p. 79 (Basionyme)
References : IH1 581 ; Eyssartier et Roux p. 42 ;
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : (5)8-11(15) cm, convexe puis plan et deprime au centre, enfin en entonnoir, surface seche, su peu veloutee, brun grisatre a brun fuligineux, plus pale a la marge. Cuticule peu separable.
Lames/Pores : adnees ou subdecurrentes, 6-9 mm de large, espacees, rougissant au froissement, moyennement epaisses, fragiles.
Chair : epaisse, dense et dure, blanche, rougissant a la coupe, mais sans noircir comme R. nigricans, a laquelle elle ressemble, (elle grisonne parfois legerement apres plusieurs heures)n pratiquement insipide et inodore.
Stipe : 3-6 x 1-2,5 cm, egal ou attenue a la base, plus pale que le chapeau, discretement ridule longitudinalement, plein.
Habitat : Rare mais en troupe en forets de feuillus, surtout de chenes verts et Castanopsis.
Spores : 7-9 x 6-7 µm, subglobuleuses a globuleuse-ovoides, ornees de fines verrues reliees en fin reseau. Cheilo et pleurocystides 53-88 x 9,5-12,5 µm.
Comestibilite : Mortel
Commentaires : Si les Europeens n'ont pas couru grand danger jusqu'ici avec les russules, c'est aussi peut-etre parce qu'elles sont dedaignees par les ramasseurs, surtout le sous-genre Compacta qui est le plus suspect sur le plan toxicologique. Helas, non seulement les russules mortelles existent bien, mais elles ont la chair douce! En 1954, le mycologue japonais Tsuguo Hongo, charge d'enquete a la suite du deces d'une personne a Kyoto, retrouve des russules blanches dans les restes du repas. En 1958, deux nouveaux deces, dans des localites differentes pres d'Osaka, permettent de preciser le lieu de recolte, et une russule ressemblant a Russula nigricans, est incriminee. La forme et la couleur sont tres semblables, mais cette nouvelle espece rougit sans jamais noircir a la coupe. Hongo la nommera Russula subnigricans, mais le russulologue Toshiho Ueda distingue aujourd'hui trois ou quatre "varietes" inedites dans le "complexe subnigricans". Pour la premiere fois au monde une russule figure sur la liste des especes mortelles. Toutefois, la rarete de ces especes aidant, aucune intoxication n'a ete signalee ensuite dans l'archipel jusqu'en 1993. On songe alors a d'eventuels pesticides, mais en 1992 les chimistes Takahashi et coll. isolent six ethers chloro-phenyl (Russupheline A-F) dans le champignon et mettent en evidence leur toxicite sur la cellule. Puis a Taiwan en 1998, neuf personnes souffrent de nausees, vomissements et diarrhees avec agitation deux heures apres avoir partage une soupe aux russules. Deux d'entre elles presentent, en plus, une rhabdomyolyse et une insuffisance renale severe. Russula subnigricans est incriminee une fois de plus, mais cette fois avec une affection encore inconnue en mycotoxicologie: la necrose des muscles stries ou rhabdomyolyse, qui fera encore parler d'elle peu de temps apres avec les intoxications causes par le bidaou en France. La derniere intoxication remonte a aout 1995 a Toyohashi, qui fut fatale a un couple de mycophages sexagenaires. Arora, 1986- Mushrooms Demystified (2° ed.), page 90 Bills, 1985- Brittonia 37, page 360-365 Eyssartier et Roux, 2011- Guide des Champignons p. 42 Guez, 2002- Lettre de la SMF n° 0 Halling & Mueller, 1999-Nybg.org/bsci/res/hall/..., page html pl. n° 136 Hongo, 1955- Journ. Jap. Bot. 30(3): 79 Imazeki & Hongo, 1989 原色日本新菌類図鑑 (Colored Illustrations of Mushrooms of Japan), Vol. II, pl. n° 581 Imazeki, Otani & Hongo, 1988-日本のきのこ(Fungi of Japan) planche p.359 Shaffer, 1962-Brittonia 14(3), page 254-284

Synonymes : Amanita abrupta Peck (1897), Bulletin of the Torrey botanical Club, 24(3), p. 138 (basionyme) (nom actuel)
Lepiota abrupta (Peck) E.-J. Gilbert & Kuhner (1928), Bulletin de la Societe mycologique de France, 44, p. 151
Aspidella abrupta (Peck) E.-J. Gilbert (1940), Iconographia mycologica, 27, supplement 1(1), p. 79
Amanita sphaerobulbosa Hongo (1969), Journal of Japanese Botany 44, p. 230
References : IH1 229 ; IOH p. 169
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 3-8 cm, spherique puis etale, orne de nombreuses petites verrues coniques tres detersiles.
Lames/Pores : libres, serrees, inegales; blanches, puis creme rosatre.
Chair : blanche, a odeur rance, desagreable.
Stipe : 7-14 x 0,5-2 cm, squamuleux-mechuleux, a bulbe brutalement margine, anneau membraneux supere, ample, pendant, blanc.
Habitat : Peu frequent en ete et en debut d'automne en forets de feuillus, mycorhizes frequentes avec les Fagacees; Amerique du Nord orientale, Japon : Fagus spp. (hetres), Betula spp. (bouleaux), Abies spp. (sapin), Tsuga spp. (tsuga), Quercus spp. (chenes), Pinus spp. (pins) et Populus spp. (peupliers).
Spores : subglobuleuses 7-8,5 µm, amyloides.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : Sous-genre Lepidella/section Lepidella/stirpe Microlepis Les jeunes specimens ressemblent a de petites halteres.

Synonymes : Bovista craniiformis Schweinitz (1832), Transactions of the American philosophical Society, series 2, 4(2), p. 256 (Basionyme)
Calvatia craniiformis (Schweinitz) Fries (1849), Summa vegetabilium Scandinaviae, 2, p. 442 (nom actuel)
References : IH2 885 ; IOH p. 510-511
Groupe : Vesses de loup
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Lycoperdaceae
Chapeau/Fructification : Carpophore 6-18 cm, oboval ou turbine, base etranglee stipitiforme; exoperidium tres mince, lisse, d'abord blanchatre a isabelle, puis de plus en plus fonce jusqu'a "pain grille" ou grisatre, souvent plisse se dechirant et s'exfoliant a maturite.
Chair : blanche et ferme au debut puis cotonneuse a maturite, jaune olivatre
Stipe : Blanc a la coupe, puis brun jaunatre.
Habitat : Saprophytique, juin-novembre. Commun au Japon a terre en sous-bois, sur les chemins, lisieres etc. Plus rare, plus pale et plus tardif en Amerique du Nord.
Spores : 3-4 µm, globuleuses, finement echinulees, malgre leur aspect pseudo-lisse, tres courtement pedicellees
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Sporee jaune. Juin-Nov. Commun a terre en sous-bois, sur les chemins etc. Grosse tete globuleuse et base sterile courte. 10 x 10cm env. Exoperidium d'abord blanchatre a isabelle, puis de plus en plus fonce jusqu'a "pain grille", se dechirant et s'exfoliant a maturite. Blanc a la coupe, puis brun jaunatre. Spores en masse jaunes, disseminees par le vent. A la fin, il ne subsiste que la base sterile en turbine. Une autre espece, a spores violettes (inedite?), sumire-hokori-take.

Synonymes : Russula kansaiensis Hongo (1979), Journal of Japanese botany, 54(10), p. 305
References : IH2 610
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 1-2 cm, convexe puis plan, deprime au centre, enfin creuse en entonnoir, cuticule visqueuse par l'humidite, rouge violace a rouge vineux, generalement plus fonce au disque, palissant dans la vieillesse, jusqu'a devenir blanchatre, cannelee radialement.
Lames/Pores : libres, assez espacees a espacees, interveinees, 3-6 mm de large, arrondies a la marge, blanc-creme.
Chair : mince, fragile, blanche, insipide et inodore.
Stipe : 1-2 x 2-4 cm, egal ou epaissi a la base, subtilement ride longitudinalement, blanc puis jaunatre, spongieux puis creux.
Habitat : Pas rare en ete-debut d'automne sous Castanopsis, Quercus serrata et Q. acutissima, ou bois meles Quercus-Pinus. Japon (Kyoto, Shiga). Signale en Chine et en Coree (?)
Spores : Sporee creme pale. Spores 7,5-9,5 x 6-7,5 µm, largement ellipsoides, echinulees. Pleurocystides 40-47 x 8,5-14 µm, clavees et mucronees au sommet. Cheilocystides 30-37 x 7-12 µm, en grand nombres, semblables aux pleurocystides; Cuticule d'hyphes filamentiformes, gelifiee, dermatocystides intriquees.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Evoque une petite Russula puellaris d'Europe par sa tres petite taille, saveur douce, sporee creme, son chapeau vineux a tache centrale sombre et cannele, mais sa sporee est un peu plus pale et l'habitat plus limite aux Fagacees penetropicaux.

Synonymes : Lactarius gracilis Hongo (1957), Journal of Japanese botany, 32, p. 144 (Basionyme)
Lactarius squamulosus Z.S. Bi & T.B. Li (1987), Bulletin of botanical research, Harbin, 7(4), p. 83
References : IH1 630 ; Mycologia 99(2) p. 263
Groupe : Lactaires
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 1-2,5 cm, conique a plan, puis un peu deprime en entonnoir, mais toujours avec un mamelon conique saillant au centre. Revetement sec, sans zones concentriques, finement granuleux a feutre, rompu-craquele sous la loupe en squamules de couleur brun a brun grisatre au disque, brun pale vers la marge. Poils rudes sur la marge qui apparait dentelee dans la jeunesse par des meches coniques dressees.
Lames/Pores : adnees-decurrentes, souvent fourchues, assez serrees a assez espacees, creme carne pale, se tachant de brun orange au froissement, 2 mm de large. Latex blanc, immuable, vite tari.
Chair : mince, legerement teintee de brun pale. Saveur un peu mentholee comme l'odeur, faible de punaise ou de pelargonium.
Stipe : 2-7 x 0,2-0,3(0,6)cm. Mince et long, egal ou attenue au sommet, creux, a revetement brun rougeatre avec des poils brun jaunatre pale a la base.
Habitat : De mai a septembre sous feuillus persistants (Castanopsis et chenes verts), sur mousses ou feuilles mortes, en troupe ou isole. Japon (Hondo et Kyu-shu, plus repandu a l'ouest du Kanto).
Spores : 7-7,8 x 6-6,8µm, subglobuleuses, ornees de verrues saillantes avec reticulum epais. Sporee creme. Pleurocystides 25-28 x 6,5-9,5 µm, cylindro-clavees (en massue), assez peu evidentes.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Ce lactaire a un port trompeur de Laccaria par sa petite taille et son pied grele (inde nomen), est aussi remarquable par sa marge hirsute (cutis rompu en meches triangulaires dressees) et ses lames se tachant de brun orange. Commentaires de Marcel Bon sur les exsicata : Rhysocybe pour leur revetement celluleux mais marge + trichodermique. Classement vers Tabidi ou Olentes Obscurati et si odeur differente cf. serifluus (micro possible). Spores subglobuleuses, subreticulees. Cystides? Suprapellis +/- celluleux (Rhysocybe, sauf marge + trichodermique)

Synonymes : Tricholoma muscarium E. Kawamura ex Hongo (1959), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 9, p. 62 (Basionyme)
References : IH1 103 ; IOH p. 81
Groupe : Tricholomes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Tricholomataceae
Chapeau/Fructification : 4-6 cm, convexe ou conique puis plus ou moins plan, toujours avec un mamelon saillant au centre. Cuticule a peine lubrifiee, glacee luisante, presque entierement separable, olivatre sur fond jaune pale, discretement rayee radialement de fibrilles apprimees surtout visibles vers la marge, plus fonce au disque (gris brun fuligineux). Marge involutee puis etalee, sauf la marginelle qui reste longtemps incurvee.
Lames/Pores : serrees a assez espacees, ascendantes a adnees-arrondies au pied, assez epaisses, 0,6-1 cm de large, blanches, puis jaune citrin pale a creme jaunatre.
Chair : mince et jaune citrin pale dans le chapeau, presque blanche ailleurs. Faible odeur fruitee agreable a la coupe.
Stipe : 5-9 x 0,6-1,5 cm, egal ou epaissi vers le bas a fusiforme, plein puis fistuleux en haut, blanc puis plus ou moins lave de citrin dans la partie superieure.
Habitat : De septembre a novembre dans les bois de feuillus (Quercus glauca, Q. acutissima, etc.) ou meles de pins. Japon.
Spores : 5,5-7,5 x 4-5 µm, courtement ellipsoides. Cheilocystides plus ou moins etroitement cylindriques ou en baton, 35-68 x 8,5-15 µm.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Bien que contenant de l'acide tricholomique et ibotenique, etourdissant ou tuant les mouches comme l'amanite panthere, cette espece endemique est consommee et reputee savoureuse. En grande quantite, elle cause toutefois des nausees comparables a celles dues a l'exces d'alcool.
Pas de photo disponible
Synonymes : Lactarius gerardii Peck (1873), Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences, 1, p. 57 (Basionyme)
Lactifluus gerardii (Peck) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 856 (nom actuel)
References : IH1 624 ; Mille et un Champignons du Quebec ; IOH p. 384
Groupe : Lactaires
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 4-10 cm de diametre, convexe, parfois avec un petit mamelon, puis etale deprime, sec, finement veloute, parfois plisse, brun fonce, puis brun-jaunatre a brun dore.
Lames/Pores : Adnees puis decurrentes, larges, tres espacees, blanchatres a creme.
Chair : Blanche, mince, un peu fragile. Jaunatre KOH. Odeur et saveur peu distinctives.
Stipe : 3-8 x 0,8-1,5 cm, egal, farci puis creux, veloute, sec, concolore au chapeau ou un peu plus pale.
Habitat : Mycorhizique sur le sol dans les bois de Fagaceae (Castanopsis, Quercus, etc.) et bois mixtes coniferes (Pinus-Quercus)
Spores : Ellipsoides a subglobuleuses, reticulees, amyloides, 8-10 x 7-9µm. Cheilocystides discretes.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Rare en Amerique du Nord, Aout a septembre. Assez commun dans tout le Japon de juillet a debut septembre. PS: Fiche suivant l'adaptation de Rolland Labbe.(Cercle des Mycologues de Montreal) et Nagasawa & Hongo.

Synonymes : Calostoma japonicum Hennings (1902), Botanische jahrbucher fur systematik, pflanzengeschichte und pflanzengeographie, 31(4), p. 738 (Basionyme) (nom actuel)
Mitremyces japonicus (Hennings) Saccardo & D. Saccardo (1905), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 17, p. 225
References : IH2 867 ; IOH p. 503
Groupe : Vesses de loup
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Calostomataceae
Chapeau/Fructification : 0,5-1 cm de hauteur, 0,5-0,8 cm de diametre, subglobuleuse a oblongue-elliptique, jaune d'ambre a brun jaunatre, surface d'abord lisse, bientot rugueuse se craquelant ca et la, le sommet se fissurant autour d'un opercule de couleur rouge, qui se detache en laissant apparaitre un cratere incise en forme plus ou moins etoilee (5 a 7 lobes), egalement de couleur rouge vif.
Chair : Base sterile presque entierement hypogee, 3-8 mm de long, brun jaunatre, cartilagineuse formee d'un faisceau de 8 a 15 epais cordons myceliens, difficiles a separer du corps fertile. La chair, a consistance de cuir, est d'un blanc laiteux au stade de primordium, prenant bientot la couleur de la boue qui l'enveloppe par temps humide, enfin brun jaunatre.
Spores : Spores non amyloides, 10-16,5 × 6-9 μm
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Champignon gasteroide, classe dans les Calostomataceae, du genre Calostoma (du grec "belle bouche").
Pas de photo disponible
Synonymes : Amanita rufoferruginea Hongo (1966), Journal of Japanese botany, 41, p. 165
References : IH1 198 ; IOH p. 141 ; Mem. Shiga Univ. Vol.17 p. 27-28 (1967)
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 4,5-9 cm, hemispherique puis convexe, enfin plan ou legerement deprime au centre, plus ou moins strie a la marge qui devient cannelee-tuberculee avec l'age. Revetement sec, de couleur fauve ou plus pale, densement couvert de granules pulverulents detersiles, orange xanthine, jaune de Mars, brun ambre ou brun antique.
Lames/Pores : libres, serrees, blanches, ventrues, 4-7 mm de largeur, subtilement floconneuses sur l'arete, lamellules tronquees.
Chair : Mince, blanche, insipide et inodore.
Stipe : 9 - 12 cm de long, 0,4 - 1 cm d'epaisseur au sommet, 1,3-2 cm a la base qui presente un bulbe oboval ou fusiforme, attenue au sommet, farci ou creux, annule, entierement couvert au dessus comme au dessous de l'anneau, de particules poudreuses ou farineuses, subconcolores (plus clair que "fauve ocrace"), la base ornee debris de volve formant 3-5 bracelets incomplets, pulverulents et fugaces. Anneau plutot ample, pendant en jupette a 1,5-2,5 cm du sommet, membraneux, blanc et strie a la face superieure, fauve ocrace et floconneux-poudre en dessous, souvent dechire, evanescent.
Habitat : Au sol, solitaire ou epars, en ete-debut d'automne, assez rare, vient surtout en forets mixtes de Pinus densiflora-Quercus serrata, au Japon (a l'ouest du Kanto, principalement Hiroshima, Kyoto et Shiga). Egalement signalee en Chine occidentale et en Coree du Sud
Spores : hyalines, globuleuses a subglobuleuses, 7-9 µm, lisses, non amyloides. Basides tetrasporiques. Boucles absentes. Cellules marginales globuleuses, ellipsoides ou un peu piriformes, 14-25 µm de large, etroitement cloisonnees, tres abondantes, formant une large marge sterile le long de l'arete des lames. Granulations du chapeau constituees de courtes chaines de cellules globuleuses a courtement ellipsoides de 17-47 µm de large, a secretion mielleuse.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Recentrage des caracteres sur la diagnose originale de Hongo, amendements de 1967 inclus, la description des recoltes chinoise etant trop disparate, d'ou identite incertaine...

Synonymes : Polyporus volvatus Peck (1875) [1874], Annual report of the New York state Museum of natural history, 27, p. 98, tab. 2, fig. 3-6 (Basionyme)
Polyporus obvolutus Berkeley & Cooke (1878), Grevillea, 7(41), p. 1
Polyporus volvatus var. obvolutus (Berkeley & Cooke) Peck (1880), Bulletin of the Torrey botanical Club, 7(10), p. 105
Polyporus inflatus Ellis & I.C. Martindale (1884), The American naturalist, 18, p. 722
Fomes volvatus (Peck) Cooke (1885), Grevillea, 13(68), p. 119
Fomes volvatus var. obvolutus (Berkeley & Cooke) Saccardo (1888), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 6, p. 166
Fomes volvatus var. helix Hennings (1898), Hedwigia, 37(6), p. 273
Scindalma volvatum (Peck) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 519
Cryptoporus volvatus (Peck) Shear (1902), Bulletin of the Torrey botanical Club, 29(7), p. 450 (nom actuel)
Ungulina volvata var. pleurostoma Patouillard (1907), Bulletin de la Societe mycologique de France, 23(2), p. 74
Polyporus volvatus var. helix (Hennings) Murrill (1908), North American flora, 9(2), p. 94
Cryptoporus volvatus var. pleurostoma (Patouillard) Saccardo (1912), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 21, p. 282
References : BMBDS 116 p. 12 ; IH1 761 ; IOH p. 456
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Polyporaceae
Chapeau/Fructification : D'abord noduleuse-globuleuse, puis semblable a un gros marron de 2,5-5 cm de long, 1-3 cm de projection, 1-2,5 cm d'epaisseur. Surface pileique glabre et lisse, brillante-vernissee, creme blanchatre a grisatre chez le jeune, devenant jaune-brun a chatain fonce a maturite.
Lames/Pores : Face infere plus plane, constituee d'une enveloppe epaisse a consistance de cuir (d'ou l'epithete "« volvatus »), creme, enfermant completement l'hymenium. Hermetiquement close chez le jeune, la cavite se menage bientot un orifice plus ou moins circulaire de 3-10 mm de diametre, a proximite du point d'attache (d'ou le nom generique de « Crypte aux pores »), contre l'ecorce de l'hote. Tubes 2-6 mm de long, blancs puis isabelle a gris-brun sale. Pores minuscules, 3-5 au mm, gris-brunatre.
Chair : 0,5-1,5 cm, blanchatre, assez souple, elastique a consistance de cuir, puis de liege dans le chapeau. Saveur amarescente; odeur composite de resine et de poisson seche.
Stipe : Sessile.
Habitat : Annuel ou bis-annuel, vegete toute l'annee en saprophyte sur divers coniferes moribonds ou morts l'annee precedente, surtout Pinus, mais aussi Abies, Larix, Picea, Pseudotsuga, Tsuga... Amerique du Nord, Japon, Chine, Asie du Sud-Est.
Spores : longuement ellipsoides,10-13 x 4-6 µm, lisses, hyalines, non amyloides. Mycelium trimitique. Sporee rose.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Nous l'avons toujours trouve hebergeant des coleopteres xylophages (Scolytinae) dans la crypte, qui semblent se regaler de l'hymenium, a en juger par le vacarme que font leurs mandibules la nuit suivant la recolte et sur les tables d'exposition. Transformee en mangeoire des que l'ouverture le permet, la resonance semble etre tres amplifiee par la cavite, tendue d'une membrane souple comme une peau de tambour (une vraie membrane de stethoscope!) Le champignon semble etroitement associe a ces insectes qui creusent des galeries, provoquant la « carie blanc-grisatre de l'aubier », ils facilitent certainement la propagation du mycelium, l'ouverture de la crypte coincidant avec la maturite des spores.

Synonymes : Russula omiensis Hongo (1967), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 17, p. 93 (Basionyme)
References : IH1 607
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 3-4,5 cm, convexe puis plan, deprime au disque, visqueuse par temps humide, pruineux-poudre sous la loupe, rouge fonce violace a vineux, plus sombre au centre, souvent tache de rouge et d'olivatre. Marge striee a maturite. Cuticule facilement separable.
Lames/Pores : libres, serrees, blanches, parfois fourchues-anastomosees, 4 mm de large environ.
Chair : blanche, fragile, acre surtout dans le stipe et les lames. FeSO4 et Gaiac tres lent et faible, Phenol tres lent, brun vineux.
Stipe : 5-6 x 0,8-1,1 cm, cylindrique ou epaissi a la base, raye longitudinalement, cotonneux puis creux.
Habitat : Assez commune au printemps (mars-avril) et fin d'automne (novembre-decembre) sur le sol des forets a Castanopsis-Quercus, Japon (Hondo, Shiga, Kumamoto...)
Spores : Spores ovoides, plus grandes et plus arrondies que knauthii,10,5-12 x 9,5-11 µm,10,5-12 x 9,5-11 µm, ornees de verrues epineuses plus grosses reliees en reseau moins regulier, plus lache et a mailles plus entourees, avec des membranes tres minces reliant les spinules.Tache supra-appendiculaire remplacee par une fine resille. Manque d'amyloidite variable. PC cylindracees en tres grand nombre, largement multi-cloisonnees, des clavulees moins frequentes.
Commentaires : Tres precoce, nous l'avons longtemps surnommee la russule du 1er avril. Ressemble a R. fragilis, avec une microscopie proche de R. knauthii selon Dagron (1990), ou de la f. fallax, selon Marcel Bon en 1998, mais le chapeau est pruineux, la spore plus grande, et la fructification printaniere, puis quasi-hivernale la distingue.

Synonymes : Russula virescens f. erythrocephala Hongo (1966), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 16, p. 60
Russula viridirubrolimbata J.Z. Ying (1983), Acta mycologica Sinica, 2(1), p. 34 (Basionyme)
Russula erythrocephala (Hongo) Hongo (1987), Nippon Kingakkai nyusu, 1987, p. 8 (?) (nom. inval.)
References : IH1 598
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 5,5-8 cm de diametre, surface legerement visqueuse par temps humide, subveloutee, rouge carmin a Marocain, vite craquelee en petites plaques montrant la chair rose sous-jacente, sauf au centre qui est souvent vert sombre. Marge courtement striee-tuberculee. Intensite du rouge tres variable, le pigment vert etant plus ou moins resistant.
Lames/Pores : sublibres, serrees, blanches, parfois fourchues.
Chair : assez epaisse, plutot compacte, blanche.
Stipe : 4-6 x 1,2-2 cm, epais, egal ou appointi en bas, blanc, subrivule, spongieux-farci.
Habitat : Solitaire ou disseminees sur le sol en forets mixtes Pinus-Quercus.
Spores : largement ovoides, finement ponctuees de verrues discretement reticulees, non amyloides, mesurant 7-8 x 5,5-6,5 µm.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Decrite du Japon (Shiga et Kyoto) comme une forme rougeatre et cocardee de Russula virescens (le palomet verdoyant y est egalement un champignon tres recherche), elle a ete retrouvee en Chine (Guangxi et Yunnan) par Ying dans un habitat similaire. Merite le rang varietal selon Bon, viva voce.

Synonymes : Lactarius corrugis Peck (1880) [1879], Annual report of the New York state Museum of natural history, 32, p. 31 (Basionyme)
Lactarius volemus var. subrugosus Peck (1885) [1884], Annual report of the New York state Museum of natural history, 38, p. 130
Lactifluus corrugis (Peck) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 856 (nom actuel)
References : IH1 622 ; Phillips (NA) p. 90
Groupe : Lactaires
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 5-12 cm, convexe puis etale-deprime, sec, veloute, tres souvent ride, surtout vers la marge, brun jaunatre a brun-rougeatre fonce ou brun vineux fonce (cacao).
Lames/Pores : adnees a subdecurrentes, assez serrees, d'orange pale ou ocre pale a cannelle, brunissant au froissement. Latex abondant, blanc puis brunissant.
Chair : tres ferme, presque blanche, se tachant de brun peu a peu. Odeur faible de crustaces, saveur douce.
Stipe : 5-8 x 1,5-2,5 cm, egal, plein, tres finement veloute, subconcolore au chapeau.
Habitat : mycorhizique en ete-automne, tres rare en Amerique du Nord orientale (Caryers, Quercus), assez rare au Japon, gregaire ou solitaire sur le sol sous divers Fagaceae (Quercus, Castanopsis)
Spores : subglobuleuses, cretees-reticulees, amyloides, 8,5-12 x 9-11 µm
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Differe de L. volemus par son chapeau plus sombre et tres veine, ainsi que ses spores plus grandes. Toutefois ces trois caracteres differentiels sont inconstants sur les recoltes Nord-Americaines de L. corrugis, comme si elles etaient a mi-chemin entre L. volemus et le L. corrugis nippon.

Synonymes : Agaricus volvatus Peck (1872) [1871], Annual report of the New York state Museum of natural history, 24, p. 59 (Basionyme)
Amanitopsis volvata (Peck) Saccardo (1887), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 5, p. 23
Pseudofarinaceus volvatus (Peck) Kuntze (1891), Revisio generum plantarum, 2, p. 868
Amanita volvata (Peck) Lloyd (1898), Mycological writings, 1, a compilation of the Volvae of United States, p. 15 (nom actuel)
Vaginata volvata (Peck) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 539
Amidella volvata (Peck) E.-J. Gilbert (1940), Iconographia mycologica, 27, supplement 1(1), p. 77
References : Champignons du Quebec T 2 ; IH1 219 ; IOH p. 161
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 5-10 cm de diametre, conique-arrondi a convexe puis etale, orne de meches ou de flocons velaires plus fonces sur fond blanc au debut, puis brun carne a lilas vineux, brun rougeatre avec l'age, a marge entiere ou courtement striee a maturite.
Lames/Pores : Blanchatres, brunissant lentement au frottement avec l'age.
Chair : Blanchatre. Odeur et saveur peu remarquable. Cotonneuse dans la moelle du pied qui est cortique et caverneux, virant legerement au rose a la coupe, puis jaunissant faiblement avant de redevenir blanchatre. Chair du bulbe brunatre sale a la coupe,
Stipe : 6-14 x 0,5-1,5(2)cm, separable, cortique (3-5 mm), charnu cotonneux au centre (5-6 mm) puis caverneux, de plus en plus epaissi vers la base, bulbeux, squamuleux, blanc puis brunatre subconcolore, emergeant d'une volve epaisse, revetue d'une fine cuticule separable brun ocrace pale a brun carne(comme celle d'une pomme de terre cuite). Anneau absent. Bulbe separable
Habitat : Mycorhizique sur le sol des vieilles forets de feuillus, Quercus, Tilia etc.. Amerique du Nord orientale, Chine, Japon, littoral russe extreme-oriental
Spores : Elliptiques, lisses, amyloides, 7-12(14) x (4,5)6-7,5 µm. Basides a 4 sterigmates.
Comestibilite : Mortel
Commentaires : Rare en Amerique du Nord ou A. volvata differe de A. pseudovolvata par sa taille et ses spores plus grandes. Pas rare en Extreme-Orient ou elle se distingue, parfois difficilement, de formes ou varietes mal debrouillees comme A. avellaneosquamosa (S. Imai) S. Imai, A. clarisquamosa (S. Imai) S. Imai in E.-J. Gilbert, et A. duplex Corner & Bas. La consommation d'Amanita volvata a provoque des troubles tres serieux, en plus de l'atteinte gastro-intestinale (vomissement, diarrhee) une perte de la parole, atteinte renale et des troubles neurologiques varies, ayant au moins une fois occasionne la mort. Le principe toxique est a l'etude.
Pas de photo disponible
References : IH1 220 ; IOH p. 160
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 7,5-10 cm de diametre, d'abord hemispherique a convexe, devenant plan a legerement deprime avec l'age. Surface un peu visqueuse par l'humidite, blanche, floconneuse-poudreuse, non striee, recouverte d'un ou plusieurs grands fragments de volve membraneux, ocrace pale, fugaces. Marge appendiculee dans la jeunesse.
Lames/Pores : libres mais effleurant le pied par une ligne decurrente, blanchatres a creme, serrees, 7-10 mm de large, arete finement flocculeuse.
Chair : blanche a blanchatre, epaisse au disque, de plus en plus mince vers la marge. Saveur douce, odeur agreable.
Stipe : 11-13 cm de long, 1,2-1,5 cm d'epaisseur, legerement attenue au sommet, avec a la base un bulbe massif, clave, fusiforme ou en navet, souvent radicant, blanc, flocculo-squamuleux ou poudreux. Anneau apical blanc, floconneux et membraneux, assez epais, se dilacerant en morceaux lors de la croissance du chapeau. Volve creme ocrace adherant au bulbe du pied, parfois laissant quelques traces concentriques, en forme d'anneaux incomplets, sur le bulbe.
Habitat : de juillet a octobre en forets mixtes (Pinus densiflora et Quercus serrata, etc.), Japon (Honshu)
Spores : 7-9 x 5,5-6 µm, hyalines, largement ellipsoides, lisses, a cloisons minces, amyloides. Basides tetrasporiques, 34-38 x 7-10 µm. Cellules marginales 18-60 x 13-28 µm, subglobuleuses, piriformes, elliptiques ou clavees, hyalines, a cloisons minces. Trame des lames bilaterale. Residus de voile general sur le chapeau constitues de tres nombreuses hyphes de 1-10,5 µm d'epaisseur et de cellules globuleuses, ellipsoides, piriformes et clavees moins nombreuses 28-67 x 15-51 µm
Comestibilite : Inconnu

Synonymes : Oudemansiella brunneomarginata Lar.N. Vassiljeva (1950), Notulae systematicae e sectione cryptogamica Instituti botanici nomeine V.L. Komarovii Academiae scientificae USSR, 6, p. 197 (Basionyme)
Mucidula brunneomarginata (Lar.N. Vassiljeva) R.H. Petersen (2010), Beihefte zur Nova Hedwigia, 137, p. 267 (nom actuel)
References : IH1 154 ; IOH p. 121
Groupe : Collybies
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Physalacriaceae
Chapeau/Fructification : 3-15 cm
Lames/Pores : adnees, assez espacees, larges, a arete nettement bordee de brun fonce.
Stipe : 4-10 x 0,4-1 cm, egal, creux, chine de brun.
Habitat : En automne dans les forets de feuillus thermophiles, en colonies sur bois ou tronc mort, surtout erables (Acer mono), bouleaux (Betula ermanii), tilleuls (Tilia japonica) etc. Littoral oriental russe, Japon.
Spores : 14-20 x 9,5-12 µm, baside tetrasporique.
Comestibilite : Comestible

Synonymes : Protubera nipponica Kobayasi (1938), in Nakai & Hondo, Nova Flora Japonica, 2, p. 25 (Basionyme)
Kobayasia nipponica (Kobayasi) S. Imai & A. Kawamura (1958), Science reports of the Yokohama national University, section II, 7, p. 5 (nom actuel)
References : IH1 911 ; IOH 525
Groupe : Vesses de loup
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Phallales / Phallaceae
Chapeau/Fructification : Sporophore globuleux, hypoge ou semi-hypoge, 2-5 cm de diametre, ayant l'aspect d'un scleroderme mais gelatineux sous l'ecorce et beaucoup plus lourd qu'un œuf de Phallus impudicus. Surface blanche a brun jaunatre pale,
Chair : tres visqueuse comme une huitre, capillitium et spores enfermes dans la masse gelatineuse, cerebriforme.
Stipe : absent
Habitat : Ete-automne, sylvatique, plutot sous les pins. Japon (partout), signale recemment en Chine (sud Yunnan).
Spores : Basides en massues a 6-8 sterigmates. Spore hyaline a verdatre sombre, lisse, ellipsoide 4,2-4,9 x 1,8-2,1 µm
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Signale egalement en Chine par Lui Pei Gui(1994) qui propose le retour dans le genre de depart, Protubera.

Synonymes : Xerocomus nigromaculatus Hongo (1966), Journal of Japanese botany, 41, p. 170 (Basionyme)
Boletus nigromaculatus (Hongo) Har. Takahashi (1992), Nippon Kingakkai nyusu, 19, p. 38 (nom actuel)
References : IH1 536
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 2-7 cm, surface seche, un peu granuleuse, brun argilace, noircissant au toucher et avec l'age, parfois entierement noir a la fin.
Lames/Pores : tubes adnes a echancres, legerement decurrents au contact du pied, d'abord jaunes puis brun olivaces. Pores polygonaux, amples, bleuissants au toucher, puis noircissants.
Chair : molle, blanchatre a jaune pale, bleuissant puis rougissant a l'air, enfin noircissant. Parfois rougit d'emblee sans bleuir (surtout le stipe).
Stipe : 2-5 x 0,5-1 cm, ferme et cassant, plus pale que le chapeau, brun pale, noircissant au froissement. strie longitudinalement au sommet, la base souvent enveloppee de coton mycelien.
Habitat : en ete et automne, dans les bois meles de fagacees et Pinus densiflora, ou Abies firma en melange avec Castanopsis. Japon central, signale a Taiwan
Spores : fusiforme-ellipsoide, lisse, 7,5-10,5 x 3,5-4 µm (parfois 9,5-12,5 x 3-5 µm). Sporee brun olivace.
Comestibilite : Comestible

Synonymes : Hygrophorus pinetorum Hongo (1954), Acta phytotaxonomica et geobotanica, Kyoto, 15(4), p. 103 (Basionyme) (nom actuel)
Hygrophorus hypothejus f. pinetorum (Hongo) Hongo (1958), Journal of Japanese botany, 33, p. 97
References : IH1 25 ; IOH p. 36 ; JJB 33: 97 (1958) Hongo, T. Studies on the Agaricales of Japan 1. The genus Hygrophorus in Shiga-Prefecture (1)
Groupe : Hygrophores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Hygrophoraceae
Chapeau/Fructification : 1-3 cm, pulvine puis plan, enfin deprime au centre, souvent avec une papille saillante. Marge le plus souvent infractee ou recurvee, la marginelle restant droite, striee par transparence, erodee ou fimbriee. Cuticule visqueuse (baiser collant), mince, separable, fragile, gelifiee surtout au disque, jaune brun olivace, jaune de bronze a jaune de miel, brun de suie a bistre fonce, rarement alutace roussatre a orange fauve, palissant avec l'age. Le disque et surtout la papille sont plus sombre, jusqu'au brun noir fuligineux. Revetement tapisse de fibrilles radiales denses, brunatre fonce, surtout visibles a la marge.
Lames/Pores : moyennement serrees a espacees, arquees a decurrentes, jaune citrin pale plus ou moins orange avec l'age, inegales
Chair : fibreuse et tendre, blanc lave de citrin, jaune orange sous la cuticule, puis orange rougeatre a la corruption. TL4, KOH, Gaiac, Phenol et FeSO4 nuls. Odeur et saveur peu remarquables.
Stipe : 2-4 x 0,2-0,6 cm, plus ou moins sinueux, egal ou attenue en bas, fragile, farci, raye longitudinalement de fibrilles jaunatres dans la partie superieure, pruineux blanchatre vers le bas. Entierement jaune chez les jeunes specimens.
Habitat : De novembre a janvier, dans les bois de Pinus densiflora, a terre parmi les mousses glacees et debris et aiguilles de pin. Japon.
Spores : oblongues a elliptiques, 7,5-9,5 x 4-5,5 µm. Baside tetrasporique 6-8 µm de large, sterigmate 6-7 µm de long. Trame des lames bilaterale. Pileocutis gelifie en ixotrichoderme. Hyphes terminales 100 µm ou plus x 3-4 µm.
Comestibilite : Comestible

Synonymes : Boletus ravenelii Berkeley & M.A. Curtis (1853), The annals and magazine of natural history, series 2, 12, p. 429 (Basionyme)
Suillus ravenelii (Berkeley & M.A. Curtis) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 536
Pulveroboletus ravenelii (Berkeley & M.A. Curtis) Murrill (1909), Mycologia, 1(1), p. 9 (nom actuel)
Ixocomus ravenelii (Berkeley & M.A. Curtis) E.-J. Gilbert (1931), Les Bolets. Les livres du mycologue, 3, p. 76
References : IH1 540 ; IOH p. 313 ;
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 4-10(13) cm de diametre, brusquement arrondi a convexe, puis incompletement etale. Revetement sec, glabre, devenant viscidule par l'humidite, densement recouvert de particules tomenteuses a pulverulentes qui cedent a la pression des doigts, jaune citrin a jaune soufre vif dans la jeunesse, souvent brun rougeatre a brunatre au centre, plus ou moins craquelee areolee. Marge entiere, incurvee chez les jeunes, typiquement appendiculee de restes de voile partiel.
Lames/Pores : Subcirculaires a anguleux, petits, 1 a 3 par mm, 0,5-1 mm de large, concolore aux tubes. Tubes 0,5-1,5 mm de hauteur, presque libres chez l'adulte, d'abord jaune pale a jaune vif, virant au bleu intense a verdatre a la blessure, puis au brun a noiratre avec l'age.
Chair : Consistance molle, blanchatre ou plus ou moins teintee de jaunatre, 1-2 cm d'epaisseur, bleuissant legerement a la coupe, bleu verdatre a l'ecrasement au dessus des tubes, puis legerement grisonnante. Odeur faible, insipide a amariuscule. Reaction rose sur cuticule et chair a l'acide nitrique (HNO3).
Stipe : Egal a elargi vers la base, 4-10(11) x 0,7-1,5 cm, ou de forme irreguliere, sec, souvent radicant, parfois assez profondement enfoui dans le substrat. Voile partiel membraneux puis araneeux couvrant entierement l'hymenium chez le jeune, cedant en laissant un anneau fugace. Revetement fibrilleux entierement poudre de jaune citrin a soufre au dessous de la zone annuliforme. Chair du stipe ocracee a pale ou blanchatre, jaune intense a la base, immuable ou avec une legere teinte rosee, si exposee.
Habitat : Ete a automne en Asie et au Quebec (plus tardif sur la cote pacifique de l'Amerique du Nord), isole ou par deux, a terre, assez commun en forets de coniferes en Asie orientale et Asie du Sud-Est (Japon, Chine, Taiwan, Malaisie), plus rare dans les forets mixtes d'Amerique du Nord surtout orientale (Pinus, Quercus, Tsuga, Populus, Betula). Present au Mexique, a l'ouest du Texas, Michigan et Californie. Signale egalement au Costa Rica, Colombie et du nord-est de l'Australie.
Spores : Ellipsoide-fusoides a ovoides, lisses, a paroi moderement epaisse, brun pale, 8-13 x 4,5-6,4 µm. Basides a 4 spores geantes, hyalines, claviformes. Cheilocystides hyalines, fusoides a subcylindriques, 50-70 x 10-14 µm, a paroi mince.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Vient souvent a la base des souches de coniferes, entre les racines, suggerant un champignon lignicole et a ce titre considere comme saprophyte par certains auteurs. Comestible peu estime en Asie. Aurait ete utilise en pharmacopee chinoise et en teinturerie.

Synonymes : Boletus violaceofuscus W.F. Chiu (1948), Mycologia, 40(2), p. 210 (Basionyme)
References : IH2 545 ; IOH p. 318-319
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 4-9 cm, convexe, brun violace puis bleu violet a violet fonce, surface lisse, finement veloutee, viscidule.
Lames/Pores : Tubes sinueux, libres, deprimes autour du stipe, d'abord blanc, jaunissants avec l'age. Sporee brun olivace.
Chair : epaisse, blanchatre, immuable.
Stipe : 6-8 cm x 1-1.5 cm, cylindrique, attenue vers l'apex, concolore au chapeau ou plus pale, fortement reticule de veines blanchatres.
Habitat : Chine (Kwangtung, Kwangsi, Guizhou), Japon, Taiwan.
Spores : 19-21 x 6,5-9 µm, subfusiformes.
Comestibilite : Bon comestible

Synonymes : Russula mariae Peck (1872) [1871], Annual report of the New York state Museum of natural history, 24, p. 74 (Basionyme)
Russula alachuana Murrill (1938), Mycologia, 30(4), p. 362
Russula subviridella Murrill (1943), Lloydia, 6, p. 218
Russula subcyanoxantha Murrill (1943), Lloydia, 6, p. 217
non ss. Singer nec Hongo (= R. bella) ;
R. amoena ss. Hongo 1967, 1989, non Quel. ;
R. punctata Krombh. ss. Kawamura 1929, 1954
References : Kauffman (1918) p. 143 ; IH1 595 (s.n. R. amoena) ; Mille et un champignons du Quebec
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 3-9 cm, pruineux-veloute, de couleur tres variable, carmin sombre, violet rougeatre ou violet brunatre, la marge legerement striee seulement dans la vieillesse, et arete parfois rose-pourpree.
Lames/Pores : etroitement adnees ou a peine decurrentes, plutot etroites, egales, serrees a peu espacees, blanche, puis d'un creme terne, souvent fourchues a la base.
Chair : epaisse, compacte dans la jeunesse, blanche, parfois rougeatre sous la cuticule. Blanche et immuable egalement dans le stipe. Saveur douce ou rarement acriuscule. Odeur peu remarquable.
Stipe : 3-9 x 0,8-1,5 cm, epais, subegal ou attenue a la base, revetement au toucher gras, pruineux, teinte de rose rouge a violace sombre, surtout dans la partie mediane et parfois d'un seul cote, rarement entierement blanc, excepte aux extremites.
Habitat : Ete-automne, vient en troupe sous feuillus, parfois aussi sous coniferes. Peu commune en Amerique du Nord. Pas rare au Japon.
Spores : Sporee creme a ocre pale (C-D). Spores subglobuleuses, 7-8,5(9,5) x 6,5-7,5(8)µm, ornees de verrues reliees en filet par de hautes cretes (-1µm), amyloides. Pleurocystides abondantes, lanceolees, 70-90 x 11,5-13,5 µm, pileocystides 55-87 x 3,5-5,5 µm.
Commentaires : R. mariae, qui semble etre le pendant de Russula amoena cote Pacifique et qui est decrite avec des couleurs hyper-saturees, convient bien mieux aux specimens japonais ou elle est assez commune sous le nom de R. amoena.

Synonymes : Flammula bella Massee (1914), Bulletin of miscellaneous information - Royal botanic Gardens, Kew, 1914(2), p. 74 (Basionyme)
Phylloporus bellus (Massee) Corner (1971) [1970], Nova Hedwigia, 20(3-4), p. 798 (nom actuel)
References : Corner, E.J.H. 1970 : Phylloporus Quel. and Paxillus Fr. in Malaya and Borneo ; IH1 532 ; IOH p. 296
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 2–6 cm, convexe puis plan ou deprime avec l'age, revetement pileique subtomenteux a velutineux, devenant fibrilleux a subsquamuleux, jaune orange a brun sombre, virant au bleu violace a l'ammoniaque. Chair blanche, jaune pale avec l'age. Bleuissant ou non au froissement.
Lames/Pores : Hymenophore lamelle, decurrent. Lames assez serrees a espacees, non anastomosees a sub-interveinees, rarement fourchues, jaune sulfurin, immuables ou legerement teintees de bleu verdatre pale au froissement.
Stipe : 3–7 x 0,5–1 cm, egal, rarement clave. Revetement sec, glabre, puis subglabre, jaune cannelle pale dans la moitie superieure, jaunatre sale dans la moitie inferieure, ponctue avec l'age; base (mycelium basal) blanche. Ferme et plein. Chair blanchatre a isabelle ou cannelle pale, bleuissante ou non.
Habitat : Semble etre l'espece la plus cosmopolite du genre. Asie du Sud-Est (Indonesie, Singapour), Japon, Costa-Rica, Mexique, en forets de feuillus. Assez commun au Japon ete-automne dans les hetraies pures ou melees de Quercus-Castanopsis ou de Pinus.
Spores : Sporee olive, spores 9–11 x 3.5–4.5 µm, larmiformes a subfusoides; non amyloides. Basides 30–38 x 7-10 µm, clavees, hyalines, 4-sterigmates. Cystides nombreuses clavees-ventrues a utriformes sur les faces et aretes des lames, 32–80 x 7,5–18 µm, obtuses ou mucronees. paroi mince, Pigment incrustant parfois present. Trame des lames bilaterale. Boucles absentes.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : Longtemps donne comme comestible, mais certaines personnes ayant ete victimes de malaises ou de legeres intoxications, il est prudent de s'abstenir de la consommer.

Synonymes : Boletus ballouii Peck (1912) [1911], Bulletin of the New York state Museum, 157, p. 22, 106, tab. 8, fig. 1-5 (basionyme)
Gyrodon ballouii (Peck) Snell (1941), Mycologia, 33(4), p. 422
Tylopilus ballouii (Peck) Singer (1947), The American midland naturalist, 37(1), p. 104
Rubinoboletus ballouii (Peck) Heinemann & Rammeloo (1983), Bulletin du Jardin botanique national de Belgique, 53(1-2), p. 295
Gyroporus ballouii (Peck) E. Horak (2011), Malayan Forest Records, 51, p. 42 (nom actuel)
References : IH1 568 ; IOH p. 334
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Gyroporaceae
Chapeau/Fructification : Mesurant 2,5-10-(12)cm, convexe puis presque plan avec l'age ; revetement pileique sec, quasi lisse a finement veloute, couleur vive rouge orange dans la jeunesse, ternissant rapidement en brun rougeatre sombre, brun cannelle a tan. Jaunissant a l'ammoniaque. FeSO4 gris verdatre.
Lames/Pores : Surface poree presque blanche, se tachant de brun jaunatre a brun olivace au toucher; pores circulaires, 1-2/mm ; tubes jusqu'a 1 cm de profondeur.
Chair : Blanche et molle. Odeur indistincte. Saveur souvent un peu amere. NH4OH nul sur la chair. FeSO4 gris bleuatre.
Stipe : Mesurant 3-7(-12)cm × 0,5-3 cm, egal ou clave en bas; sec et lisse ou finement reticule en haut, concolore (orange vif) dans la jeunesse, bientot palissant puis jaunatre a blanchatre dans la vieillesse.
Habitat : Mycorhize en ete-automne avec Quercus spp. (chenes) et Fagus spp. (hetres), Pinus densiflora (pin rouge du Japon), Castanopsis spp., isole ou generalement en petits groupes epars, parfois en colonie. Amerique du Nord orientale, Malaisie, Singapour, ouest du Japon.
Spores : Sporee brun jaunatre pale a brun rougeatre. Basidiospores mesurant 5,5-8,5(-10) × 3-5 µm, ovoide a elliptique. Pleurocystides mesurant 40-75 × 9-12 µm.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Remarquable sur le frais par ses couleurs criardes orange rougeatre vif et ses pores blanchatre brunissants au toucher.

Synonymes : Polyporus coccineus Fries (1851), Nova acta regiae Societatis scientiarum Upsaliensis, series 3, 1, p. 67 (Basionyme)
Fomes coccineus (Fries) Cooke (1885), Grevillea, 14(69), p. 21
Scindalma coccineum (Fries) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 518
Polystictus coccineus (Fries) Lloyd (1916), Mycological writings, 5, letter n° 62, p. 7
Pycnoporus sanguineus ss. auct. jap.. plur.
Pycnoporus coccineus (Fries) Bondartsev & Singer (1941), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 39(1), p. 59 (nom actuel)
References : IH1 782 ; IOH p. 468
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Polyporaceae
Chapeau/Fructification : le plus souvent dimidies, sub-hemispheriques, largement soudes au support, plus rarement retrecis au point d'attache, 3-10-(15)cm de diametre x 0,4-0,7-(1) cm, surface unie, glabre puis veloutee au toucher comme une peau de chamois, d'abord rouge orange a rouge corail, palissant avec le temps et les intemperies. Marge obtuse, concolore ou rarement jaune orange.
Lames/Pores : Surface inferieure poree, rouge orange a rouge vif, "sang de dragon". Pores minuscules, 6-8/ mm. Tubes concolores 1-2 mm de long, contrastant vivement, a la coupe, avec le contexte subereux plus pale.
Chair : Subereuse mais devenant floconneuse ou cotonneuse a la cassure, noircissant immediatement au KOH.
Habitat : Asie du Sud-Est et Asie tropicale. Au Japon, au sud de Hondo, en troupe sur les branches mortes, provoque une pourriture blanche qui gagne le bois initialement teinte de rouge orange par le mycelium.
Spores : Basidiospores 4-4,6 x 1,8-2,3 µm, hyalines, non-amyloides, brievement cylindriques, legerement comprimees d'un cote; apicule minuscule.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Deux substances antibiotiques ont ete isolees dans ce champignon lors de tests menes suite a leur utilisation par les populations aborigenes d'Australie, notamment pour curer les ulceres de la bouche. En Amerique du Sud, le Pycnoporus coccineus est utilise par les indiens du Bresil pour traiter les hemorragies et les troubles uterins (LEVI-STRAUSS, 1946, p. 485). Dans l'est du Chaco argentin, les indiens Tobas utilisent le Pycnoporus sanguineus sec, reduit en poudre et melange avec du corcho (bouchon) comme hemostatique (CROVETTO, 1964, p. 322). Nous voyons dans ces deux cas des applications de la theorie des signatures, la couleur rouge de ces polypores etant associee a la couleur du sang. Selon MARTENS (in FIDALGO, 1965, p. 3), les indiens du Bresil attribuent aux plantes de couleur rouge une relation avec le sang, expliquant l'utilisation du Pycnoporus sanguineus contre l'hemoptysie.

Synonymes : Boletus emodensis Berkeley (1851), in W.J. Hooker, Journal of botany and Kew Garden miscellany, 3, p. 48, tab. 3 (Basionyme)
Boletus squamatus Berkeley (1852), in W.J. Hooker, Journal of botany and Kew Garden miscellany, 4, p. 137
Boletus verrucarius Berkeley (1854), in W.J. Hooker, Journal of botany and Kew Garden miscellany, 6, p. 135
Suillus emodensis (Berkeley) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 535
Suillus verrucarius (Berkeley) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 536
Suillus squamatus (Berkeley) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 536
Strobilomyces annamiticus Patouillard (1909), Bulletin de la Societe mycologique de France, 25(1), p. 6
Strobilomyces porphyrius Patouillard & C.F. Baker (1918), Journal of the straits branch of the royal asiatic Society, 78, p. 72
Boletellus porphyrius (Patouillard & C.F. Baker) E.-J. Gilbert (1931), Les Bolets. Les livres du mycologue, 3, p. 107
Boletellus annamiticus (Patouillard) E.-J. Gilbert (1931), Les Bolets. Les livres du mycologue, 3, p. 107
Boletellus emodensis (Berkeley) Singer (1942), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 40(1-2), p. 19 (nom actuel)
Boletellus squamatus (Berkeley) Singer (1955), Sydowia : Annales mycologici, editi in notitiam scientiae mycologicae universalis, series II, 9(1-6), p. 424
Boletellus verrucarius (Berkeley) Singer (1962) [1961], Sydowia : Annales mycologici, editi in notitiam scientiae mycologicae universalis, series II, 15(1-6), p. 83
References : IH1 507 ; IOH p. 350 ; BMBDS 116 p. 13 ; BSMF 25 p. 6 ; Yoshimi 159
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 5-10 cm, hemispherique puis convexe a plan-convexe, a revetement sec, epais et separable, d'abord densement couvert d'un tomentum squamuleux, constitue de meches apprimees de 2-6 mm de largeur, habituellement rouge vineux fonce, plus rarement teinte de rose (le contexte contrastant en rouge pale a blanchatre sale, les squames palissant dans la vieillesse en perdant leur tons rougeatres pour un brun grisatre), bientot se fissurant, avec le deploiement du chapeau, en plaques plus ou moins grandes sur toute la surface, qui confere a l'ensemble un aspect de chrysantheme ou d'ananas (Strobilomyces). Marge appendiculee par d'importants vestiges du voile qui recouvre entierement l'hymenophore chez le jeune.
Lames/Pores : Tubes adnes, 6-12 mm, jaune citrin, bleuissants instantanement au contact de l'air. Pores 0,5-1,2 mm de diametre, arrondis puis anguleux, citrin vif, brunissants.
Chair : Chair epaisse et ferme, fibreuse dans le stipe, jaunatre pale, bleuissant a la coupe. Odeur nulle, saveur douce.
Stipe : 7-11 x 1-2,5 cm, quasi bulbeux a la base, souvent courbe, plein ferme, strie longitudinalement, jaune olivace au milieu, rougeatre aux extremites, bleuissant au froissement. Anneau subapical epais et tenace, retrousse aux abords du stipe.
Habitat : Himalaya, Inde, Chine, Malaisie, Borneo, Nouvelle Guinee. Au Japon (Honshu, Shikoku et Kyushu), vient en ete et automne dans les bois meles de Pinus-Quercus, Abies-Castanopsis ou Castanopsis, generalement a terre, parfois sur branches mortes ou troncs vivants de Quercus et Cryptomeria (a moins d'1 m de hauteur), rarement sur les rochers moussus.
Spores : 20-24 x 8,5-12,5 µm, ellipsoides, striees de rainures longitudinales ou obliques.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Donne comme comestible a l'etat jeune.

Synonymes : Boletellus elatus Nagasawa (1984), Transactions of the mycological Society of Japan, 25, p. 361 (Nom actuel)
Boletellus hiratsukae Nagasawa in Singer 1986 (nom. nud.)
References : IH1 512 ; IOH p. 354 (gauche)
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 3-9 cm de diametre, hemispherique a convexe puis plan-convexe; Revetement subtomenteux a presque glabre avec l'age, viscidule par l'humidite, de couleur rouge brique a sepia, ou chatain, parfois legerement plus pale a la marge. Voile absent.
Lames/Pores : Tubes 10-30 mm de long, adnes a presque libres, souvent fortement convexes a maturite, jaune pur puis citrin a verdatre olivace, immuables a la coupe. Pores petits puis jusqu'a 2 mm de diametre, anguleux, concolores, immuables au toucher.
Chair : tendre, assez mince dans le pied, blanchatre puis jaunatre, avec une touche de vineux sous la cuticule, immuable ou parfois virant au vineux a la coupe. Odeur nulle, saveur douce.
Stipe : 9-20 x 0,6-1,2 cm, long et elance, epaissi et clave a la base (1,4-4 cm d'epaisseur), de plus en plus mince vers le haut, plein ou farci. Revetement concolore au chapeau, ou plus sombre (brun vineux) avec l'age, sec, pruineux-veloute, raye longitudinalement, non reticule, ou parfois vaguement ruguleux-reticule au sommet. Mycelium basal blanc, abondant.
Habitat : Ete-Automne, Honshu et Kyushu (Japon), dans les bois de Pinus-Quercus, Castanopsis, Abies-Castanopsis, ou Castanopsis-Quercus. Singer a retrouve cette espece au Mexique sous Pinus-Quercus en 1992.
Spores : (12-)16-19(-20) x (7,5-)9-11(-12,5) µm (Q=1,6-1,8) rainures incluses, ellipsoides a oblongues-ellipsoides de face, plutot inegales de profil avec une large depression supra-hilaire, etroitement tronquees en raison du petit pore terminal, jaune de miel dans KOH et Melzer, souvent encapuchonnees de brun violace dans le Melzer. Surface striee de 14-18 rainures, souvent fourchues mais pas obliques comme Boletellus ananas et B. emodensis.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Espece peu commune mais largement distribuee et facile a reconnaitre sur le terrain a son pied elance et pruineux a la base epaissie, son chapeau et stipe colores d'un brun chaud, sa chair et ses tubes immuables. La morphologie sporale le place dans la section Chrysentheroidei Singer. Fiche etablie gracieusement par Nagasawa Eiji selon D.O.-1984, Trans. Mycol. Soc. Japan 25(4) p. 361-366 ;
Pas de photo disponible
Synonymes : Boletus obscurecoccineus Hohnel (1914), Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche klasse, Abt. 1, 123, p. 88 (Basionyme)
Boletellus obscurecoccineus (Hohnel) Singer (1945), Farlowia, 2, p. 127 (nom actuel)
Boletus puniceus W.F. Chiu (1948), Mycologia, 40(2), p. 217
Xerocomus puniceus (W.F. Chiu) F.L. Tai (1979), Sylloge Fungorum Sinicorum, p. 815
Boletus megasporus M. Zang (1981), Acta microbiologica Sinica, 20(1), p. 30 ('magasporus ')
Boletellus puniceus (W.F. Chiu) X.H. Wang & P.G. Liu (2002), Mycotaxon, 84, p. 128
References : IH1 508 ; IOH p. 353
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 3-6 cm, convexe puis plan. Revetement sec, scrobicule et tomenteux, "brun madere", "vieux rose" ou "cannelle rosatre", d'un beau rose rouge rhubarbe vif et a marge excedante chez le jeune, souvent subtilement rimeux-areole, conexte jaune pale, parfois vaguement bleuissant a la blessure.
Lames/Pores : Tubes adnes et deprimes autour du stipe, souvent decurrents par une dent, 5-13 mm de long, gris jaunatre, puis jaune citron vif a jaune verdatre criard, a la fin olivaces. Pores moyens et presque anguleux-hexagonaux, 0,5-1 mm, concolores aux tubes, immuables.
Chair : chair peu epaisse, molle, jaune pale dans le chapeau, presque blanche dans le bas du stipe, immuable ou bleuissant faiblement a la coupe. Saveur un peu amere, odeur nulle.
Stipe : 3-8 x 0,5-1 cm, egal ou epaissi a la base jusqu'a 1,5 cm, plein, revetu de rose "la France" (Ridgway) ou de blanc lave de rose, plus ou moins raye longitudinalement et furfurace de points rouges ou roses, surtout au sommet; souvent avec un tomentum basal blanc.
Habitat : Java, Borneo, Nouvelle-Guinee, Chine, Japon (peu commun), Taiwan, Coree, Afrique (Congo), vient sous fagaceae (Quercus, Castanopsis), plus rarement sous Pinus densiflora. Signale egalement sous eucalyptus en Australie.
Spores : jaune de miel sous le microscope, 14-20 x 5-7 µm, subfusoides ou longuement ellipsoides a subcylindracees, finement et bassement rainurees longitudinalement. Basides tetrasporiques, 30-37 x 10-13 µm; cheilo- et pleurocystides 33-90(100) x 10-15,5 µm ventrues a etroitement fusoides, a paroi mince; trame hymeniale nettement bilaterale; caulocystides 33-51 x 7-12,5 µm, la plupart clavees.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Ressemble a Hortiboletus rubellus et Boletus fraternus en plus rose, mais la spore, rainuree, est ici fort differente et plus grande.

Synonymes : Boletus russellii Frost (1875) [1874], Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences, 2, p. 104 (Basionyme)
Suillus russellii (Frost) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 536
Ceriomyces russellii (Frost) Murrill (1909), Mycologia, 1(4), p. 144
Boletellus russellii (Frost) E.-J. Gilbert (1931), Les Bolets. Les livres du mycologue, 3, p. 107
Boletogaster russellii (Frost) Lohwag (1937), in Handel-Mazzetti, Symbolae sinicae, 2, p. 56
Frostiella russellii (Frost) Murrill (1942), Mimeographed contribution from the Herbarium of the University of Florida. Agricultural experiment Station, 1942, p. 6
Aureoboletus russellii (Frost) G. Wu & Zhu L. Yang (2016), Fungal diversity (Hong Kong), 81, p. 59 (nom actuel)
References : IH1 511 ; IOH p. 351
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : (3-)4-10(-13) cm, plan-convexe a etale, cuticule seche et feutree-veloutee puis presque lisse, bientot se rompant en plaques squamuleuses, brun jaunatre a brun rougeatre, puis gris olivace. Marge d'abord involutee puis droite.
Lames/Pores : Pores (1mm) anguleux, concolores aux tubes, jaune verdatre, immuables ou d'un jaune plus vif au frottement. Tubes adnes, jusqu'a 2 cm de long.
Chair : Douce mais insipide, jaune pale, immuable. Inodore.
Stipe : 8-16 x 1-1,5 cm, egal ou epaissi a la base (qui peut alors atteindre 2-3 cm d'epaisseur), parfois courbe et viscidule a la base, plein et ferme. Revetement subconcolore, profondement rainure et raboteux, hirsute par les cretes ramifiees.
Habitat : Amerique du Nord orientale (Tsuga, chenes, pins), Japon (dans les bois de Quercus serrata ou Pinede a Pinus densiflora).
Spores : Ellipsoides, 15-20 x 7-11 µm, aussi profondement sillonnees de rainures que le stipe. Sporee brun olivacee.
Comestibilite : Comestible

Synonymes : Boletus sensibilis Peck (1880) [1879], Annual report of the New York state Museum of natural history, 32, p. 33 (Basionyme) (nom actuel)
Boletus miniatoolivaceus var. sensibilis (Peck) Peck (1889), Bulletin of the New York state Museum, 2(8), p. 107
References : RTMI 18 p. 135-137 (1980)
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 4-12 cm, d'abord hemispherique avec la marge incurvee, plan-convexe a maturite; surface seche, mais pouvant devenir viscidule chez les sujets matures et imbus, veloutee dans la jeunesse, subtomenteuse, devenant presque glabre avec l'age, souvent fissuree, en totalite ou seulement a la marge, notamment par temps sec, de couleur brun rougeatre, rouge brique ou brun dore avec une legere teinte rougeatre au disque par temps sec.
Lames/Pores : Tubes subdecurrents ou a peine deprimes autour du stipe, jusqu'a 1 cm de long, d'abord jaunes puis olivaces. Pores 0,5-1 mm de diametre, subanguleux, concolores aux tubes, rarement avec une touche d'orange rougeatre a la corruption, virant au bleu fonce au froissement.
Chair : jusqu'a 1,5 cm d'epaisseur dans le chapeau, ferme puis molle, jaune clair, virant rapidement et fortement au bleu fonce au contact de l'air. Odeur faible, aromatique. Saveur douce. Chair du pied jaune vif, parfois tachee de rouge grisatre a la base.
Stipe : 6-12,5 x 1-1,5 cm, d'abord ventru puis egal ou legerement attenue vers le bas, avec un mycelium basal jaunatre, robuste; revetement entierement et densement recouvert de flocons a la loupe et souvent reticule a l'apex. Entierement jaune dans la jeunesse, souvent tache de rouge pale ou de vieux rose a partir du bas, bleuissant comme la chair,
Habitat : Forets de Fagus-Quercus ou mixtes (Cryptomeria-Pinus-Castaneus). Amerique du Nord orientale, Japon (Tottori, Kyoto).
Spores : Sporee brun clair, 10-12,5 x 3,5-3,8 µm, subfusiformes en vue de face, jaune grisatre dans KOH. Quelques jeunes spores sont dextrinoides.
Commentaires : Ressemble beaucoup a Neoboletus erythropus, mais les pores de ce dernier sont rouges des la jeunesse, son chapeau est d'un brun plus fonce et son pied rougeatre plus fonce egalement.
Pas de photo disponible
Synonymes : Boletus retipes Peck (1872) [1869], Annual report of the state Cabinet of natural history, 23, p. 132 (nom. illegit.)
Boletus ornatipes Peck (1878) [1876], Annual report of the New York state Museum of natural history, 29, p. 67 (Basionyme)
Suillus ornatipes (Peck) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 536
Retiboletus ornatipes (Peck) Manfred Binder & Bresinsky (2002), Feddes repertorium, specierum novarum regni vegetabilis, 113(1-2), p. 36 (nom actuel)
References : IH2 549 ; Yoshimi 146 ;
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 4-15 cm, convexe a largement etale, tres finement feutre-tomenteux, jaune pale a brun jaunatre ou brun olivace, parfois tres fonce, marge restant jaune ou plus pale.
Lames/Pores : circulaires, 2-3/mm, jaune vif puis olivace, brunissants au froissement. Tubes jusqu'a 15 mm de long.
Chair : jaune pale, jaune d'or a la coupe, non bleuissante, immuable ou brunissant legerement. Saveur et odeur nulle, rarement amariuscule. Reaction brune orange a l'ammoniaque sur le chapeau, subnulle sur la chair. KOH = brun rougeatre fonce.
Stipe : 6-15 x 1-2,5 cm, epais et plein, subegal ou appointi a la base, rarement fusoide; fortement et grossierement reticule sur toute la surface de jaune vif, orange puis brunissant avec l'age ou la manipulation; mycelium basal jaune.
Habitat : Amerique du Nord, Japon. Ete a automne, dans les bois de feuillus, notamment sous Fagacees (Quercus, Fagus, Castanopsis) ou meles.
Spores : Sporee brun olivace. Spores 8-14 x 3-4 µm, subfusoides, lisses; pleurocystides fusoides-ventrues, a col empli de substance jaunatre lors du regonflage de materiel d'herbier dans KOH.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Russula rubescens Beardslee (1914), Mycologia, 6(2), p. 91 (Basionyme) (nom actuel)
Russula obscura ss. Kauffman (1918), Michigan geological and biological survey, biological series 5, 26, p. 148
Russula vinosa f. kauffmanianaSinger (1936), Revue de mycologie, Paris, 1, p. 293 (nom. inval.)
Russula kauffmaniana Singer ex Singer (1940) [1939], Bulletin de la Societe mycologique de France, 55(3-4), p. 258
References : IH2 583
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 7-10cm, hemispherique puis etale avec le disque deprime, enfin en entonnoir. Revetement non visqueux, couleurs tres variees, de jaune cannelle a rouge brunatre.
Lames/Pores : Adnees, serrees, epaisses et assez larges mais fragiles, blanchatres, virant au jaune sordide.
Chair : Chair epaisse et dure, blanche, devenant lentement rouge brunatre, puis noircissant a l'air
Stipe : rougissant puis noircissant a la manipulation.
Habitat : Amerique du Nord, Japon
Spores : sporee ocre
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : R.rubescens est une espece dermatocystidiee dans les Decolorantes.
Pas de photo disponible
Synonymes : Boletus thibetanus Patouillard (1895), Bulletin de la Societe mycologique de France, 11(3), p. 196 (Basionyme)
Suillus thibetanus (Patouillard) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 536
Aureoboletus novoguineensis Hongo (1973), in Kobayasi, Bulletin of the national science Museum, Tokyo, 16(3), p. 544
Aureoboletus thibetanus (Patouillard) Hongo & Nagasawa (1980), Reports of the Tottori mycological Institute, 18, p. 133 (nom actuel)
Pulveroboletus thibetanus (Patouillard) Singer (1986), The Agaricales in modern taxonomy, Edn 4, p. 774
Aureoboletus auriporus var. novoguineensis (Hongo) Klofac (2010), Osterreichische zeitschrift fur pilzkunde, 19, p. 140
References : IH2 543
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 2,5-7,5 cm, d'abord convexe a conico-convexe, s'etalant avec l'age, surface visqueuse a poisseuse dans la jeunesse ou par temps humide, mais vite sec, plus ou moins fibrilleux ou ruguleux sous le gelin, brun rougeatre, puis chatain clair a brun orange ou orange grisatre avec l'age.
Lames/Pores : Tubes jusqu'a 1,2 cm de long, deprimes autour du stipe, jaune vif puis citrin. Pores longtemps jaune vif, 0,5-1 mm de diametre, subanguleux, immuables.
Chair : Jusqu'a 1 cm d'epaisseur, molle et plus ou moins collante au toucher chez l'adulte, d'abord rouge grisatre a rose peche, puis blanchatre, avec un touche de rose pame sous la cuticule et au dessus des tubes, immuable a la coupe. Odeur imperceptible, saveur acide.
Stipe : 5-8 x 0,6-1,5 cm, epaissi a la base, attenue au sommet ou egal, souvent courbe; revetement viscidule a presque visqueux par temps humide, le sommet parfois strie par les tubes, ou encore furfurace de jaunatre dans le tiers superieur, mais en general rouge grisatre, ou concolore au chapeau, souvent avec des chinures plus foncees. Coton mycelien blanchatre a la base.
Habitat : Chine (decrite du Tibet par Narcisse Patouillard), Singapour, Malaisie, Papouasie-Nouvelle Guinee, et au Japon dans les forets melangees Quercus-Pinus.
Spores : 10-15-(18) x 4-5,5 µm, ellipsoide-fusiformes a fusiformes vus de face, jaune grisatre pale, ou parfois orange grisatre dans KOH.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Agaricus arvensis var. abruptus Peck (1893) [1892], Annual report of the New York state Museum of natural history, 46, p. 55 (nom. inval.)
Agaricus abruptus Peck (1900), Memoir of the New York state Museum, 3(4), p. 163, tab. 59, fig. 8-14 (nom. illegit.)
Agaricus cretacellus G.F. Atkinson (1902), The journal of mycology, 8(3), p. 110
Agaricus abruptibulbus Peck (1905), Bulletin of the New York state Museum, 94, p. 36 (basionyme) (nom actuel)
Psalliota cretacella (G.F. Atkinson) Kauffman (1918), Michigan geological and biological survey, biological series 5, 26, p. 234
References : IH1 262 ; IOH p. 191 ; Eyssartier et Roux p. 276
Groupe : Agarics
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Agaricaceae
Chapeau/Fructification : Mesurant 5-12(-15) cm de diametre, hemispherique, puis convexe, a la fin etale, surface lisse, fibrilleux-soyeux a parfois squamuleux, de couleur creme a jaunatre pale, jaunissant au froissement, a marge souvent appendiculee de restes de voile.
Lames/Pores : Distantes du pied, serrees, etroites (4-8 mm), blanchatres, bientot rouge pale puis brun fonce.
Chair : Plutot epaisse dans le chapeau, blanche puis jaunissant lentement dans le pied au contact de l'air.
Stipe : Mesurant 7-13(-15) × 1-1,5 cm, elance, egal a appointi au sommet, brusquement epaissi et margine a la base, comme si un bulbe globuleux avait ete tronque, vite creux, lisse au dessu de l'anneau, tres legerement et finement pelucheux, blanchatre a creme, puis carne, jaunissant au froissement. Anneau double supere, ample, membraneux, pelucheux a la face infere.
Habitat : Dans la litiere des bois de feuillus, les bois meles, les prairies, les bambouseraies, etc. Ete-automne. Frequent. Amerique du Nord orientale, Japon.
Spores : Ellipsoides, mesurant 6,5-8,5 × 3,5-5 µm.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Il faut necessairement cuire le champignon avant de le consommer. Il contient une molecule carcinogene mais thermolabile : l'agaritine.

Synonymes : Strobilomyces seminudus Hongo (1983), Transactions of the mycological Society of Japan, 23(3), p. 197 (Basionyme)
References : IH1 501
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 3-10 cm, convexe puis plan; surface seche, tomenteuse a tomento-squamuleuse, couvert d'ecailles apprimees inegales, grisatre a noiratre; squames 2-10 mm de large, contrastant avec la chair blanchatre visible dans les fissures, ou parfois presque glabre; marge appendiculee par des restes de voile membraneux, peu visibles car concolores.
Lames/Pores : Tubes jusqu'a 10 mm de long, adnes-subdecurrents a decurrents ou un peu deprimes autour du stipe, d'abord d'un blanc laiteux, puis fuligineuse a maturite; pores jusqu'a 1 mm de large, blanchatres a grisatre. Tubes et pores virant nettement au rouge puis au noir dans les blessures.
Chair : Chair du pileus jusqu'a 1 cm d'epaisseur au centre du chapeau, jusqu'a 7 mm a mi-rayon, blanchatre, rougissant puis noircissant au froissement comme toutes les parties du champignon. Saveur douce, odeur imperceptible.
Stipe : 4-10(-15) x 0,8-1,5 cm au sommet, 0,5-1 cm d'epaisseur vers la base, egal mais nettement epaissi au sommet, ferme, concolore au chapeau; surface reticulee par des tubes venant chevaucher le stipe, avec une zone laineuse annulaire pres de l'apex, ocelle d'ecailles tomenteuses apprimees pres de la base.
Habitat : Solitaires ou eparpilles sur le sol dans les forets mixtes de Castanopsis cuspidata et de chenes verts (Quercus serrata, Q. glauca, etc.). Japon (ouest de Honshū et Kyūshū).
Spores : Sporee brunatre. Spores 6,9 x 7,1 x 6,5-8,5 µm subglobuleuses a largement ellipsoidales, brun fonce dans KOH a 5%, avec des tubercules irreguliers souvent confluents et subcristules. Basides 11,15 x 21,35 µm, en massue, quatre spores; sterigmates 2.5 a 6.5 mm de long (Fig. 2D). Cheilocystides 12,5,19 x 38,69 µm, nombreuses, en massue a fusiformes ou subfusiformes, hyalines ou a contenu brunatre a brun pale, a paroi mince. Pleurocystides 12,5,20 x 44,81 µm, abondantes, semblables aux cheilocystides, mais un peu plus grandes.
Comestibilite : Inconnu
Pas de photo disponible
Synonymes : Amanita spissacea S. Imai (1933), The Botanical Magazine, Tokyo, 47, p. 427 (basionyme) (nom actuel)
Amplariella spissacea (S. Imai) E.-J. Gilbert (1940), Iconographia mycologica, 27, supplement 1(1), p. 78
References : IH1 223 ; IOH p. 165
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 5,5 - 7 cm, vite plan, recouvert de squames apprimees brun fonce, souvent rompues, ocellee, evoquant la peau d'un serpent (inde nomen); marge egale, striee.
Lames/Pores : libres, serrees, inegales, blanches, entieres.
Stipe : central, 5-15 × 0,8-1,5 cm, fistuleux, blanc a brun grisatre, glabre, macules de brunatre fuligineux. Anneau membraneux, gris, fragile, strie. Bulbe basal napiforme, tiquete-chine de restes de volve en squames concentriques brunes.
Habitat : Forets mixtes a Quercus - Castanopsis, Fagus., etc. Japon, Chine, Coree.
Spores : amyloides largement ellipsoides, hyalines, lisses, 8-10,5 × 7-7,5 μm. Cystides clavees, hyphes non bouclees.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Sous-genre Lepidella/section Validae/position incertaine

Synonymes : Russula bella Hongo (1968), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 18, p. 50 (Basionyme)
Russula mariae ss. Singer (1986), Hongo (1988), (1989), non Peck
References : IH1 594 ; IOH p. 367
Groupe : Russules
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 1,5-4,5 cm, cuticule presque entierement separable, mate, finement poudree a pruineuse, rose rouge a rouge corail, parfois panachee, plus pale a la marge qui est striee par transparence avec l'age.
Lames/Pores : libres a attenuees au pied, ventrues, assez espacees, interveinees, blanches, puis creme; arete rose.
Chair : fragile, blanche et immuable; saveur douce; odeur fruitee agreable, comme celle d'amoena. FeSO4 lent et rose pale, Gaiac + a ++, R56 lent (15 minutes).
Stipe : 2-4 x 0,5-0,7 cm, egal ou attenue a la base, ruguleux-strie, finement pruineux, subconcolore rose, plus ou moins delave, ou rarement blanc, spongieux-farci, puis creux.
Habitat : En ete-automne dans les bois de Pinus ou Quercus, au bord des chemins, dans les parcs, etc. solitaire ou gregaire. Tres commun. Japon (Honshu), Coree du Sud.
Spores : Sporee creme pale. Spores ovales-subspheriques, 6.5-7,5 x 5,5-6 µm, cretes subreticulees; basides 4-spores, 25-37 x 9-9,5 µm; cheilocystides abondantes, 37-65 x 5,5-7 µm, etroitement fusoides-ventrues, a sommet pointu. pleurocystides eparses, 44-55 x 5,5-7 µm; Pileocystides 44-80 x 5,3-8 µm.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Belle petite espece entierement pruineuse, d'un beau rose rougeatre, a odeur fruitee. En 1986, Singer avait examine un exemplaire ramene du Japon par un voyageur et conclu a la synonymie de R. bella avec R. mariae Peck, mais sa conception de ce taxon etait differente de celle de Peck.

Synonymes : Rhizopogon lowii A.H. Smith (1966), Memoirs of the New York botanical Garden, 14(2), p. 55
Rhizopogon succosus A.H. Smith (1966), Memoirs of the New York botanical Garden, 14(2), p. 89 (Basionyme) (nom actuel)
Rhizopogon superiorensis A.H. Smith (1966), The Michigan botanist, 5, p. 20
References : IH2 915 ; Yoshimi 84
Groupe : Truffes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Rhizopogonaceae
Chapeau/Fructification : KOH brun rouille, FeSO4 olivace.
Chair : chair douce, odeur souffree desagreable. Exsude un latex poisseux dans la jeunesse. Gleba compacte et ferme, brun tres fonce a maturite.
Habitat : De mai a janvier dans l'Est des USA et Rep. Dominicaine; en ete et automne au Japon, dans les bois de pins, purs ou meles.
Spores : 8-12 x 3-4,5 µm; fusoide a ellipsoide, a base tronquee. Jaune brunatre, brun jaunatre en masse.
Comestibilite : Sans interet
Pas de photo disponible
Synonymes : Amanita griseofarinosa Hongo (1961), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 11, p. 39 (Basionyme)
References : IH1 225 ; IOH p. 166
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 3-6,5 (-10!) cm, convexe puis plan, grisatre, gris brunatre, rarement blanchatre. Surface seche et terne, finement recouverte de restes de voile universel pulverulents tres denses, farineux ou verruqueux grisatres, plus ou moins fonce, souvent agreges en verrues fugaces. Marge lisse, non striee, appendiculee. Contexte blanc.
Lames/Pores : 3-7 mm de large, assez serrees a subespacees, libres, blanches a arete quelque peu fimbriee et poudree de grisatre, lamellules attenuees au pied.
Chair : Chair brusquement mince vers la marge, mais assez epaisse pres du stipe, blanche, assez cassante, douce, inodore.
Stipe : 7-12 (-25!) x 0,3-0,8 cm, subcylindrique ou attenue au sommet, et obovalement bulbeux (10-14 mm) a la base; solide, terne, revetement grisatre a blanchatre sale, couvert de squamules grises, farineuses, floconneuses ou fibrilleuses. epaissi a la base qui est parfois ventrue bulbeuse, orne de restes de volve floconneux-farineux gris a brunatre. Anneau gris, fugace.
Habitat : Plutot commun en petits groupes ou epars parmi la mousse ou les feuilles mortes, en ete-automne au Japon central (Shiga), dans les bois de feuillus meles de Castanopsis cuspidata, Quercus serrata (chene dente), etc.. Recemment retrouve en Coree du Sud et en Chine continentale.
Spores : 9-11,5 x 7,5-9,5 µm, largement ellipsoides a subglobuleuses, halines sous le microscope, lisses, amyloides, basides 4-spores, boucles absentes.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Cette amanite est caracterisee par son voile universel copieusement poudreux qui recouvre le chapeau et le stipe, ainsi que son anneau poudreux evanescent. Bas (1969) a place cette espece dans la stirpe Cinereoconia de la section Lepidella. Hongo (1987) la place tres proche de Amanita vestita.
Pas de photo disponible
Synonymes : Amanita hongoi Bas (1969), Persoonia, 5(4), p. 410 (Basionyme)
Amanita echinocephala ss. Hongo 1965
Lepiota vittadini (Moretti) Gillet ss. Yasuda
References : IH1 (ed.1965) 80 ; Kinoko Field Book p. 81 ; IH1 230
Groupe : Amanites
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Amanitaceae
Chapeau/Fructification : 6,5-17 cm, hemispherique puis convexe a plan, a la fin un peu deprime au disque, assez charnu, blanc a brun jaunatre plus ou moins pale, surface seche, couverte de restes de volve en verrues brunes, de taille moyenne (2-3 mm de hauteur), subconiques a subpyramidales, de plus en plus petites vers la marge qui est non appendiculee ni striee.
Lames/Pores : libres, serrees, blanches a creme pale;
Chair : epaisse, dense et ferme, blanche.
Stipe : 10-15 x 2-3 cm, epaissi en massue vers le bas, ou l'epaisseur est de 4-4,5 cm, ferme et massif, surface flocculeuse-squamuleuse, blanc sordide, brunissant avec l'age, anneau creme subapical pendant, fugace. La moitie inferieure du est ornee de nombreux bracelets (aussi denses que le filetage d'un vis!) de minuscules verrues coniques ou pustuleuses brunatres.
Habitat : Ete-automne dans les bois de Quercus serrata - Castanopsis cuspidata. Espece rare au Japon (Shiga, Kyōto, Kōbe, Ōita), a present signalee en Coree du Sud, Chine continentale.
Spores : 9-11 × 7-8,5 µm, amyloides, ovoides-globuleuses a largement ellipsoides. Boucles absentes. Pleurocystides globuleuses a utriformes, 11-20 µm de diametre.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : Section Lepidella, stirpe Perpasta, espece decouverte au Japon par Hongo, d'abord rapportee a Amanita echinocephala ou Amanita virgineoides avant d'etre publiee comme espece nouvelle par Bas, d'apres les notes et planches de Hongo.

Synonymes : Marasmius pulcherripes Peck (1872) [1871], Annual report of the New York state Museum of natural history, 24, p. 77 (Basionyme) (nom actuel)
Chamaeceras pulcherripes (Peck) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 456
Marasmius siccus ss. Kawam, Hongo (1957)
References : IH1 160 ; Mycotaxon 4:38,1976 ; Rene Lebeuf et Yves Lamoureux, mycoquebec.org.
Groupe : Marasmes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Marasmiaceae
Chapeau/Fructification : 0,5-2 cm, campanule a convexe puis largement campanule, enfin presque plan, souvent mamelonne; lisse ou finement ruguleux, sec, rose ou brun rosatre, palissant mais toujours plus fonce au centre.
Lames/Pores : Adnees ou libres, rarement avec un collarium; espacees, blanche ou rosatres. Sporee blanche.
Chair : tres mince. Saveur douce a amariuscule, ou de rave; odeur nulle.
Stipe : 2-6 x 0,1 cm, egal, sec, souvent torve, lisse, rosatre pale au sommet, de plus en plus fonce vers le bas, brun rougeatre a noir a la base, avec mycelium blanc.
Habitat : ete a automne en troupes ou en touffes. Saprophyte de litiere d'aiguilles de coniferes ou de feuilles. Bambous etc. Amerique du Nord orientale, Japon...
Spores : 11-15 x 3-4 µm, lisses, irregulierement ovoides. Pleurocystides cylindriques a fusoides-ventrues, hyalines, 60 x 10 µm. Cheilocystides en brosse, 25 x 10 µm, dextrinoides.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires :
Pas de photo disponible
Synonymes : Hygrophorus inocybiformis A.H. Smith (1944), Mycologia, 36(3), p. 246 (Basionyme)
References : Kinoko Field Book p. 18 ; https://www.mushroomexpert.com/hygrophoraceae.html ; https://www.mycoquebec.org
Groupe : Hygrophores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Hygrophoraceae
Chapeau/Fructification : 4-8,5 cm, conique campanule et obtusement ombone, puis plan a peu deprime, revetement sec, entierement couvert de meches fibrilleuses beige, gris fonce a gris brunatre, sur fond pale. Marge incurvee, appendiculee.
Lames/Pores : inegales, arquees a subdecurrentes, large 8-14 mm epaisses et lardacees, subespacees, blanchatre a reflets beige; arete entiere. Sporee blanchatre.
Chair : assez epaisse, tendre, blanchatre, immuable, grisatre sous la cuticule. Saveur douce, odeur nulle.
Stipe : 4-7 x 0,6-1,5, plein, subegal, strie de fibrilles brun grisatre, contexte blanchatre. Vestige de voile partiel en trace annuliforme.
Habitat : Sous coniferes, notamment tsugas (Tsuga), epiceas (Picea) et sapins (Abies). Automne. Assez frequent en Amerique du Nord, signale au Japon, tres rare en Europe.
Spores : 10-11 x 6-8 µm, hyalines, ellipsoides, lisses, non amyloides.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Laccaria vinaceoavellana Hongo (1971), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 21, p. 62 (Basionyme)
References : IH1 76 ; IOH p. 61 ; Kinoko Field Book p. 30 ; HN Aomori p. 33
Groupe : Clitocybes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Hydnangiaceae
Chapeau/Fructification : 4-6 cm, convexe puis etale avec une depression ombilicale au centre, non visqueux, radie a presque sillonne-strie, furfurace, surtout au disque, noisette brun-vineux ("Russet-vinaceous", "vinaceous-buff" du code Ridgeway 1912), palissant par le sec vers "pale-pinkish cinnamon" ou "pinkish-buff".
Lames/Pores : adnees-subdecurrentes, espacees [L = 20-25; l = (1)3-5]m large de 4-6 mm, epaisses, subconcolores.
Chair : mince et ferme, concolore, saveur douce, odeur legerement farineuse.
Stipe : 5-8 x 0,6-0,8 cm, egal, ferme, concolore au chapeau, strie- fibrilleux, avec tomentum blanc a la base, plein puis creux.
Habitat : Tres commun et ubiquiste au Japon, du debut de l'ete a l'automne, en troupe sur le sol des bois de feuillus (Castanopsis, Quercus, etc.), dans les pinedes, jardins, lisieres et bords des chemins.
Spores : Sporee blanche. Spores hyalines, spheroides, (5,5-)7,5-8,5 µm de diametres, echinulees (epine de 1 µm de long), non amyloides; basides tetrasporiques; cystides absentes. Trame des lames reguliere.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Tres proche de L. laccata dont il se signale par ses couleurs ternes, sa marge pileique sillonnee-striee et une spore un peu plus petite.

Synonymes : Polyporus vernicipes Berkeley (1878) [1877], The journal of the linnean Society, botany, 16(89), p. 50 (Basionyme)
Polystictus vernicipes (Berkeley) Cooke (1886), Grevillea, 14(71), p. 78
Polystictus makuensis Cooke (1887), Grevillea, 16(78), p. 25
Microporus vernicipes (Berkeley) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 497
Microporus makuensis (Cooke) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 496
Coriolus vernicipes (Berkeley) Murrill (1907), Bulletin of the Torrey botanical Club, 34(9), p. 468
Microporellus subdealbatus Murrill (1907), Bulletin of the Torrey botanical Club, 34(9), p. 471
Coriolus subvernicipes Murrill (1908), Bulletin of the Torrey botanical Club, 35(8), p. 397
Polyporus makuensis (Cooke) Lloyd (1912), Mycological writings, 3, synopsis of the stipitate polyporoids, p. 142
Polystictus subvernicipes (Murrill) Saccardo & Trotter (1912), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 21, p. 320
Polystictus subdealbatus (Murrill) Bresadola (1912), Hedwigia, 53(1-2), p. 65
Coriolus langbianensis Hariot & Patouillard (1914), Bulletin du Museum national d'histoire naturelle, Paris, 20(3), p. 152
Leucoporus vernicipes (Berkeley) Patouillard (1915), Philippine journal of science, section C, botany, 10(2), p. 90
Polyporellus subdealbatus (Murrill) Imazeki (1952), Bulletin of the government forest experimental station Meguro, 57, p. 117
Trametes vernicipes (Berkeley) Zmitrovich, Wasser & Ezhov (2012), International journal of medicinal mushrooms, 14(3), p. 312 (nom actuel)
References : IH1 757 ; IOH p. 455 ; Imazeki, R. 1943. Genera of Polyporaceae of Nippon. Bulletin of the Tokyo Science Museum. 6 p.1-111
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Polyporales / Polyporaceae
Chapeau/Fructification : semi-circulaire, flabelliforme ou spatuliforme, 5-10 cm de diametre, brun clair a chatain ou bai, glabre, lisse a fortement veine radialement ou meme un peu ondule dans la vieillesse, zones concentriques etroites, generalement plus pale vers la marge qui est mince, egale ou lobee ou incisee, la base avec une couche legerement tomenteuse apprimee, ochracee, en langues irregulieres sur moins d' 1 cm en direction de la marge, mais aussi envahissant le haut du stipe (caractere specifique), le plus souvent contrastant fortement avec la surface du chapeau qui est plus sombre.
Lames/Pores : surface poree creme a brunatre pale, souvent tachee de points noirs, decoloree vers la marge, qui est tr-s etroite, voire nulle, sterile, tenue et blanche. Pores ronds, entiers, 6-7/mm; tubes concolores aux pores ou plus pales, jusqu'a 1 mm de profondeur.
Chair : mince, 1-2 mm, moins d'1 mm dans le chapeau, flexible et coriace, d'un blanc pur dans toutes les parties,, cuticule sombre sous-jacente, y compris sous le tomentum mycelien.
Stipe : court et lateral, 2-3 cm x 0,2-0,8 cm, souvent reduit a une simple contraction entre le chapeau et le substrat, la face superieure recouverte d'un coton mycelien creme a ochrace a partir du chapeau, la face inferieure soit couverte de pores decurrents, soit d'une cuticule jaunatre lisse et glabre tres distinctement delimitee. Base elargie en un disque lisse 1-2 cm de diametre.
Habitat : Annuel. Solitaire ou en petits groupes sur bois de feuillus, souvent empiles ou concrescents. Afrique (depuis la Sierra Leone jusqu'au Kenya et au sud, jusqu'en Zambie et Malawi), Japon, Coree?
Spores : cylindriques, 5-7 x 2-2,5 µm de diametre hyalines, lisses, non amyloides ni cyanophiles; Systeme hyphal trimitique; hyphes generatives bouclees, 2-3 µm de diametre, hyphes squelettiques majoritaires, a cloisons epaisses a pleines, 3-7 µm de
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Facile a reconnaitre a ses sporophores bruns, en eventail ou spatule, pied lateral et un coussin mycelien blanc a la base du chapeau, caractere unique dans le genre.

Synonymes : Agaricus roseocandidus Peck (1873), Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences, 1, p. 47 (Basionyme)
Mycena roseocandida (Peck) Saccardo (1887), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 5, p. 262 (nom actuel)
Prunulus roseocandidus (Peck) Murrill (1916), North American flora, 9(5), p. 323
Hemimycena roseocandida (Peck) Singer (1943), Annales mycologici, edii in notitiam scientiae mycologicae universalis, 41(1-3), p. 123
References : NASM pl. 11 B ; IH1 183 ; Mem. Shiga Univ. Vol. 13 p. 52-53, fig. 4, 1963
Groupe : Mycenes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Mycenaceae
Chapeau/Fructification : 5-15 cm, obtusement conique ou convexe, puis largement convexe a presque plan, surface glabre, non visqueuse, hygrophane, d'abord rose saumon a rose jaunatre pale, devenant rapidement jaunatre avec l'age, legerement strie par transparence par temps humide.
Lames/Pores : adnees ou echancrees, espacees (L=15-19, l= 1-3), 1-2 mm de large, remarquablement interveinees, presque blanches, arete entiere.
Chair : mince, fragile, concolore a la surface du chapeau, odeur imperceptible.
Stipe : 2-4 x 0,1-0,2 cm, cartilagineux, egal, creux, concolore, tubulaire ou comprime, pruineux au sommet, herisse de poils blancs a la base.
Habitat : En troupes sur le sol des bois de pins. Amerique du Nord, Japon. Pas commun.
Spores : hyalines, ellipsoides, lisses, 6,5-9,5 x 4-5 µm, non amyloides; basides bisporiques, 28-35 x 6-7 µm; cheilocystides nombreuses, 37-65 x 8,5-11,5 µm, fusoides-ventrues, souvent a col allonge, pedicellees, hyalines, a cloisons minces; pleurocystides eparses, semblables au cheilocystides; toutes les hyphes sont bouclees.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Caracterise par ses teintes pudibondes (de "fillette au teint de petales de cerisier-sakura", selon le nom scientifique japonais) et la presence de cystides ventrues-fusoides, aussi bien sur les faces des lames que sur leurs aretes. Tres proche de M. amabilissima (Peck) Sacc., egalement rose pale, mais qui ne jaunit pas. Les recoltes nipponnes ont des spores un peu plus grandes que dans la litterature nord-americaine, et les basides sont exclusivement bisporiques.

Synonymes : Gerronema nemorale Har. Takahashi (2000), Mycoscience, The Mycological Society of Japan and Springer-Verlag Tokyo, 41(1), p. 16 (basionyme) (nom actuel)
References : IOH p. 96 (s.n. Omphalina epichysium)
Groupe : Tricholomes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Incertae sedis
Chapeau/Fructification : Mesurant 0,6-1,5 cm, d'abord hemispherique, puis convexe avec une depression centrale, parfois concave ou ombilique, revetement lisse puis vite strie radialement a sillonne, pruineux dans la jeunesse, raye de fibrilles innees, brun olivace, puis vert grisatre, a la fin jaune terne. marge parfois ondulee.
Lames/Pores : Arquees-decurrentes, assez espacees (L=25-35), etroites (O,8-1,2 mm), minces, jaune pale ; marge fimbriee, concolore.
Chair : Tres mince, epaisse de 0,5 mm au plus, jaune pale. Odeur non perceptible. Insipide.
Stipe : Mesurant 20-40 × 0,1-2,5 mm, presque egal, mais renfle a la base, central ou un peu excentrique, elance, tubulaire, ferme, jaune pale; entierement furfurace ; base herissee de poils myceliens blancs remarquables.
Habitat : Commun de mai a octobre, solitaire ou cespiteux sur branches mortes tombees a terre en forets planitiaires de Quercus-Pasania. Japon.
Spores : Sporee blanc pur. Spores mesurant 8,5-10 × 5-6 μm, ellipsoides a largement ellipsoides, lisses, hyalines, non amyloides, a cloisons minces. Basides 26-35 × 5-7 μm, clavees, tetrasporiques. Cheilocystides 30-50 × 4-7 μm, abondantes, irregulierement cylindriques ou etranglees, lisses, hyalines ou a contenu jaune pale, a cloisons minces. Pleurocystides absentes. Trame des lames sub-reguliere; pigment incrustant absent. Boucles presentes partout. Pileocystides et caulocystides largement clavees avec pigment jaune intracellulaire.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Les traits saillants sont la taille relativement petite, la silhouette omphaloide, la couleur olivatre, le chapeau fibrilleux, les cheilocystides cylindriques, les pileocystides et caulocystides largement clavees avec pigment jaune intracellulaire, et l'habitat lignicole. Ces caracteres placent cette espece dans le genre Gerronema, section Xanthophylla Singer (Singer, 1986), ou il voisine avec d'autres taxons subtropicaux, comme - Gerronema icterinum (Singer) Singer (Singer, 1948 ; Pegler, 1983), - Gerronema tenue Dennis (Dennis, 1961 ; Pegler, 1983), et - Gerronema citrinum (Corner) Pegler (Corner, 1966 ; Pegler, 1983).

Synonymes : Marasmius ohshimae Hongo & I. Matsuda (1955), Journal of Japanese botany, 30, p. 77 (nom. inval.)
Pseudohiatula ohshimae Hongo & I. Matsuda (1975), Transactions of the mycological Society of Japan, 16(14), p. 381 (Basionyme)
Strobilurus ohshimae (Hongo & I. Matsuda) Hongo ex Katumoto (2010), List of fungi recorded in Japan, p. 954 (nom actuel)
References : IH1 156 ; IOH p. 122 ; Kinoko Field Book p. 58
Groupe : Collybies
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Physalacriaceae
Chapeau/Fructification : 1-5 cm, hemispherique puis plan avec le centre plus ou moins deprime; surface non visqueuse (seulement un "toucher gras" par temps humide), finement duveteuse, blanchatre, teintee de grisatre au centre.
Lames/Pores : blanches, assez serrees a subespacees (35 L, 35 Ll, 70 Lll), 1-4 mm de largeur.
Chair : tres mince et tenace.
Stipe : 3-7 cm x 1,5-3 mm, mince, creux mais tenace, coude et radicant a la base, duveteux, blanchatre sous les lames mais jaune de miel a jaune orange brunatre ailleurs.
Habitat : Espece tardive, venant de la fin de l'automne au debut de l'hiver. Sur branches tombees a terre de coniferes, surtout Cryptomeria japonica. Japon: Honshu et Kyushu.
Spores : ellipsoides, 4,5-6,5 x 2-3 µm; Cheilocystides utriformes + - arrondies, 32-50 x 15-29 µm, a pedicelle etroit. Pileocystides 80-230 x 10 x 29 µm.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Ombrophila albiceps Peck (1889) [1888], Annual report of the New York state Museum of natural history, 42, p. 34, tab. 2, fig. 1-5 (Basionyme)
Leotia albiceps (Peck) Mains (1956), Mycologia, 48(5), p. 700
Neocudoniella albiceps (Peck) Korf (1971), Phytologia, 21(4), p. 204 (nom actuel)
References : Kinoko Field Book p. 301 ; CQ Roland Labbe & Jacqueline Labrecque, mai 2014
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Leotiomycetes / Helotiales / Helotiaceae
Chapeau/Fructification : de 1-4 cm de hauteur, 0,5-1,5 cm de diametre, a tete bien differenciee, globuleuse, bosselee irreguliere, parfois deprimee au centre ou cyathiforme, de consistance gelatineuse, d'un blanc opalescent a gris translucide, souvent rose a brun roux.
Chair : tres gelatineuse, concolore. Saveur acidule.
Stipe : de 0,5-2,5 x 0,5-1,5 cm, gommeux, evase au sommet et egalement a la base, brun rougeatre fonce, recouvert d'une couche de gelin translucide.
Habitat : Assez rare a tres rare, sur le bois pourri de feuillus ou de coniferes, en ete et debut d'automne. Amerique du Nord, Coree, Japon...
Spores : fusiformes a ellipsoides, 5-8 x 2-3 µm
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Le genre Neocudoniella fut cree par le mycologue japonais Sanshi Imai, Journal of the Faculty of Agriculture of the Hokkaido Imperial University 45 (4): 233 (1941)

Synonymes : Laternea bicolumnata Kusano (1908), in Lloyd, Mycological writings, 2, mycological notes n° 31, p. 405, fig. 242 (Basionyme)
Clathrus bicolumnatus (Kusano) Saccardo & Trotter (1912), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 21, p. 462 (nom actuel)
Linderia bicolumnata (Kusano) G. Cunnungham (1931), Proceedings of the linnean Society of the New South Wales, 56(3), p. 193
Linderiella bicolumnata (Lloyd) G. Cunnungham (1944), The Gasteromycetes of Australia and New Zealand, p. 100
Laternea columnata var. bicolumnata (Lloyd) Rick (1961), Iheringia, serie botanica, 9, p. 474
References : IH1 896 ; IOH p. 515
Groupe : Phalles
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Phallales / Phallaceae
Chapeau/Fructification : œufs semihypoges, spheriques au debut, vite ovoides a coniques, 1-2(3) cm de diametre, souvent appointis au sommet et munis d'aretes saillantes, comme ceux des Mutinus et Lysurus; base munie d'une radicelle mycelienne blanche; a la coupe, la gleba centrale est encadree par les deux stipes deja colores de rouge orange (couleur d'ecrevisse ou de crabe cuit qui renforce la pertinence du nom japonais "pince de crabe"). Le voile general se dechire sous la croissance de deux colonnes astipitees (!) rouge pale a jaune orange, divergeant a mi-hauteur, effilees au sommet ou elles se courbent en arche, comme retenues et collees par la gleba.
Chair : abondante, brun verdatre sombre a noire, logee sous l'arche formee par le cintrage des deux pseudo-stipes reunis au sommet, a odeur fetide, desagreable.
Stipe : pseudo-stipe forme de deux tiges separees paralleles, 5-7 cm de hauteur, 0,5-1 cm d'epaisseur, rouge pale a jaune orange, parfois blanc dans le tiers inferieur.
Habitat : Cette espece saprophyte vient volontiers en troupe, en automne, dans les jardins, les bois clairs, sur sol riche en humus organique. Longtemps considere endemique au Japon, puis signale en Chine et en Amerique du Nord. Introduit recemment a Hawai ou il semble suivre les residences secondaires des Japonais! Kansai. Etage planitiaire (35 m). Plantation urbaine (Jardin, Parc), arbres ornementaux. Substrat: Terricole (a terre), humus riche et debris ligneux, sol amende d'ecorces etc..
Spores : incolores, ellipsoides, 3,5-5 x 1,5-2 µm.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Station riche en especes de gasteromycetes, se deplacant d'annee en annee de quelques metres seulement. Cette annee, Clathrus bicolumnatus est nouvelle sur la station, jusqu'ici occupee par Lysurus mokusin et Phallus rugulosus. Par contre, les Lysurus sont absents (substitution par concurrence ?), et les Phallus rugulosus semblent plus luxuriants (grande taille, plus souvent intacts) que les trois annees precedentes. Il n'est pas facile de distinguer les œufs des especes in situ mais les œufs de Phallus rugulosus sont plus spheriques et d'une blancheur vite salie de gris brunatre. Ceux de Clathrus bicolumnatus sont plus apointis-ovoides (peut-etre du a la croissance des doubles stipes reunis en pointe au sommet a l'interieur de l'oeuf ?). A la coupe cependant la difference est tres nette d'un genre a l'autre. Pour bicolumnatus, la gleba centrale est encadre par les deux stipes deja colores de rouge orange (couleur d'ecrevisse ou de crabe cuit (cf. le nom japonais "pince de crabe"). Quant a Phallus rugulosus, comme tous les Phallus, le pied est encore blanc, central, entoure par la gleba.
Pas de photo disponible
Synonymes : Cortinarius nigrosquamosus Hongo (1969), Journal of Japanese botany, 44, p. 235 (Basionyme)
References : IH1 413
Groupe : Cortinaires
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Cortinariaceae
Chapeau/Fructification : 3,5-8 cm, convexe puis plan, surface seche, jaune grisatre, densement couverte d'ecailles noires pointues, flocculeuses, dressees ou recurvees.
Lames/Pores : Adnees a subdecurrentes, presque espacees, interveinees, ochrace-cannelle.
Chair : Plutot mince, jaune de miel pale. Saveur douce, odeur quasi nulle.
Stipe : 4-9 x 6-14 cm, epaissi-clave a la base, farci puis creux, jaune grisatre, plus pale dans le tiers superieur, recouvert d'ecailles noires fibrilleuses a apprimees, en plusieurs bandes irregulieres, montant jusqu'a la cortine.
Habitat : Rare en automne sous Pinus densiflora, les bois mixtes de feuillus a Quercus-Castanopsis. Japon (a l'ouest de Tohoku), Papouasie-Nouvelle-Guinee.
Spores : 5,5-7,5 x 5-6 µm, de couleur fauve-rouille sous le microscope, subglobuleuses ou largement ellipsoides a sub-amygdaliformes, ponctuees, 1 guttule. Basides 4-spores, 26-35 x 7,5-9 µm, trame des lames formees d'hyphes paralleles de 3-12 µm d'epaisseur; squames du chapeau constituees de fascicules d'hyphes septees de 7-20 µm de large, a pigment intracellulaire olivace; articles terminaux subcylindriques ou subventrus, a extremite arrondie ou attenuees a subaigues. Toutes les hyphes sont bouclees.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Cortinaire (Anomali) remarquable par ses revetements herisses de squames noires et ses spores subglobuleuses.

Synonymes : Inocybe lutea Kobayasi & Hongo (1952), Nagaoa: Mycological journal of Nagao Institute, 2, p. 103 (Basionyme) (nom actuel)
Astrosporina lutea (Kobayasi & Hongo) E. Horak (1979), Persoonia, 10(2), p. 197 (nom. inval.)
References : IH1 383
Groupe : Inocybes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Inocybaceae
Chapeau/Fructification : 2,5-3 cm, convexe a conico-convexe, puis campanule; Revetement sec, jaune orange a abricot, couvert de fibrilles radiales concolores dans la jeunesse, puis brunissant, a marge soyeuse et striee; pas de restes velaires.
Lames/Pores : adnees a sublibres, etroites et serrees; jaune orange a abricot fonce, brunissant, a arete blanche et fimbriee.
Chair : Assez ferme, jaune a jaune orange. Saveur douce. Odeur desagreable d'iode ou de corne brulee.
Stipe : Ferme, 2,5-3,5 x 0,3-0,5 cm, cylindrique, bulbeux-margine a la base qui atteint 7 mm de diametre; jaune orange a abricot; Revetement sec, entierement pruineux; parfois strie longitudinalement. Pas de restes de voile.
Habitat : ete-automne, solitaire ou en groupe, sur le sol dans les bois de feuillus (Fagus). Japon, Papouasie-Nouvelle-Guinee
Spores : Spores 7-8 x 4,5-5,5 µm, noduleuses, brunes. Basides 20-26 x 7 µm, 4-spores. Cheilocystides et pleurocystides 35-62 x 11-22 µm, lageniformes a fusoides, metuloides, incrustees, hyalines a jaunatre dans KOH. Caulocystides similaires. Pileo a hyphes cylindriques x 3-8 µm, incrustees de pigment orange brunatre. Boucles nombreuses.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Cet inocybe est facile a identifier par ses teintes jaune orangees et son odeur d'iode desagreable.

Synonymes : Lactarius uyedae Singer (1952), Kew bulletin, 7, p. 300 (Basionyme)
Pleurogala uyedae (Singer) Redhead & Norvell (1993), Mycotaxon, 48, p. 377
Lactifluus uyedae (Singer) Verbeken (2012), Mycotaxon, 119, p. 485 (nom actuel)
References : Nova Hedwigia 40 (1-4): 436 (1985) ; IH2 615 ; Mycologia Vol. 92, No. 6 (nov.-dec. 2000), p. 1119-1132
Groupe : Lactaires
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Russulales / Russulaceae
Chapeau/Fructification : 4-12 mm, pleurotoide, blanc a creme jaunatre, avec des taches ochrace en vieillissant. Cuticule mate, tendant a montrer des tons rouille sur le sec, presque glabre a l'oeil nu mais finement hispide sous la loupe. Marge incurvee chez le jeune, finement fimbriee, souvent legerement sillonnee et irregulierement ondulee.
Lames/Pores : subespacees a espacees, subdecurrentes a decurrentes, d'un blanc un peu plus jaunatre que le chapeau, palissant par le sec, pulverulentes par la sporee, entremelees de 8-13 lamellules.
Chair : blanchatre, latex blanc, immuable, acre.
Stipe : 1-2(4) x 1-1,5 mm, fortement excentrique a lateral, parfois nul, blanc a ocrace pale, tendant a roussir par le sec, surtout au sommet, a revetement entierement subtilement hispide a tomenteux. Absence de voile et de subiculum.
Habitat : De juillet a septembre, epars ou en groupes, au sol ou sur bois en decomposition, parfois dans la mousse (et alors a stipe plus long), dans les bois feuillus (Quercus ou Fagus-Castanopsis). Japon central : Shiga (Otsu, Kokubu), Kyoto (Yamazaki), Osaka (Mino). Espece non tropicale malgre son classement avec L. campinensis, igapoensis et L. panuoides.
Spores : 7-9,5(10) x 5,5-7,5(8) µm, subglobuleuses ou courtement ellipsoides, ornees de verrues densement reticulees, 0,4-0,7 µm de hauteur, avec tache supra-hilaire amyloide. Basides 40-50 x 7,5-12 µm, generalement 4-spores. Lactocystides jusqu'a 100 x 12 µm, effilees ou le plus souvent obtuses, cylindriques a ventrues. Macrocystides presentes, en nombre vers la marge, effilees en forme de crayons, 50-65 x 7,5-12 µm. Hyphes non bouclees, non amyloides. Trame hymeniale et pileique avec spherocystes nombreuses. Structure monomitique. Lacticiferes presents.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Minuscule lactaire pleurotoide, pris souvent pour un Marasmiellus, decouvert par Toshiho Ueda et dedie a ce dernier par Singer, classe dans sa section tropicale Panuoidei. Fiche compilee et illustree a l'aide des Legs de Toshiho (type), D.L de Singer et l'article "Systematics of Pleurotoid Russulaceae from Guyana and Japan, with Notes on Their Ectomycorrhizal Status" par Terry W. Henkel, M. Catherine Aime, Steven L. Miller Mycologia, Vol. 92, No. 6 (Nov. - Dec., 2000), pp. 1119-1132.
Pas de photo disponible
Podocrea cornu-damae (Patouillard) Lindau (1897), in Engler & Prantl, Die naturlichen pflanzenfamilien, 1(1), p. 365
Protocrea cornu-damae (Patouillard) Saccardo & D. Saccardo (1905), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 17, p. 799
Podostroma cornu-damae (Patouillard) Boedijn (1934), Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg, serie 3, 13, p. 274
Trichoderma cornu-damae (Patouillard) Z.X. Zhu & W.Y. Zhuang (2014), Mycosystema, 33(6), p. 1207 (nom actuel)
References : IH2 p. 279 ; IOH p. 587 ; Kinoko Field Book p. 331 ; Saikawa Y. et al., in Tetrahedron, Volume 57, No. 39, 24 Sept. 2001 , pp. 8277-8281
Groupe : Pyrenomycetes
Classification : Ascomycota / Sordariomycetes / Hypocreales / Hypocreaceae
Chapeau/Fructification : Stroma simple et cylindrique a etroitement clave a flabelliforme, souvent bifide a branchu, ramifie en forme de bois de daim (inde nomen), 7-9 cm de haut, aplani, 0,5-1 cm d'epaisseur, plusieurs stromas cylindriques issus d'une base commune, rouge orange a rouge corail brillant; surface glabre, lisse, peritheces non visibles, ostioles en forme de minuscules points orange.
Stipe : sterile
Habitat : sur le bois mort, peu commun. Tibet, Japon, Coree du Sud.
Spores : Conidiophores jusqu'a 400 μm de haut x 2–4 μm de large ; Phialides en bouquets, aigus au sommet, rappelant les hyphes ramifiees des Trichoderma; conidies grossierement spheriques; spore a base tronquee, vert pale, 2,5–3,5 μm; presque lisse a l'optique. Asques cylindriques, 135-158 × 6,5-8,2 µm, epaissies au sommet, annelees.
Comestibilite : Mortel
Commentaires : Champignon tres dangereux, meme par la manipulation (brulures et desquamation!), mortel si ingere. Les symptomes apparaissent en peu de temps, environ 10 minutes apres l'ingestion. Les premiers symptomes sont digestifs, avec des douleurs abdominales, vomissements et diarrhee. Puis des paresthesies, engourdissement des membres, etourdissements, difficultes respiratoires et deficience des globules blancs et plaquettes avec echec de la fonction hematopoietique, ulcerations dermiques dans tout l'organisme, insuffisance hepatique, insuffisance renale et insuffisance respiratoire, taux de letalite eleve. Les sequelles des survivants consistent en l'atrophie du cervelet et de la langue, troubles du mouvement ou perte de cheveux et desquamation de la peau.
Pas de photo disponible
Polyporus rhipidium Berkeley (1847), in W.J. Hooker, The London journal of botany, 6, p. 319
Polystictus rhipidium (Berkeley) Fries (1851), Nova acta regiae Societatis scientiarum Upsaliensis, series 3, 1, p. 74
Favolus rhipidium (Berkeley) Montagne (1854), Annales des sciences naturelles, botanique, serie 4, 1, p. 136
Favolus granulosus Leveille (1863), Annales des sciences naturelles, botanique, serie 4, 20, p. 286
Polyporus subpulverulentusBerkeley & M.A. Curtis (1867) [1869], The journal of the linnean Society, botany, 10(45), p. 306
Laschia guaranitica Spegazzini (1884), Anales de la Sociedad cientifica Argentina, 17(2), p. 70
Favolus rhipidium subsp.* subpulverulentus(Berkeley & M.A. Curtis) Saccardo (1888), Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum, 6, p. 397
Gloeoporus guaraniticus (Spegazzini) Spegazzini (1889), Boletin de la Academia nacional de ciencias en Cordoba, 11(4), p. 452
Gloeoporus rhipidium (Berkeley) Spegazzini (1889), Boletin de la Academia nacional de ciencias en Cordoba, 11(4), p. 452
Favolaschia rhipidium (Berkeley) Patouillard (1893), Bulletin de la Societe mycologique de France, 9(2), p. 130
Favolaschia subpulverulenta (Berkeley & M.A. Curtis) Patouillard (1893), Bulletin de la Societe mycologique de France, 9(2), p. 130
Polyporus diminutus Massee (1896), The journal of botany, british and foreign, 34, p. 153
Favolaschia guaranitica(Spegazzini) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 476
Dictyopanus subpulverulentus (Berkeley & M.A. Curtis) Patouillard (1900), Essai taxonomique sur les familles et les genres des hymenomycetes, p. 137
Dictyopanus rhipidium (Berkeley) Patouillard (1900), Essai taxonomique sur les familles et les genres des hymenomycetes, p. 137
Dictyopanus copelandii Patouillard (1914), Leaflets of Philippine botany, 6(104), p. 2254
Petaloides rhipidium (Berkeley) Torrend (1924), Broteria, revista de sciencias naturaes do Collegio de S. Fiel, serie botanica, 21(1), p. 21
Polyporus rhipidium var. pusillus (Persoon) Kobayasi (1937), Bulletin of the biogeographical Society of Japan, 7(1), p. 3
Polyporus rhipidium f. pusillus(Persoon) S. Ito & S. Imai (1940), Transactions of the Sapporo natural history Society, 16(3), p. 121
Dictyopanus pusillus var. rhipidium (Berkeley) Singer (1945), Lloydia, 8, p. 225
Dictyopanus pusillus (Persoon) Singer (1945), Lloydia, 8, p. 224
Dictyopanus gloeocystidiatus Corner (1954), Transactions of the British mycological Society, 37(3), p. 258
Panellus pusillus (Persoon) Burdsall & O.K. Miller (1975), Beihefte zur Nova Hedwigia, 51, p. 85 (nom actuel)
Panellus copelandii (Patouillard) Burdsall & O.K. Miller (1975), Beihefte zur Nova Hedwigia, 51, p. 88
Panellus gloeocystidiatus (Corner) Corner (1986), Garden's bulletin, Singapore, 39(2), p. 131
References : IH1 p. 95 ; Kinoko Field Book p. 54 ; Kobayashi, Yoshio. in Bull. Nat. Science Museum Vol 6, No. 3: 357-364 (1963) ; Imazeki & Hongo volume 1 : 95 (description sans illustration) ;
Groupe : Pleurotes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Mycenaceae
Chapeau/Fructification : dimidie, hautement cordiforme a la base, plan, 4-5,5 x 3-4,5 mm, environ 1 mm d'epaisseur a la base, a surface plus ou moins feutree ou pruineuse, ochrace pale, presque blanc, devenant ochrace et finement ride en herbier, a marge entiere ou ondulee, incurvee en sechant.
Lames/Pores : Hymenophore pore. Pores petits 7 pores/2mm, luminescents, disposes plus ou moins radialement, polygonaux, plus ou moins allonges et plus petits vers la marge. Tubes 0,4-0,5 mm de large et de long.
Chair : a dissepiments blanc crayeux, d'epaisseur variable 100-140 µm, convexes.
Stipe : cylindrique, (1)-2-(3) x 0,8 mm, surface comme le chapeau, presque blanc.
Habitat : Cespiteux sur branches mortes et souches de divers feuillus, rarement sur Bambous. Commun dans le sud du Japon (sous le nom de souzoume-take スズメタケ), Taiwan, Australie, Nouvelle-Zelande...
Spores : ovoides, 3,8 - 4,9 x 2,5 - 3 µm, faiblement amyloides. Boucles presentes. Pleurocystides nulles. Gloeocystides irregulierement reparties, cylindriques, 2-4µm;
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Petits sporophores gregaires, coriaces, jamais gelatineux, a pied court lateral et hymenium pore.

Synonymes : Hypholoma tuberosum Redhead & Kroeger (1987), Mycotaxon, 29, p. 457 (Basionyme)
Psilocybe tuberosa (Redhead & Kroeger) Walleyn (1998), Sterbeeckia, 18, p. 11 (nom. illegit.)
References : Noordeloos F.A.N.(1999) p. 72 ; RTMI 30 p. 6-13 (2000)
Groupe : Hypholomes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Strophariaceae
Chapeau/Fructification : 2-4,5 cm, obtusement conique puis campanule a plan-convexe, souvent sombre ou distinctement umbonne, parfois courtement deprime autour de l'umbo avec l'age. Marge incurvee puis recurvee. Surface viscidule a l'humidite, generalement lisse ou granulee-ponctuee au disque, parfois avec quelques plaques ou ecailles eparses et fugaces de restes velaires a la marge, plus ou moins hygrophane, mais non strie par transparence. Couleurs variables: orange brunatre, or rougeatre, brun clair, jaune d'ocre, brun dore...
Lames/Pores : Un peu emarginees a largement adnees, parfois decurrentes par une dent, assez serrees a subespacees, 1-3 lamellules, jusqu'a 5 mm de large, blanchatres puis gris a gris violete a marge blanchatre.
Chair : blanchatre ou lavee d'orange pale a maturite, jaune clair a ocrace sale avec l'age dans le stipe. Douce, ou amariuscule, odeur nulle.
Stipe : attache a un sclerote, directement ou par une pseudorhize (jusqu'a 15 cm de long); 3-8 x 0,2-0,4 cm, egal ou parfois epaissi a la base (jusqu'a 6 mm), farci puis creux, montrant une zone annulaire supere, fibrilleuse, lisse au dessus, fibrilleux a squamuleux au dessous, legerement visqueux par temps humide, subconcolore au chapeau, souvent teinte d'orange brunatre a la base avec l'age. Les pseudorhizes sont enveloppees d'un tomentum cotonneux blanchatre a jaune brunatre.
Habitat : vient en automne sur sols fertilises de compost de feuilles, ou riches en nutriments, jardins, pelouse, parcs, 1 a 5 champignons par sclerote. Canada, Australie, Belgique, Japon.
Spores : Sporee brun violace ou brun vineux. Spores 8,5-12 x 5-6,5 µm. Basides bouclees a 2-3-5 spores, utriformes, 21-31 x 7-9 µm. Pleurocystides eparses ou rares (chrysocystides) 25-52 x 10-17 µm, ventrico-fusiformes a ventrico-rostrees, rarement largement clavees. Cheilocystides 17-35 x 4-9,5 µm, nombreuses et serrees, etroitement clavees-rostrees a ventrico-rostrees. Caulocystides 25-30 x 5-8 µm, eparses ou en petits groupes, quasi-nulles au dessous de la zone annulaire.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Basidiophores de taille modeste et elances, issus d'un sclerote souterrain. Solitaire ou en petits groupes.

Synonymes : Tylopilus vinosobrunneus Hongo (1979), Beihefte zur Sydowia, 8, p. 198 (Basionyme)
References : Kinoko Field Book p. 161 ;
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : (1,5)2-8 cm, convexe puis plan, surface viscidule dans la jeunesse puis seche, presque lisse, brun clair a brun rougeatre, brun vineux plus ou moins sombre. Marge incurvee dans la jeunesse.
Lames/Pores : Tubes deprimes autour du stipe ou presque adnes, blancs, puis rosatres, brunissant au toucher 5-8 mm de long. Pores petits (1-2 par mm), subanguleux, concolores, se tachant de brun pale au toucher.
Chair : ferme, puis molle, assez epaisse, blanche, legerement rougissante ou rosissante a la coupe et dans les blessures (les recoltes immuables de Taiwan pourraient relever d'une espece distincte), a odeur fongique, saveur amere.
Stipe : 3-9 x 0,5-2 cm, robuste, egal, subventru ou epaissi a la base. Surface lisse, non reticulee, concolore, souvent plus pale que la chapeau; mycelium basal blanchatre.
Habitat : ete-automne, en forets mixtes Pinus-Quercus, mais surtout sous Quercus serrata, acutissima... Japon tempere, signale en Chine et a Taiwan.
Spores : Sporee brun vineux. Spores 9-12 × 4-5 μm, lisses, ellipsoides a subfusoides, jaune de miel pale dans KOH. Basides 4-spores. Pleurocystides abondantes, 35-52(74) × 10-16(18) μm, fusoides-ventrues, appointies aux extremites, jaune d'or, de miel ou hyalines; cheilocystides abondantes, 30-41 × 7,5-13 µm, comme les pleurocystides mais de taille plus petite. Trame des tubes de type Boletus. Hyphes non bouclees.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Une des nombreuses especes asiatiques de Tylopilus. T. vinosobrunneus ss. stricto Hongo se distingue des autres especes ameres par : - son chapeau brun clair a brun rougeatre, - sa chair roussissante, - ses pleurocystides a contenu huileux ochrace, - et sa cuticule composee de chaines erigees d'elements cylindraces. T. ferrugineus (Frost) Singer lui ressemble un peu, mais il a la chair douce et un pied reticule.

Synonymes : Boletus auripes Peck (1898) [1897], Annual report of the New York state Museum of natural history, 50, p. 107 (Basionyme)
References : Mem. Shiga Univ. 30 p. 52-53 (1970) ; RTMI 35 p. 48 ; IH2 548 ; IOH p. 324
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 4-10(13) cm, pulvine, puis presque plan, parfois plus ou moins ruguleux, cuticule seche presque lisse a finement tomenteuse, brun jaunatre a chatain ou brun grisatre, palissant avec l'age. Marge legerement excedante.
Lames/Pores : Tubes deprimes autour du stipe, sublibres, (4)10-15(25) mm de long, jaune de chrome, immuables. Pores petits, 1-3 / mm, circulaires, obtures dans la jeunesse comme s'ils etaient recouverts d'une membrane jaune a jaune pale, puis concolores aux tubes, immuables, mais parfois teintes ca et la d'olivace a maturite.
Chair : epaisse, de couleur jaune chamois, puis blanchatre, immuable, saveur douce, odeur faible mais agreable.
Stipe : 6-11 x 1,3-2 cm, plein et ferme, epaissi en bas ou subegal, a revetement sec, jaune d'or, plus ou moins discretement reticule, surtout au sommet, de veinules concolores ou blanchatres, la base etant recouverte d'un tomentum mycelien jaune chamois a moutarde.
Habitat : Amerique du Nord et Extreme-Orient. Ete-Automne, mycorhizique, sous feuillus (au Japon sous Quercus serrata, Q. acutissima, Q. mongolica var. crispula, Castanopis cuspidata...).
Spores : Jaune de miel sub micr., (9,5)10-13(14) x 3,5-4,5 µm, subfusoides, lisses. Basides 4-spores; cystides 28-46 x 9,5-10,5 µm, ampullacees a subcylindracees, hyalines, a parois minces. Trame hymeniale de type boletus. Boucles nulles.
Comestibilite : Comestible
Commentaires : Ressemble a Retiboletus (ex Pulveroboletus) retipes, au chapeau plus sombre olivatre et a chair amere. B. aureissimus est un sosie (endemique USA?) jaune de miel plus vif, a reseau discret, ainsi que sa var. castaneus a chapeau veloute brun violace.

Synonymes : Boletus fumosipes Peck (1898) [1897], Annual report of the New York state Museum of natural history, 50, p. 108 (Basionyme)
Ceriomyces fumosipes (Peck) Murrill (1909), Mycologia, 1(4), p. 154
Porphyrellus pseudoscaber subsp.* cyaneocinctus Singer (1945), Farlowia, 2(1), p. 116 (nom. inval.)
Porphyrellus fumosipes (Peck) Snell (1945), Mycologia, 37(3), p. 381
Porphyrellus porphyrosporus subsp.* cyaneocinctus (Singer) Snell & E.A. Dick (1970), Boleti of Northeastern North America, p. 7 (nom. inval.)
Tylopilus fumosipes (Peck) A.H. Smith & Thiers (1971), The Boletes of Michigan (Ann Arbor), p. 103 (nom actuel)
Tylopilus cyaneocinctus (Singer) Grund & K.A. Harrison (1976), Bibliotheca mycologica, 47, p. 198 (nom. inval.)
References : IOH p. 334
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 4-8,5 cm, convexe a presque plan, finement tomenteux, non visqueux, gerce rivuleux a maturite, brun fonce a brun grisatre, parfois teinte de bleu verdatre.
Lames/Pores : Tubes 0,5-0,7 mm de long, plans ou parfois deprimes a maturite, d'abord blanc grisatre, puis jaune grisatre plus clair a brun grisatre, laves de rouge a la coupe. Pores 0,1-0,2 mm, blanchatres dans la jeunesse, brun jaunatre en vieillissant, bleuissants puis virant au brun vineux au toucher.
Chair : epaisse de 0,7-1,3 cm dans le chapeau, blanchatre, virant lentement legerement au bleu pale.
Stipe : 5-9 x 0,6-1,5 cm, egal ou attenue a la base, solide, revetement concolore au chapeau ou plus pale, strie longitudinalement et finement pelucheuse, parfois avec une zone bleu violace au sommet, mais toujours bien blanc a la base.
Habitat : solitaire ou en groupes sur le sol sous feuillus, surtout Quercus, mais aussi sous coniferes; juillet-octobre, peu Commun. Amerique du Nord, Taiwan, Japon.
Spores : Sporeee brunochrace a brun violace. Spores 10-14 × 4-5 μm, lisses, subovoides a obtusement fusiformes en vue frontale, opaque khaki in KOH, brun roussatre pale avec une bordure plus sombre in Melzer. Basides 28-39 × 10-12 μm, clavees, a 4 sterigmates, 3-4 μm long, hyalines in KOH. Pleurocystides 30-42 × 9-12 μm, clavees a subfusoides. Cheilocystides 30-55 × 8-18 μm, plus ou moins largement clavees pedicellees a spheropedonculees. Pileipellis a trichoderme constitue d'elements de 8-15 μm de diametre, terminaisons cellulaires subclavees a subfusoides. Boucles absentes.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Paxillus curtisii Berkeley (1853), The annals and magazine of natural history, series 2, 12, p. 423 (Basionyme)
Pseudomerulius curtisii (Berkeley) Redhead & Ginns (1985), Transactions of the mycological Society of Japan, 26(3), p. 272 (nom actuel)
Meiorganum curtisii (Berkeley) Singer, J. Garcia & L.D. Gomez (1990), Beihefte zur Nova Hedwigia, 98, p. 63
References : IH1 495 ; IOH p. 289 ;
Groupe : Croutes
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Tapinellaceae
Chapeau/Fructification : 2-5(8) cm, semi-circulaire (et alors dimidie), ou en eventail a conchoide, plan-convexe puis un peu creuse, retreci au point d'attache, a revetement lisse a feutre, d'un jaune plus ou moins chaud, orange, olivace ou brunatre, a marge legerement involutee. Hymenophore constitue de lames rayonnantes, tres sinueuses-frisotees, assez serrees, epaisses et ceracees, d'un beau jaune orange plus vif que le chapeau, se teintant d'olivace avec l'age et brunissantes au froissement. Stipe nul ou rudimentaire, blanchatre.
Chair : ferme, jaune pale, insipide, a odeur desagreable sur le frais.
Habitat : Pas tres commun en Amerique du Nord, Chine, Japon, Russie extreme-orientale. Saprotrophe (pourriture brune) de juin a octobre sur bois pourrissant de coniferes (en Asie) ou de feuillus, disperse ou parfois agrege en amas, annuel.
Spores : Spores brun olivace en masse, 3-4 x 1,5-2 µm, etroitement ellipsoides, non amyloides. Trame monomitique a hyphes generatrices bouclees, a paroi mince, hyalines, x 2-4,5 µm
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Porphyrellus subvirens Hongo (1960), Acta phytotaxonomica et geobotanica, Kyoto, 18(4), p. 110 (basionyme)
Austroboletus subvirens (Hongo) Wolfe (1980) [1979], Bibliotheca Mycologica, 69, p. 125 (nom actuel)
References : J-APG 18-4 (1960) p. 110-112 ; IH1 506 ; IOH p. 348
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : Chapeau mesurant 4-8,5 cm, hemispherique a convexe, puis plan, legerement ombonne a obtus, un peu visqueux par temps humide, finement pruineux ou veloute, d'abord vert sombre olivace, puis teinte de jaune ochrace, souvent couvert de granules ou squamules olivacees, craquele, rimeux-areole, avec un voile membraneux appendicule a la marge, incurvee chez les jeunes.
Lames/Pores : Tubes 10-13 mm de long, blancs puis brun vineux, se tachant de rougeatre a la corruption, adnes a sublibres ou deprimes au pied, ventrus; pores ronds puis anguleux, 0,4-0,9 mm de diametre, blanchatres puis laves de verdatre pale, enfin concolores au tubes.
Chair : Chair blanche, molle, moyennement epaisse a presque mince. Saveur amere, odeur nulle.
Stipe : Stipe mesurant 6-11 x 0,7-2 cm, epais, subegal a attenue au sommet, jaune, reticule de mailles olivacees longitudinales, un peu gluant par temps humide, solide puis farci, tomentum blanc a la base.
Habitat : Au Japon (type), vient de juillet a septembre, dans les bois mixtes de Castanopsis-Pinus ou Quercus-Pinus, solitaire ou gregaire, sur le sol parmi les feuilles mortes. Recolte a Taiwan en juin sous Quercus (Cyclobalanopsis) glauca. Distribution: Japon, Taiwan, Chine, Nouvelle-Guinee.
Spores : Sporee brun vineux. Spores jaune pale a jaune ferrugineux pale sous le microscope, fusoides et verruqueuses, mesurant 13-19 x 6-7,5(8) µm. Basides tetrasporiques, mesurant 26-29 x 12,5-13,5 µm. Pleurocystides mesurant 23-30 × 9-11 μm, ventrues ou fusoides ventrues. Trame des tubes de type phylloporoide.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Pterula fascicularis Bresadola & Patouillard (1901), in Lloyd, Mycological writings, 1, mycological notes n° 6, p. 50 (Basionyme)
Deflexula fascicularis (Bresadola & Patouillard) Corner (1950), A monograph of Clavaria and allied genera: Annals of botany memoirs, 1, p. 395 (nom actuel)
References : IOH p. 411
Groupe : Clavaires
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Pterulaceae
Chapeau/Fructification : 1-2 cm de hauteur, blanchatre puis jaune ocrace pale, plus ou moins sali de brun ocrace avec l'age.
Chair : tenace mais elastique et flexible.
Stipe : fermement attache au substrat ligneux, en grand nombre fascicules, formant des grappes pendantes a 360 degres, d'ou le nom japonais de "feu d'artifice pleureur".
Spores : blanches en masse, lisses, spheriques a ellipsoides, contenant un grosse goutte huileuse. Basides grandes, a 4-spores. Cystides nulles. Hyphes dimitiques, les squelettiques bouclees.
Comestibilite : Sans interet

Cyclomyces australis Krombholz (1831), Naturgetreue abbildungen und beschreibungen der essbaren, schadlichen und verdachtigen schwamme, 1, p. 75, tab. 4, fig. 17-18
Polyporus campyloporus Montagne (1854), Annales des sciences naturelles, botanique, serie 4, 1, p. 132
Polystictus campyloporus (Montagne) Cooke (1886), Grevillea, 14(71), p. 82
Microporus campyloporus (Montagne) Kuntze (1898), Revisio generum plantarum, 3, p. 495
Cyclomyces campyloporus (Montagne) Patouillard (1900), Essai taxonomique sur les familles et les genres des hymenomycetes, p. 98
Inonotus fuscus (Kunze) Corner (1991), Beihefte zur Nova Hedwigia, 101, p. 87
Hymenochaete cyclolamellata T. Wagner & M. Fischer (2002), Mycological progress, 1(1), p. 101 (Basionyme) (nom actuel)
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Hymenochaetales / Hymenochaetaceae
Chapeau/Fructification : 2-3 x 1,5-2 cm, conchoide, tomenteux, zone, roux. Marge sinueuse.
Lames/Pores : lamelles concentriques de 1-2 mm de large, concolores.
Chair : mince 1-2 mm, brune.
Habitat : Pas rare en plaques imbriquees, sur les buches de culture a Shii-take. Japon, Chine, Afrique, Oceanie.
Spores : Basides clavees a 2-sporees. Spores ovoides, 3-4,5 x 3 µm, lisses, hyalines.
Comestibilite : Sans interet

Synonymes : Boletus obscureumbrinus Hongo (1968), Memoirs of the Faculty of liberal arts and education, Shiga University natural science, 18, p. 49 (Basionyme)
Sutorius obscurebrunneus (Hongo) G. Wu & Zhu L. Yang (2016), Fungal diversity (Hong Kong), 81, p. 138 (nom actuel)
Groupe : Bolets
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Boletales / Boletaceae
Chapeau/Fructification : 5-11 (15) cm, hemispherique, puis pulvine, marge involutee, seche, finement veloutee, brun terre d'ombre a ombre brulee (presque "brun momie").
Lames/Pores : Tubes adnes a subdeprimes, jaune sulfurin pale a jaune de miel pale, faiblement bleuissants au froissement, 3-9 mm de long; pores minuscules, 2-3 par mm, arrondis, subargilaces (entre “ocre jaune” et “brun Nerprun”).
Chair : tres epaisse, ferme, jaune pale, bleuissant faiblement a la coupe. Saveur douce, odeur agreable.
Stipe : 5-10 x 2-3cm, epaissi a la base 3-4,5 cm, robuste, ovoide-bulbeux, robuste, finement veloute, jaunatre au sommet, ailleurs concolore au chapeau, puis plus pale, non reticule.
Habitat : Pas rare de la fin de l'ete et en automne sous Castanopsis cuspidate, Quercus glauca, ou dans les bois meles de Pinus densiflora-Quercus serrata. Japon central, signale en Chine.
Spores : jaune de miel sub microscopio, 9,5-11×4-5 µm, ellipsoides-fusoides; basides tetrasporiques; cystides poreuses, tres nombreuses, 26-34 x 3-5,5 µm, subcylindriques a subventrues, jaune de mie; trame de l'hymenophore bilaterale de type Bolet; epicutis en trichodermes palissadiques.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Une grosse espece de belle couleur ombre brulee, contrastant avec un stipe jaune et des pores plus ou moins argilaces.

Synonymes : Polyporus mikadoi Lloyd (1912), Mycological writings, 4, letter n° 43, p. 3 (basionyme)
Polyporus cuticularis var. mikadoi (Lloyd) A. Kawamura (1954), Icones of Japanese Fungi, 1, p. 125
Inonotus mikadoi (Lloyd) Pegler (1964), Transactions of the British mycological Society, 47(2), p. 190 (nom actuel)
References : Nunez et Ryvarden 2000. East Asian polypores. Synopsis Fungorum. 13:1-168
Groupe : Polypores
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Hymenochaetales / Hymenochaetaceae
Chapeau/Fructification : Petits basidiocarpes annuels, dimidies a subongules, a base contractee, mesurant 1,5-2,5 × 0,5-1 cm ; surface pileique "brun soudan" a "brun mars", striee radialement, marge aigue, reflechie;
Lames/Pores : Surface poree concave, brun a grisatre, un peu brillante, pores 2-3 par mm, tubes concolores jusqu'a 7 mm de long, dissepiment epais, farineux;
Chair : Contexte mince (< 2mm), brun rouille, fibreux, legerement brillant, avec une base granuleuse jusqu'a 5 mm de diametre.
Habitat : Sur Prunus ×yedoensis (cerisier Yoshino) vivants. Distribution: climats chauds ou temperes, Japon, Coree, Taiwan.
Spores : Basidiospores abondantes, brun rouille, largement ellipsoides, 4.5-6 × 3.5-4 µm. Basides clavees, mesurant 20-25 × 4-5 µm, avec un etranglement median, 2-4 sterigmates de 4-6 µm mesurant de long. Systeme hyphal monomitique, les generatives uniseptees, hyalines a jaunatre dans la trame, jusqu'a 5 µm de large, contexte brun fonce et paroi epaisse, 4-7,5 µm large. Soies absentes.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Cette belle espece est caracterisee par ses petits basidiocarpes, l'absence totale de soies, et l'hote exclusif (pruniers et cerisiers du Japon).
Pas de photo disponible
Synonymes : Psilocybe argentipes K. Yokoyama (1976), Transactions of the mycological Society of Japan, 17(3-4), p. 349
References : IH1 no. 357 ; Tohoku Journ. Exp. Med. 1986 Jan. 148(1):73-8 -Poisoning by hallucinogenic mushroom hikageshibiretake (Psilocybe argentipes K. Yokoyama) indigenous to Japan. Musha M, Ishii A, Tanaka F, Kusano G.
Groupe : Psilocybes/Strophaires
Classification : Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Hymenogastraceae
Chapeau/Fructification : 2,5 - 5 cm de diametre, d'abord conique ou campanule, puis convexe en s'etalant a maturite. Un umbo bien delimite ( elevation circulaire en forme de teton) est typiquement present. Le revetement est brun chatain par temps humide mais le champignon etant hygrophane, il s'eclaircit en sechant et montre des tons brun plus pale. Comme la plupart des autres especes contenant de la psilocybine, il se tache de bleu a la manipulation et dans les blessures. La marge est involutee chez les jeunes, irregulierement lobee a ondulee. Des fragments de voile partiel appendicules a la marge sont parfois visibles dans la jeunesse.
Lames/Pores : adnees ou adnexees au stipe, a la fin secedantes; d'abord orange grisatre, devenant ensuite brun violace avec la marge blanchatre.
Stipe : 6 - 8 cm x 0,2 - 0,4 cm, cylindrique sauf a la base brusquement elargie par la presence de rhizomorphes jaunatres. D'abord blanchatre, peu a peu jaunissant, puis brunatre a brun rougeatre. Il peut conserver des fragments velaires sur les deux-tiers inferieurs.
Habitat : Vient en groupe ou fascicules sur les sols riches en debris ligneux. Affinite notable pour Cryptomeria japonica, Quercus glauca et Pinus taeda. Japon (Kyoto, Osaka, Shiga, Saitama, Niigata et Miyagi)
Spores : Sporee brun-violace fonce. plus ou moins ellipsoides, 6,5 – 7,5 x 9,5 x 3,3 – 4,4 µm. Basides 4-spores. pleurocystides absentes, cheilocystides 13 – 25 x 5 –8 µm.
Comestibilite : Toxique
Commentaires : Presence confirmee de substances hallucinogenes: psilocybine et psilocine, a concentration tres variable selon les recoltes, de 0.003% a 0.55%. Presence de steroides fongiques (ergosterol et ergosterol peroxydes). Plusieurs intoxications a Miyagi entre 1980–84, ont decrit une anxiete et panique chez tous les intoxiques, parfois precedes d'une phase euphorique. Les alterations de la conscience sont frequentes, ebriete majeure, sommeil prolonge et etat stuporeux avec amnesie.
Pas de photo disponible
Synonymes : Erysiphe syringae Schweinitz (1832), Transactions of the American philosophical Society, series 2, 4(2), p. 270 (Basionyme) (nom actuel)
Microsphaera syringae (Schweinitz) Magnus (1898), Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, 16, p. 67
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Leotiomycetes / Erysiphales / Erysiphaceae
Chapeau/Fructification : Cleistostheces (chasmothecies) spheriques ornees d'appendices hyalins dichotomiques se divisant sur trois dimensions.
Habitat : Sur Syringa x chinensis (lilas de Rouen), Syringa vulgaris (lilas commun), Chionanthus virginicus (arbre a neige), Fraxinus ornus (orne) et Ligustrum ovalifolium (troene de Californie) ainsi que d'autres Oleacees. Frequent.
Comestibilite : Sans interet
Commentaires : Se serait presque totalement fait remplacer par Erysiphe syringae-japonicae.

Synonymes : Microsphaera syringae-japonicae U. Braun (1982), Mycotaxon, 15, p. 121 (Basionyme)
Erysiphe syringae-japonicae (U. Braun) U. Braun & S. Takamatsu (2000), Schlechtendalia, 4, p. 14 (nom actuel)
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Leotiomycetes / Erysiphales / Erysiphaceae
Chapeau/Fructification : Cleistotheces (chasmothecies) spheriques de couleur brune, mesurant, ornees d'appendices ("poils") en arbre fractal a 4-5 niveaux.
Stipe : Absent.
Habitat : Sur Syringa spp. (lilas) et Ligustrum vulgare (troene commun). Frequent.
Comestibilite : Sans interet
Pas de photo disponible
Cordyceps umemurae S. Imai (1929), Transactions of the Sapporo natural history Society, 11, p. 32
Elaphocordyceps japonica (Lloyd) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora (2002), Studies in mycology, 57, p. 37
Tolypocladium japonicum (Lloyd) Quandt, Kepler & Spatafora (2014), IMA fungus (International Mycological Association), 5(1), p. 126 (nom actuel)
Groupe : Clavaires
Classification : Ascomycota / Sordariomycetes / Hypocreales / Ophiocordycipitaceae
Habitat : Sur Elaphomyces.
Comestibilite : Sans interet
Pas de photo disponible
References : FMBDS N°237 p. 28
Groupe : Pyrenomycetes
Classification : Ascomycota / Dothideomycetes / Minutisphaerales / Minutisphaeraceae

Synonymes : Oidium leucoconium f. euonymi-japonici Arcangeli Atti. Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisas Proc. Verb. 12 : 109 (1900)
Oidium eounymi-japonici (Arcang.) Sacc. Annales Mycol. 3(1) : 5 (1905)
Oidium leucoconium var. euonymi-japonici (Arcang.) Sacc. & D. Sacc. Syll. fung. (Abellini) 18 : 506 (1906)
Acrosporium euonymi-japonici (Arcang.) Sumst. Mycologia 5(2) : 58 (1913)
Microsphaeria euonymi-japonici (Arcang.) Hara (1921)
Uncinula euonymi-japonici (Arcang.) Hara Dendropath. ed 1 : 22 (1923)
Microsphaeria euonymi-japonici (Vien. - Bourg.) Viennot- bourgin Bull. SMF 82 : 203 (1966) et 84 : 118 (1968)
Erysiphe euonymi-japonici (Vienn.-Bourgin) U. Braun & S. Takamatsu (2000).
Erysiphe euonymicola Braun (2012) (Nom actuel)
References : VIEN. Texte : p. 122 Ellis p. 121
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Leotiomycetes / Erysiphales / Erysiphaceae
Chapeau/Fructification : Colonies circulaires, isolees puis confluentes, farineuses pulverulentes, blanc grisatre, formant des plaques denses sur les feuilles et aussi l'extremite des jeunes rameaux.
Habitat : Sur Euonymus japonicus (fusain japonais) et Euonymus fortunei. Repandu. Printemps automne.
Spores : Conidies solitaires ou en courtes chaines elliptiques a cylindriques, 30-40 x 13-14 µm. Cleistotheces 0,1- 0,5 mm de diametre, pourvus de 4-8 appendices ( fulcres) ramifies plusieurs fois au sommet de facon dichotomique et a peine plus longs que le diametre de la cleistothece.
Comestibilite : Sans interet

Erysiphe hommae (U. Braun) U. Braun & S. Takam. 2000
References : Plant parasites of Europe https://www.waldwissen.net
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Leotiomycetes / Erysiphales / Erysiphaceae
Chapeau/Fructification : Mycelium amphigene, formant d'abord des petites taches blanches (0,5 a 3 cm) sur les faces superieure et inferieure des feuilles. Ces taches s’etendent, fusionnent et finissent par couvrir tout le limbe foliaire. Sur la face inferieure, les depots provoquent des decolorations jaunes visibles sur la face superieure. En cas de forte infestation, les feuilles s’enroulent, brunissent et tombent prematurement. Les infrutescences et les jeunes noisettes peuvent aussi etre touchees, ce qui entraine leur decoloration et leur chute avant maturite.
Habitat : Infeste les feuilles de differentes especes de noisetiers (Corylus spp.).
Spores : Les cleistotheces mesurent entre 90 et 100 µm de diametre et possedent des fulcres dichotomiquement ramifies. Chaque cleistothece contient 3 a 5 asques en forme de sacs, produisant chacun entre 6 et 8 spores ellipsoidales. Conidies de 19 x 28 µm, produites par des conidiophores droits, de 45 µm de long.
Comestibilite : Inconnu
Commentaires : Ce champignon parasite, decrit au Japon, a ete observe pour la premiere fois en Europe en 2019 et se propage rapidement sur le continent. Les cas d'infestations les plus graves peuvent conduire a la mort des noisetiers.

References : Ber. schweiz. bot. Ges. 62: 422 (1952)
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Leotiomycetes / Helotiales / Helotiaceae
Habitat : Sur les aiguilles et branchettes mortes de Cryptomeria japonica.
Spores : Septees
Comestibilite : Sans interet

Sawadaea polyfida var. japonica U. Braun & Tanada (1985), in Braun, Mycotaxon, 22(1), p. 93 ['Sawadaia']
Sawadaea polyfida (C.T. Wei) R.Y. Zheng & G.Q. Chen (1980), Acta microbiol. sin., 20(1), p. 42 (nom actuel)
Groupe : Pezizes
Classification : Ascomycota / Leotiomycetes / Erysiphales / Erysiphaceae
Habitat : Sur les feuilles d'Acer palmatum.
Comestibilite : Sans interet